les communes de l'Oise décorées
 L'auteur lui même décoré de la croix de la valeur militaire , citation à l'ordre de la brigade , animé par le devoir de mémoire , souhaite vous faire revivre le destin tragique de ces villages qui se sont vidés de leur habitants , par les bombardements ennemis et alliés , par les rafles et la déportation, par les combats des maquis , par l'aide apporté à leur libération En 1939 à la déclaration de la guerre j'avais 5 ans et demi , j'ai de très mauvais souvenirs de cette période , les bombardements l'exode , les privations vestimentaires et alimentaires , frayeur des V1 dont les pistes de lancement étaient à proximité de chez nous en en lisière de la forêt d' EU un V1 est tombé à deux KMS de son lieu de lancement, ces V1 n'étais pas très fiables dans leur parcours , des fois ils tournoyaient au dessus de vos têtes dans un bruit assourdissant effroyable , la peur de l'ennemi Fin août 1944 c'était la libération Dix ans après Je partais pour une nouvelle aventure ( les vacances de monsieur G M en AFN ) Il y avait très peu de loisirs , là aussi de mauvais souvenirs , je n'entre pas dans les détails , mais je peux vous dire que j'ai obtenu cette belle décoration ,la Valeur Militaire qui comme la croix de guerre se gagne au péril de sa vie
L'auteur lui même décoré de la croix de la valeur militaire , citation à l'ordre de la brigade , animé par le devoir de mémoire , souhaite vous faire revivre le destin tragique de ces villages qui se sont vidés de leur habitants , par les bombardements ennemis et alliés , par les rafles et la déportation, par les combats des maquis , par l'aide apporté à leur libération En 1939 à la déclaration de la guerre j'avais 5 ans et demi , j'ai de très mauvais souvenirs de cette période , les bombardements l'exode , les privations vestimentaires et alimentaires , frayeur des V1 dont les pistes de lancement étaient à proximité de chez nous en en lisière de la forêt d' EU un V1 est tombé à deux KMS de son lieu de lancement, ces V1 n'étais pas très fiables dans leur parcours , des fois ils tournoyaient au dessus de vos têtes dans un bruit assourdissant effroyable , la peur de l'ennemi Fin août 1944 c'était la libération Dix ans après Je partais pour une nouvelle aventure ( les vacances de monsieur G M en AFN ) Il y avait très peu de loisirs , là aussi de mauvais souvenirs , je n'entre pas dans les détails , mais je peux vous dire que j'ai obtenu cette belle décoration ,la Valeur Militaire qui comme la croix de guerre se gagne au péril de sa vie 
AGNETZ
AGNETZ CROIX DE GUERRE 39/ 45 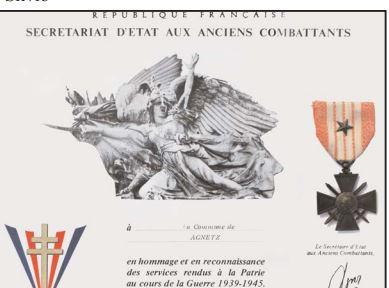 UNE RESISTANCE ACTIVEE
UNE RESISTANCE ACTIVEE
Placé sous l'autorité de Georges Fleury, le groupe de résistants d'Agnetz était composé de seize hommes commandés par l'industriel Chaeley Roguet, dit'' le châtelain d'Agnetz '' futur chef FFI D'Agnetz Plusieurs d'entre eux habitaient Boulincourt, hameau utilisé comme couverture à des réfractaires au STO de diverses régions françaises, qui y avaient trouvé un emploi et des secours. La forêt abritait des déserteurs russes ou ukrainiens ravitaillés par des habitants du lieu.
La Résistance mena plusieurs actions d'éclat. Ainsi, le 18 août 1943, un sabotage de la ligne Creil-Amiens provoqua le déraillement d'un train. Deux jours plus tard, à la suite d'un second sabotage de la ligne ferroviaire, le maire, Marceau Anselme, avec deux autres habitants ,André Paroissien et Marcel Benoit étaient
arrêtés. Ce dernier et le maire furent condamnés à quatre mois de prison avec sursis
LES ALLIES EN ACTION
Le 9 mars 1942, à la suite d'un combat aérien, un avion allemand s'abattit à Agnetz causant deux morts et deux blessés. Plus tard, le 10 juin 1944, l'aviation
alliée mitrailla à Gicourt un camion allemand se dirigeant vers la Normandie . Chargé de mines, son explosion provoqua des dégâts importants.
Le 25 août suivant, vers 12h40, plusieurs tonnes de bombes furent larguées par les Alliés sur les installations allemandes du quartier Belle-Assise (centre de ravitaillement installé dans l'usine Gervais), de l'Equipée et la Croix-Saint-Laurent par 30bombardiers du 342e escadron Lorraine et du 88e escadron de la Royal-Air Force.378 impacts furent recensés sur Clermont, Agnetz et Fitz-James. 46 personnes furent tuées et autant blessées au cours de ce raid allié. Une plaque apposée sur le monument aux morts d'Agnetz rappelle le décès de vingt habitants du village ce jour-là. LA RAFLE DE BOULINCOURT L'origine de la rafle reste inconnue mais peut-être faut-il la rapprocher de l'activité de la Résistance dans le secteur
d'Agnetz. Dans la nuit du 16 au 17 juin 1944, trois cent cinquante à quatre cents soldats de la Wehrmacht, encadrés par des officiers du S.D., investirent le hameau de Boulincourt et barrèrent toutes les voies d'accès. Une cinquantaine d'hommes furent arrêtés, regroupés et interrogés pour obtenir des renseignements sur la Résistance. Vingt d'entre eux furent transférés au camp de Royallieu : Raymond Benoist, André Bousselet, André Demouy, Robert Dumez, Marcel Gondry, Georges Hardivillé, Emmanuel Lagneau, Henri Lambert, Raymond Le Métayer, Marcel Lépine, Raoul Leurart, René Mallard, Aurélien Massé, Charles Morenvillé, André Orget, Valentin Scheldeman, Silvio Serradimigni, Arsène Tallon ,Joseph Van Lacker et Robert Weiss. D'autres actions de représailles furent menées dans les environs. Ainsi, Henri Pauquet , maire résistant de la Neuville-en Hez, et maître Fernand Delarue, notaire à Bresles, furent pris en otages et transférés à Royallieu. Tous les raflés de Boulincourt furent déportés par train vers le camp de Neuengamme par le convoi du 15 juillet 1944. Sur les 1 522 déportés de ce convoi, 663 en réchappèrent. Du groupe des vingt hommes de Boulincourt, trois seulement revinrent vivants du camp de concentration : André Demouy, Silvio Serradimigniet Joseph Van Lancker. Henri Pauquet et maître Delarue, quant à eux, furent aussi détenus à Neuengamme dans des conditions moins éprouvantes : classés parmi les “prominents KZ-Häftling”, les détenus privilégiés, ils bénéficièrent d'un relatif régime de faveur
UNE MEMOIRE VIVE Da Dans le hameau de Boulincourt, une stèle à croix de Lorraine dite “des Déportés” fut élevée place des Déportés, à la croisée des rues Georges Hardivillé, rue Raymond Benoist et rue Charles Morenvillé. Une plaque posée à son pied indique “Les habitants de la commune qui n'ont pas oublié le 17 juin 1944”. D'autres déportés donnèrent leur nom à des rues d'Agnetz (André Demouy, Henri Lambert, Joseph Van Lancker, Robert Weiss) tandis qu'une rue du 17 juin 1944 rappelle la tragédie. Enfin, le nom d'André Bousselet fut donné à une place et celui de Silvio Serradimigni au stade d'Agnetz. CITATION Citation à l'ordre du Régiment“ Petite commune qui a été bombardée à plusieurs reprises, provoquant 16 tués et 20 blessés. Pendant l'occupation, a apporté une aide particulièrement efficace à la Résistance, ce qui lui a valu la déportation de 21 de ses habitants, dont 18 sont morts dans les camps de concentration ennemis” 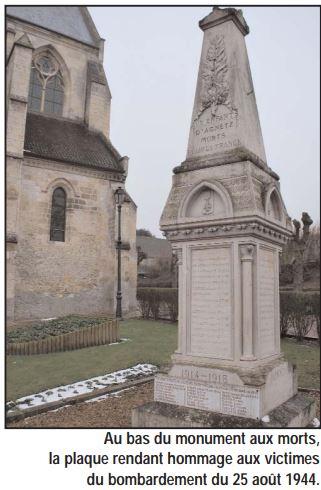
ATTICHY
ATTICHY LES COMBATS DU 170 RI Attichy connut de violents combats durant la Campagne de France. Le 17 mai 1940, face à l'afflux de réfugiés sur Compiègne, le sous-préfet ordonna la réquisition de l'hôpital et de maisons d'Attichy comme lieux d'hébergement. Le 6 juin 1940, le 170e RI prit position devant Attichy (3e Compagnie) et sur les berges de l'Aisne (2e Compagnie). Vers 11 heures, le bombardement du pont d'Attichy par la Luftwaffe provoqua la mort de six hommes de l'escadron hippomobile du 16e GRDI et de leurs chevaux. Le lendemain, 7 juin, le 170e RI se replia en rive gauche de l'Aisne. Le pont sauta à 12h22 tandis que des cyclistes allemands s'apprêtaient à s'y engager. Commença alors un bombardement d'Attichy par l'artillerie française depuis la forêt de Compiègne. Au matin du 8 juin, des soldats allemands du 289e Infanterie Régiment franchirent l'Aisne par canots pneumatiques non sans pertes du fait de l'artillerie française et du mitraillage par les hommes du 170e RI. Grâce à l'intervention des Stukas, les Allemands parvinrent à gagner la gare d'Attichy, puis Attichy à connut de violents combats durant la Campagne de France. Le 17 mai 1940, face à l'afflux de réfugiés sur Compiègne, le sous-préfet ordonna la réquisition de l'hôpital et de maisons d'Attichy comme lieux d'hébergement. Le 6 juin 1940, le 170e RI prit position devant Attichy (3e Compagnie) et sur les berges de l'Aisne (2e Compagnie). Vers 11 heures, le bombardement du pont d'Attichy par la Luftwaffe provoqua la mort de six hommes de l'escadron hippomobile du 16e GRDI et de leurs chevaux. Le lendemain, 7 juin, le 170e RI se replia en rive gauche de l'Aisne. Le pont sauta à 12h22 tandis que des cyclistes allemands s'apprêtaient à s'y engager. Commença alors un bombardement d'Attichy par l'artillerie française depuis la forêt de Compiègne. Au matin du 8 juin, des soldats allemands du 289e Infanterie Régiment franchirent l'Aisne par canots pneumatiques non sans pertes du fait de l'artillerie française et du mitraillage par les hommes du 170e RI. Grâce à l'intervention des Stukas, les Allemands parvinrent à gagner la gare d'Attichy puis à poursuivre leur progression. En fin d'après midi, malgré une tentative de contre attaque face à un ennemi plus fort, les hommes du 170e RI se replièrent.
DEUX MEDAILLES SUR UN COUSSIN 
 La cérémonie de remise de la Croix de Guerre eut lieu le dimanche 12 novembre 1950. Après l'office religieux célébré par l'abbé Boufflet à la mémoire des héros décédés, le maire d'Attichy, M. Preux, reçut sur le perron de la mairie le sous préfet de Compiègne, M. Patou, et le conseiller général Marcel Mérigonde. Après avoir adressé ses remerciements aux invités pour leur présence, il évoqua les souffrances endurées par la population durant l'occupation. L e lieutenant Charbonnel, vice-président de l’Amicale du 170e RI, retraça ensuite les combats livrés par son régiment. Après avoir entendu le discours de Mérigonde, le sous-préfet prit la parole : “ (…) Cette Croix de Guerre, la commune l'a payée par l'attitude courageuse de sa population, par la perte de ses soldats morts au champ d'honneur, de ses trois victimes civiles, de ses prisonniers et de ses requis. Tous ces enfants d'Attichy ou de la région, nous les unissons dans une même affection et dans une même reconnaissance ceux du 170e RI qui ont eu l'honneur de défendre le sol et qui ont laissé onze des leurs qui ont été pieusement inhumés dans le cimetière communal. Notre pensée reconnaissante s'élève principalement jusqu'à ceux d'entre vous qui avaient décidé de harceler l'ennemi et l'empêcher, au moment de son départ, à sa haine meurtrière et dévastatrice et qui, dans les rangs des FFI ont payé de leur vie leur courage et leur abnégation : le lieutenant André Léger, René Demarcq qui furent massacrés, non loin d'ici, sur la route de Bitry ; le lieutenant Poussot qui avait pour quelques jours abandonné son école et dont le sacrifice doit être un exemple pour les enfants à qui il avait su insuffler la foi patriotique et l'idéal serein dont il était animé ; les déportés, enfin, dont l'un est, hélas ! resté au camp de Buchenwald (…) ” Cérémonie de remise de la Croix de Guerre à la commune d’Attichy en présence du maire, M. Preux, du sous-préfet, M. Patou, et du conseiller général M. Mérigonde. Le coussin est porté par la jeune Arlette Flamand CITATION “ Localité gravement sinistrée par les opérations de guerre dont la population a fait preuve de courage dans l'épreuve et dans la lutte contre l'ennemi. Déjà citée au titre de la guerre 1914-1918.”
La cérémonie de remise de la Croix de Guerre eut lieu le dimanche 12 novembre 1950. Après l'office religieux célébré par l'abbé Boufflet à la mémoire des héros décédés, le maire d'Attichy, M. Preux, reçut sur le perron de la mairie le sous préfet de Compiègne, M. Patou, et le conseiller général Marcel Mérigonde. Après avoir adressé ses remerciements aux invités pour leur présence, il évoqua les souffrances endurées par la population durant l'occupation. L e lieutenant Charbonnel, vice-président de l’Amicale du 170e RI, retraça ensuite les combats livrés par son régiment. Après avoir entendu le discours de Mérigonde, le sous-préfet prit la parole : “ (…) Cette Croix de Guerre, la commune l'a payée par l'attitude courageuse de sa population, par la perte de ses soldats morts au champ d'honneur, de ses trois victimes civiles, de ses prisonniers et de ses requis. Tous ces enfants d'Attichy ou de la région, nous les unissons dans une même affection et dans une même reconnaissance ceux du 170e RI qui ont eu l'honneur de défendre le sol et qui ont laissé onze des leurs qui ont été pieusement inhumés dans le cimetière communal. Notre pensée reconnaissante s'élève principalement jusqu'à ceux d'entre vous qui avaient décidé de harceler l'ennemi et l'empêcher, au moment de son départ, à sa haine meurtrière et dévastatrice et qui, dans les rangs des FFI ont payé de leur vie leur courage et leur abnégation : le lieutenant André Léger, René Demarcq qui furent massacrés, non loin d'ici, sur la route de Bitry ; le lieutenant Poussot qui avait pour quelques jours abandonné son école et dont le sacrifice doit être un exemple pour les enfants à qui il avait su insuffler la foi patriotique et l'idéal serein dont il était animé ; les déportés, enfin, dont l'un est, hélas ! resté au camp de Buchenwald (…) ” Cérémonie de remise de la Croix de Guerre à la commune d’Attichy en présence du maire, M. Preux, du sous-préfet, M. Patou, et du conseiller général M. Mérigonde. Le coussin est porté par la jeune Arlette Flamand CITATION “ Localité gravement sinistrée par les opérations de guerre dont la population a fait preuve de courage dans l'épreuve et dans la lutte contre l'ennemi. Déjà citée au titre de la guerre 1914-1918.”
CREVECOEUR LE GRAND
CREVECOEUR LE GRAND
CITATION A L ORDRE DU REGIMENT
“Localité qui a été partiellement détruite en 1940 par de violents bombardements aériens ayant occasionné 13 morts et 32blessés parmi sa population. Pendant l'occupation ennemie, a apporté une aide très efficace à la Résistance et a contribué au sauvetage de 30 parachutistes tombés sur son territoire
LES BOMBES DE JUIN 40 De par sa situation de carrefour et sa proximité de la ligne Weygand, Crèvecœur-le-Grand (2117 habitants en 1936) subit de nombreuses attaques aériennes durant la Campagne de France. Le centre-ville connut son premier bombardement le 20mai 1940. Une semaine plus tard, le 27 mai, le colonel Charles De Gaulle, commandant la 4e Division Cuirassée, vint recevoir ses ordres au château de Crèvecœur-le Grand où siégeait le quartier général du Groupement “ A ”. Ce dernier quitta la commune le 31 mai. Le 7 juin, tandis que le front français était rompu entre Aumale et Grandvilliers sous la pression allemande, Crèvecœur-le-Grand subissait un nouveau bombardement. La 13e DI, du 10e Corps d'Armée, qui occupait le secteur, dut se replier le lendemain pour laisser place à la 85e DIA du 25e Corps d'Armée. Crèvecœur-le-Grand tomba alors aux mains allemandes. Un recensement de juillet 1940 indique que sur 630 maisons, 127 étaient détruites et 100 endommagées.
UNE VIE MUNICIPALE BOUSCULEE Le 21 juin 1940, Jammy Schmidt, député maire de Crèvecœur-le-Grand, embarqua sur le paquebot Massilia avec vingt-six autres parlementaires. Réquisitionné par le gouvernement Paul Reynaud, replié à Bordeaux, ce paquebot devait permettre de conduire des hommes politiques en Afrique du Nord pour constituer un nouveau gouvernement en exil et poursuivre l'offensive militaire. Arrivé le 24 juin à Casablanca, consigné dans un hôtel, Jammy Schmidt fut autorisé à rentrer en métropole le 18 juillet suivant, sept jours après le vote des pleins pouvoirs constituants au Maréchal Pétain. Le 5 février 1941, il fut révoqué de ses fonctions de maire pour avoir quitté le territoire métropolitain. Son adjoint Marceau Beaussang le remplaça. Le 5 avril 1941, une délégation spéciale composée de cinq membres succéda au conseil municipal dissout, avec à sa tête Paul Fromentin.
Jammy Schmidt(1872-1949). Fils du fondateur du journal Le Bonhomme Picard, il mena une carrière politique active. Maire de Crèvecœur-le-Grand, il fut conseiller général puis président du conseil général de l'Oise (1931-1940), député radical (1921-1940)et sous-secrétaire d'Etat au budget (1925 
UNE GARE ENTRE MITRAILLAGES ET BOMBARDEMENTS e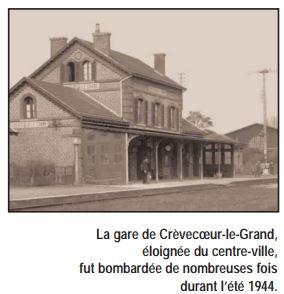 le 2 décembre 1942, un train fut mitraillé à Crèvecœur-le-Grand provoquant la mort du chef cantonnier, l’aviation alliée fut plus particulièrement active n 1944. Le 21 mai 1944, un agent de la SNCF fut grièvement blessé au cours du mitraillage de la gare. Cette attaque fut suivie le 24 mai 1944 par un bombardement allié. Trois jours plus tard, le 27 mai, un train fut mitraillé entre Crèvecœur-le-Grand et Fontaine-Bonneleau. Puis, le 3 juin, la gare fut de nouveau mitraillée. Elle fut encore la cible de bombardements le 24 juin et d’un nouveau mitraillage le 25 juillet suivant .La ligne Beauvais-Amiens fut sabotée près de Crèvecœur-le-Grand le 11 août et la gare essuya un dernier bombardement e 18 août 1944.En outre, le 13 juin 1944, un Halifax se crashe sur Crèvecœur-le-Grand, tuant ses sept membres d'équipage. La gare de Crèvecœur-le-Grand, éloignée du centre-ville, fut bombardée de nombreuse fois durant l'été 1944
le 2 décembre 1942, un train fut mitraillé à Crèvecœur-le-Grand provoquant la mort du chef cantonnier, l’aviation alliée fut plus particulièrement active n 1944. Le 21 mai 1944, un agent de la SNCF fut grièvement blessé au cours du mitraillage de la gare. Cette attaque fut suivie le 24 mai 1944 par un bombardement allié. Trois jours plus tard, le 27 mai, un train fut mitraillé entre Crèvecœur-le-Grand et Fontaine-Bonneleau. Puis, le 3 juin, la gare fut de nouveau mitraillée. Elle fut encore la cible de bombardements le 24 juin et d’un nouveau mitraillage le 25 juillet suivant .La ligne Beauvais-Amiens fut sabotée près de Crèvecœur-le-Grand le 11 août et la gare essuya un dernier bombardement e 18 août 1944.En outre, le 13 juin 1944, un Halifax se crashe sur Crèvecœur-le-Grand, tuant ses sept membres d'équipage. La gare de Crèvecœur-le-Grand, éloignée du centre-ville, fut bombardée de nombreuse fois durant l'été 1944
SAINT MAXIMIN
SAINT MAXIMIN VERS L OCCUPATION
Avec la déclaration de guerre, Saint Maximin connut le cantonnement du 3e Génie du 4 au 6 juin 1939. Un an plus tard, le ciel se couvrait d'avions de chasse. Le 3 juin 1940, le Messerschmitt 109 E3 du pilote allemand Willi Roth fut abattu par le Bloch 152 du capitaine Bernard Maréchal. L'aviateur put se parachuter mais son avion se crasha entre Creil et le château de Laversine. Le 9 juin 1940, tandis que les ponts sur l'Oise étaient détruits, la population prenait la route de l'exode pour ne revenir dans Saint-Maximin occupé que trois semaines plus tard. Si le conseiller municipal communiste Georges Dehan, fut déchu de son mandat le 7 février 1940, le maire René Daubin conserva sa fonction sous le régime de Vichy. Courant 1941, des groupes de résistants FTP s'organisèrent dans le bassin creillois. Carrier à Saint-Maximin Marceau Boulanger devint l'un des principaux responsables départementaux desFTP puis, en 1944, responsable sur plusieurs départements. L'un de ces groupes FTP vola 50 kg d'explosifs et 200 détonateurs dans les carrières de Saint-Maximin le 13 octobre 1941 STOKAGE DE V1
Saint-Maximin devint un site stratégique courant 1943 lorsque l'Etat-major allemand décida d'y établir un lieu de stockage de V1 dans les carrières Ouachée et Jouaud. Situé face aux carrières souterraines de Saint-Leu-d'Esserent, le dépôt avancé (Feldmulag) de Saint-Maximin était désigné par les Allemands sous le nom de code Martha. Il resta inachevé en raison des bombardements alliés de l'été 1944. Le château de Laversine, propriété de la famille Rothschild mise à la disposition du Secours National pour la jeunesse et les malheureux en 1941, fut le siège du commandement allemand en charge de l'assemblage des V1 dans les carrières voisines Avec le Débarquement en Normandie et l’intensification des tirs de V1 sur l'Angleterre, Saint-Maximin devint une cible stratégique pour les Alliés. La défense aérienne allemande (Flak) de Saint Maximin fut particulièrement active et efficace durant les bombardements de masse allié CITATION A L ODRE DE LA NATION Cité ouvrière sinistrée à 95% à la suite de bombardements aériens importants, héroïquement supportés avec sang-froid, par sa population
LES CARRIERES DE TROSSY BOMBARDEES
Le 3 juin, en début d'après-midi, la gare de Saint-Maximin fut bombardée, puis la voie fut mitraillée occasionnant l'incendie d'un wagon utilisé comme magasin d'habillement et la coupure de fils téléphoniques. Puis, dans la nuit du 7 au 8 juillet 1944, le secteur de Saint-Leu - Saint Maximin fut bombardé par 208 bombardiers Lancasters et 13 Moskitos. Quelques semaines plus tard, les bombardements alliés dépassèrent la voie ferrée du Petit Thérain pour toucher les carrières. Le 2 août 1944, 94 bombardiers Lancasters et deux Mosquitos décollèrent du sud-est de l'Angleterre pour accomplir leur mission : bombarder le hameau de Trossy, lieu-dit de Saint-Maximin. Les avions déversèrent 650 tonnes de bombes, détruisant une partie de la voie ferrée Creil-Paris. Le lendemain, 3 août 1944, une mission identique fut ordonnée à 372 Lancasters, et 11Mosquitos
les deux vagues, séparées d'un quart d'heure, déversent 1700 tonnes de bombes sur le secteur de Trossy. Le 4 août 1944, 61 Lancasters bombardèrent de nouveau Trossy. Au cours de ce raid, deux avions alliés furent descendus : le Lancaster PA983 F2-A, du 635 Squadron, qui se crasha au lieu-dit “ Les Longues Raies ” à Saint-Maximin, et le Lancaster ND811 F2-T du 635 Squadron, qui se crasha à Senantes. Si les huit hommes d'équipage du premier avion périrent dans l'explosion, quatre hommes purent se parachuter du second avion grâce à une manœuvre périlleuse du pilote qui, malgré l'incendie de son appareil, parvint à accomplir sa mission de balisage des cibles. Le sous-lieutenant Ian Bazalgette décéda avec deux hommes d'équipage dans l'explosion de son appareil. Il reçut la Victoria Cross à titre posthume pour sa bravoure
DANS LES RUINES
Vide d'habitants, Saint-Maximin fut libéré le 27 août 1944 par les forces américaines qui ne s'attardèrent pas sur ce territoire écrasé par les bombardements. Si quelques écarts comme le château de Laversine ou la ferme des Haies avaient échappé aux destructions, la plupart des rues du village avaient été détruites. Au centreville, l'église, le château Civet et la maison Hamard étaient encore debout. Quatre Saint- Maximois furent tués dans les bombardements : Albert Prédhomme, Esther Louise Renaux, Jean-Baptiste Ruffin et Amélie Torrette. Le château de Laversine fut occupé par les troupes américaines jusqu'en 1945. A la mort de Robert de Rothschild en 1949, le château fut légué à une fondation créée pour donner une éducation aux orphelins de la Shoah (aujourd'hui LP donation Robert et Nelly de Rothschild). Une rue de la ville fut nommée en souvenir de Maurice Dubois, lieutenant FFI évadé d'Allemagne où il était déporté, mort accidentellement au passage à niveau tandis qu'il portait des tracts en moto à Montataire. Des souvenirs liés à la guerre dans l'Oise sont présentés dans une salle de la Maison Saint-Maximin
DANS LES RUINES 
Vide d'habitants, Saint-Maximin fut libéré le 27 août 1944 par les forces américaines qui ne s'attardèrent pas sur ce territoire écrasé par les bombardements. Si quelques écarts comme le château de Laversine ou la ferme des Haies avaient échappé aux destructions, la plupart des rues du village avaient été détruites. Au centre ville, l'église, le château Civet et la maison Hamard étaient encore debout. Quatre Saint- Maximois furent tués dans les bombardements : Albert Prédhomme, Esther Louise Renaux, Jean-Baptiste Ruffin et Amélie Torrette. Le château de Laversine fut occupé par les troupes américaines jusqu'en 1945. A la mort de Robert de Rothschild en 1949, le château fut légué à une fondation créée pour donner une éducation aux orphelins de la Shoah (aujourd'hui LP donation Robert et Nelly de Rothschild). Une rue de la ville fut nommée en souvenir de Maurice Dubois, lieutenant FFI évadé d'Allemagne où il était déporté, mort accidentellement au passage à niveau tandis qu'il portait des tracts en moto à Montataire. Des souvenirs liés à la guerre dans l'Oise sont présentés dans une salle de la Maison de la pierre à Saint Maximin
TROISSEREUX
TROIS MAIRES TROIS MORTS Dans la nuit du 20 au 21 mai 1940, le maire de Troissereux, Lucien Berna, fut tué par une sentinelle française tandis qu'il traversait en auto le bois du Parc avec son épouse malade. Le conseiller municipal Théophile Groux fit alors fonction de maire mais décéda le 31 janvier 1942. Le 23 mai suivant, Jules Degroote fut nommé maire par Vichy. Originaire de Cassel(Nord), cet agriculteur avait épousé une habitante de Troissereux, Berthe, qui lui donna une fille, Suzanne (née en 1925). Lui aussi connut un funeste destin. Le 19 décembre 1943, la mairie fut attaquée sans doute par la Résistance en quête de faux papiers ou de bons d'alimentation. De même, le 16 juin 1944, la voie ferrée fut coupée probablement par une action de résistants. Pour autant, ces événements ne peuvent être mis en relation avec les massacres de la mi-août 1944 dont l'origine et , les circonstances exactes n’ont pas encore été élucidées aujourd’hui. Selon certaines sources, ces représailles seraient la conséquence de la découverte dans la commune de quatre prisonniers polonais évadés. Rien ne permet cependant d'étayer cette version contrariée par une chronologie des faits complexe et des témoignages contradictoires.. LES MASSACRES DU 16 ET 18 AOUT
Dans son édition du 6 septembre 1944, le journal L'Oise Libérée rapporta l'élément déclencheur de la tragédie du 16 août
1944 : “C'est vers 2h30 qu'une attaque fut menée, aux dires des tortionnaires, contre les sentinelles gardant le château Saint Maurice. Un sous-officier avait été, paraît-il, légèrement blessé à la main par un coup de feu et, par ailleurs, une patrouille avait essuyé des coups de feu tirés de la ferme de M. Degroote, maire”. Bien qu'impossibles à vérifier, ces faits furent suivis d'un enchaînement tragique. 8 août 1944 Vers 3 heures du matin, les soldats allemands, qui occupaient le château, pris de boisson pour certains, et craignant une attaque “ terroriste ”, se rendirent à la ferme et enfoncèrent la porte. Ils abattirent le chien puis tuèrent le fermier, Jules Degroote (58 ans). Son épouse Berthe (59ans) et leur fille Suzanne (19 ans), descendues de leur chambre en chemise de nuit, furent abattues peu après. Puis vint le tour de l'ouvrier agricole René Savary (40 ans) et d'Alfred Lenoble (19 ans), pupille de l'assistance, tous deux accourus à l'appel de Mme Degroote. Entre 5 et 6 heures du matin, les Allemands cernèrent le village. Trois hommes se rendant à leur travail furent arrêtés, brutalisés et tués d'une rafale de mitraillette. Il s'agit du charcutier Adrien Sonnet (63 ans), de Marcel Pointud (22ans) et de Gustave Hénaux (53 ans). Puis, tous les habitants de la commune, hommes, femmes et enfants, furent sortis de leur domicile et réunis dans la cour du château. Il était 7 heures du matin. Les hommes furent ensuite rassemblés dans la cour de la ferme Degroote. Les identités furent relevées. Tous les âges, toutes les professions étaient représentées : les ouvriers, les commerçants, l'instituteur, le curé... mais aussi des réfractaires au STO. Un seul Français était libre et observait en fumant une cigarette : Julien Delos. Vers 10 heures, les hommes furent séparés en deux groupes : d'un côté, les hommes de plus de 55 ans et les cultivateurs ; les autres furent alignés le long d'un mur, poings liés derrière le dos Des fusils mitrailleurs furent mis en position devant eux. Vers midi, cinq hommes furent désignés pour charger dans un camion les corps des trois habitants abattus dans les rues et les victimes de la ferme Degroote. L'un d'entre eux, Marcel Lenglet, dont les liens étaient mal serrés, parvint à se détacher à fuir. Peut-être en guise d'exemple, vers 13 heures 30, les Allemands abattirent les quatre hommes dans la cour de la ferme. Il s'agit de Pierre Hébert (20 ans),de Robert Degroote (22 ans), de Gabriel Douchet (35 ans) et du débitant Charles Régnier. Les deux camions sortirent de la cour emportant les victimes et les otages. Vers 14 heures, le docteur Joseph Hébert (63 ans), resté sur place, s'éleva contre l'assassinat de son fils. Il fut exécuté à son tour. Son corps, jeté dans la grange qui fut incendiée, ne fut identifié que le 1er septembre grâce aux boutons de sa veste de chasse et ses leggins. Les Allemands emportèrent les chevaux et les vaches puis brûlèrent les bâtiments de la ferme et la récolte de l'année (blé, orge, avoine). Selon une version des faits, averti de la situation, le Feldkommandant de Beauvais vint sur place et parvint à raisonner les soldats présents. 75 hommes de Troissereux considérés comme otages furent conduits à la caserne Watrin de Beauvais. Seize d'entre eux furent remis en liberté dès le lendemain. Les autres (dont Maurice Mantelet et Maurice Groux), employés à boucher les trous des bombes sur les pistes de l'aéroport, ne furent libérés que le 19 août, sauvés d'une déportation probable par l'avancée des Alliés. Toujours le 16 août, au hameau de Houssoy -le-Farcy, les Allemands abattirent quatre prisonniers polonais évadés : Stanislas Racoczy, Ladislaw Stefanowskiw, Ladislaw Sulochaw et Jean Terebeniec. Leurs corps furent transportés à la caserne Agel et enterrés sur place, Dernier acte : le 18 août. Ce jour-là, vers 18 heures, des soldats allemands se baignaient nus près de la scierie du moulin de Troissereux. Le gérant, le menuisier Louis Astruc, leur adressa une remarque sur leur manque de tenue devant des enfants. Il fut abattu d'une balle dans la tête. Un ouvrier, Anicet de Saint-Riquier, venu s'informer sur la reprise du travail, fut tué d'une balle dans la nuque 

DE JUSTICE A LA MEMOIRE la justice à la mémoire Début septembre, sur les déclarations d'un détenu de la prison Agel qui avait remarqué des allées et venues anormales dans un coin de la caserne, des recherches furent menées. Les fouilles réalisées là où la terre avait été fraîchement remuée permirent de mettre au jour les corps dénudés des treize massacrés de Troissereux avec, près d'eux, des paquets de vêtements et de chaussures. D'autres cadavres inconnus furent exhumés de cette fosse. Ramenés à Troissereux le 3 septembre, les treize habitants massacrés furent inhumés deux jours plus tard. Traduit en justice, Julien Delos fut condamné à mort le 2 décembre 1944 et exécuté le 27 décembre suivant. A la demande de la population, il fut fusillé dans la cour de la ferme Degroote. L'affaire ne s'arrêta pas là. Les témoins identifièrent deux unités d'instruction de l'infanterie d'aviation dépendant de la Luftwaffe et revenant du front Normandie. Le numéro L62011-F désigne Stab II Luftgau-Feld-Regiment Belgien/ Nordfrankreich (mot.) 22 dont la mission concernait les activités administratives d'une zone aérienne (la défense aérienne, les transmissions, le recrutement et le personnel de réserve). Dans ses rangs, un sous-officier dénommé Whilhem Schmitz fut identifié comme l'assassin du maire de Troissereux et du docteur Hébert. Les deux interprètes furent aussi identifiés : le caporal Berron (ancien professeur d'allemand en France avant-guerre) et Théodore Vogth (d'origine alsacienne) qui avait trié les hommes de Troissereux. CITATION Par son active résistance et sa belle tenue, la commune s'est particulièrement attiré la haine de l'ennemi. Le 16 août 1944 sur une dénonciation calomnieuse,15 hommes dont le maire de la localité et deux femmes sont sauvagement assassinés ou fusillés par les Allemands qui brûlèrent en outre par représailles la ferme du maire. L'avance des troupes alliées a permis la libération à Beauvais de tous les hommes du pays qui étaient emmenés en Allemagne. A payé un large tribut et a droit à la reconnaissance du pays.”
TILLE
UNE MENACE DU CIEL Epargné par les bombardements durant la Première Guerre mondiale, le village de Tillé eut à souffrir de sa proximité de l'aérodrome et de la ville de Beauvais. Terrain de manœuvre utilisé entre 1916 et 1918 par l'aviation militaire, l'aérodrome de Beauvais-Tillé servit de terrain de secours à partir de 1922 pour l'aéronautique marchande sur la ligne Le Bourget-Londres. Occupé du 27 août 1939 au 20 mai 1940 par des groupes d'aviation militaire français, il subit des bombardements par la Luftwaffe qui détruisirent plusieurs maisons d'une rue de la commune et firent plusieurs victimes. Le 7 juin, la Zone d'Opération Aérienne du Nord reçut l'ordre de détruire les installations pour ne pas les laisser aux mains allemandes. Dans les premières semaines de l'occupation, l'aviation allemande utilisa les pistes de l'aérodrome notamment le Gruppe I, KG76, constitué de Dornier Do17z, qui combattit durant la bataille d'Angleterre. Par la suite, un quartier de la commune de Tillé fut détruit par les Allemands pour permettre l'extension de l'aérodrome. Deux pistes bétonnées de 1660m furent alors établies sur les remblais des immeubles détruits de Beauvais. Utilisé par la suite comme terrain de délestage, de secours ou de ravitaillement entre Normandie et Pas-de-Calais, l'aérodrome fut équipé en 1942 d'une Défense Contre Avion (la Flak). Bientôt, pour faire face aux survols quotidiens alliés, des avions de chasse y furent basés. En 1943, l'escadrille d'élite JG26 s'y installa ainsi que la KG51 Edelweiss, dotée de chasseurs bombardiers bimoteurs Me 410a. Répertorié par la Luftwaffe sous le n° de code 501 (de septembre 1940 à juin 1942) puis sous le n°252 (de juillet 1942 à juin 1944), le “ Flugplatz Beauvais-Tillé ” fut doté d'importantes infrastructures (44 abris pour avions, un réseau de chemins de roulements relié au terrain annexe de Nivillers…) et d'une puissante Flak (4 batteries de 4 à 6 canons de 88 mm et 14 sections de 2 à 6 canons de 20 à 37 mm). ENJEU STRATEGIQUE , la base aérienne de Tillé devint la cible de bombardements alliés à partir de septembre 1943. Les hameaux de Morlaine et de Tilloy subirent alors d'importantes destructions. En juin 1944, avec le Débarquement, les bombardements s'intensifièrent encore. La Luftwaffe dut aménager des pistes en herbe dans la campagne environnante pour pallier au manque de pistes. Au matin du 18 juin, 16 FW190 de la JG26 furent abattus par 12 Mustang du Squadron polonais 315 de la RAF qui ne subit qu'une seule perte. Si la Luftwaffe quitta définitivement l'aérodrome le 22 août 1944, une semaine avant la libération de Beauvais, il faut noter le passage, le 28 juin précédent de l'escadrille KG3 “Lützow”, de l'Oberst Lehwedd Litzmann, dont les Heinkel 111 H22S lançaient des V1 en vol. A la Luftwaffe succéda l'aviation américaine avec l'installation le 24 septembre 1944 du 1er PF squadron US puis, le 29 septembre du 322 Bombing Group. L'escadre de B26 Marauder quitta l'aérodrome “A61”, selon sa nouvelle dénomination, le 31 mars 1945. Des planeurs d'assaut et des B24 Liberator y furent stockés.août 1944, une semaine avant la libération de Beauvais, il faut noter le passage, le 28 juin précédent de eptembre 1944 du 1er PF squadron US puis, le 29 septembre du 322 Bombing Group. L'escadre de B26 Marauder quitta l'aérodrome “A61”, selon sa nouvelle dénomination, le 31 mrs 1945. Des planeurs d'assaut et des B24 Liberator y furent stockés.août 1944, une semaine avant la libération de Beauvais, il faut noter le passage, le 28 juin précédent de l'escadrille 22 Bombinquadron US puis, le 29 septembre du 3g Group. L'escadre de B26 Marauder quitta l'aérodrome “A61”, selon sa nouvelle dénomination, le 31 mars 1945. Des planeurs d'assaut et des B24 Liberator y furent stockés.août 1944, une semaine avant la libération de Beauvais, il faut noter le passage, le 28 juin précédent w”, de A la Luftwaffe succéda l'aviation américaine avec l'installation le 24 septembre 1944 du 1er PF squadron US puis, lel'O 29 septembre du 322 Bombing Group. L'escadre de B26 Marauder quitta l'aérodrome “A61”, selon sa nouvelle dénomination, le 31 mars 1945. Des planeurs d'assaut et des B24 Liberator y furent stockés ;.août 1944, une semaine avant la libération de Beauvais, il faut noter le passage, le 28 juin précédent de l'escadrille KG3 “Lützow”, de l'Oberst LehweddLitzmann, dont les Heinkel 111 H22S lançaient des V1 en vol. A la Luftwaffe succéda l'aviation américaine avec l'installation le 24 septembre 1944 du 1er PF squadron US puis, le 29 septembre du 322 Bombing Group. L'escadre de B26 Marauder quitta l'aérodrome “A61”, selon sa nouvelle dénomination, le 31 mars 1945. Des planeurs d'assaut et des B24 Liberator y furent stockés.août 1944, une semaine avant la libération de Beauvais, il faut noter le passage, le 28 juin précédent de l'escadrille KG3 “Lützow”, de l'Oberst LehweddLitzmann, dont les Heinkel 111 H22S lançaient des V1 en vol. A la Luftwaffe succéda l'aviation américaine avec l'installation le 24 septembre 1944 du 1er PF squadron US puis, le 29 septembre du 322 Bombing Group. L'escadre de B26 Marauder quitta l'aérodrome “A61”, selon sa nouvelle dénomination,
31 mars 1945. Des planeurs d'assaut et des B24 Liberator y furent stockés.
Août 1944, une semaine avant la libération de Beauvais, il faut noter le passage, le 28 juin précédent de l'escadrille KG3 “Lützow”, de l'Oberst LehweddLitzmann, dont les Heinkel 111 H22S lançaient des V1 en vol. A la Luftwaffe succéda l'aviation américaine avec l'installation le 24 septembre 1944 du 1er PF squadron US puis, le 29 septembre du 322 Bombing Group. L'escadre de B26 Marauder quitta l'aérodrome “A61”, selon sa nouvelle dénomination, le 31 mars 1945. Des planeurs d'assaut et des B24 Liberator y furent stockés. 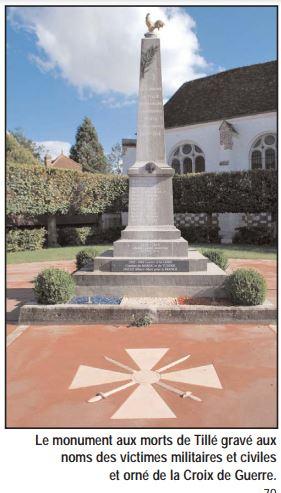
 LA RECONNAISSANCE DE LA NATION La cérémonie de remise de la Croix de Guerre se déroula le 11 novembre 1949, en début d'après-midi, en présence d'une nombreuse assistance. Après l'accueil des invités à la mairie et le dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts, l'appel des morts fut fait par le maire, M. Dumont. Suivirent une minute de silence et le chant “ Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie” entonné par les enfants des écoles. La cérémonie se poursuivit dans la salle des fêtes par un discours du maire rappelant les heures sombres de sa commune et les difficultés du présent : “ Il était pourtant aimable et accueillant, notre village. Le reverrons-nous tel qu'il était, nous demandons-nous, dans notre ferveur impatiente, nous, les vieux du pays ? ”. En l'absence du préfet Cuttoli, le secrétaire général de la préfecture Georges Fleury prit la parole puis, après avoir écouté plusieurs chants et le poème “A Tillé martyr”, de M. Villeroy, épingla la Croix de Guerre sur un coussin porté par une jeune fille et un jeune garçon. La cérémonie de remise de la Croix de Guerre se déroula le 11 novembre 1949, en début d'après-midi, en présence d'une nombreuse assistance. Après l'accueil des invités à la mairie et le dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts, l'appel des morts fut
LA RECONNAISSANCE DE LA NATION La cérémonie de remise de la Croix de Guerre se déroula le 11 novembre 1949, en début d'après-midi, en présence d'une nombreuse assistance. Après l'accueil des invités à la mairie et le dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts, l'appel des morts fut fait par le maire, M. Dumont. Suivirent une minute de silence et le chant “ Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie” entonné par les enfants des écoles. La cérémonie se poursuivit dans la salle des fêtes par un discours du maire rappelant les heures sombres de sa commune et les difficultés du présent : “ Il était pourtant aimable et accueillant, notre village. Le reverrons-nous tel qu'il était, nous demandons-nous, dans notre ferveur impatiente, nous, les vieux du pays ? ”. En l'absence du préfet Cuttoli, le secrétaire général de la préfecture Georges Fleury prit la parole puis, après avoir écouté plusieurs chants et le poème “A Tillé martyr”, de M. Villeroy, épingla la Croix de Guerre sur un coussin porté par une jeune fille et un jeune garçon. La cérémonie de remise de la Croix de Guerre se déroula le 11 novembre 1949, en début d'après-midi, en présence d'une nombreuse assistance. Après l'accueil des invités à la mairie et le dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts, l'appel des morts fut  fait par le maire, M. Dumont. Suivirent une minute de silence et le chant “ Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie” entonné par les enfants des écoles. La cérémonie se poursuivit dans la salle des fêtes par un discours du maire rappelant les heures sombres de sa commune et les difficultés du présent : “ Il était pourtant aimable et accueillant, notre village. Le reverrons-nous tel qu'il était, nous demandons-nous, dans notre ferveur impatiente, nous, les vieux du pays ? ”. En l'absence du préfet Cuttoli, le secrétaire général de la préfecture Georges Fleury prit la parole puis, après avoir écouté plusieurs chants et le poème “A Tillé martyr”, de M. Villeroy, épingla la Croix de Guerre sur un coussin porté par une jeune fille et un jeune garçon .La cérémonie de remise de la Croix de Guerre se déroula le 11 novembre 1949, en début d'après-midi, en présence d'une nombreuse assistance. Après l'accueil des invités à la mairie et le dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts, l'appel des morts fut fait par le maire, M. Dumont. Suivirent une minute de silence et le chant “ Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie” entonné par les enfants des écoles. La cérémonie se poursuivit dans la salle des fêtes par un discours du maire rappelant les heures sombres de sa commune et les difficultés du présent : “ Il était pourtant aimable et accueillant, notre village. Le reverrons-nous tel qu'il était, nous demandons-nous, dans notre ferveur impatiente, nous, les vieux du pays ? ”. En l'absence du préfet Cuttoli, le secrétaire général de la préfecture Georges Fleury prit la parole puis, après avoir écouté plusieurs chants et le poème “A Tillé martyr”, de M. Villeroy, épingla la Croix de Guerre sur un coussin porté par une jeune fille et un jeune garçon. CITATION Citation à l'ordre du Régiment ? Centre stratégique important, a subi stoï-quement de violents bombardements qui provoquèrent 12 morts et 15 blessés. La destruction de 148 immeubles sur 197 donne une idée de la violence de ces bombardements. Ses habitants, animés du plus ardent patriotisme et du plus grand mépris du danger, ont opposé une belle résistance sous toutes ses formes et tous les instants à l'ennemi. Village meurtri entre tous, a bien mérité de la patrie
fait par le maire, M. Dumont. Suivirent une minute de silence et le chant “ Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie” entonné par les enfants des écoles. La cérémonie se poursuivit dans la salle des fêtes par un discours du maire rappelant les heures sombres de sa commune et les difficultés du présent : “ Il était pourtant aimable et accueillant, notre village. Le reverrons-nous tel qu'il était, nous demandons-nous, dans notre ferveur impatiente, nous, les vieux du pays ? ”. En l'absence du préfet Cuttoli, le secrétaire général de la préfecture Georges Fleury prit la parole puis, après avoir écouté plusieurs chants et le poème “A Tillé martyr”, de M. Villeroy, épingla la Croix de Guerre sur un coussin porté par une jeune fille et un jeune garçon .La cérémonie de remise de la Croix de Guerre se déroula le 11 novembre 1949, en début d'après-midi, en présence d'une nombreuse assistance. Après l'accueil des invités à la mairie et le dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts, l'appel des morts fut fait par le maire, M. Dumont. Suivirent une minute de silence et le chant “ Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie” entonné par les enfants des écoles. La cérémonie se poursuivit dans la salle des fêtes par un discours du maire rappelant les heures sombres de sa commune et les difficultés du présent : “ Il était pourtant aimable et accueillant, notre village. Le reverrons-nous tel qu'il était, nous demandons-nous, dans notre ferveur impatiente, nous, les vieux du pays ? ”. En l'absence du préfet Cuttoli, le secrétaire général de la préfecture Georges Fleury prit la parole puis, après avoir écouté plusieurs chants et le poème “A Tillé martyr”, de M. Villeroy, épingla la Croix de Guerre sur un coussin porté par une jeune fille et un jeune garçon. CITATION Citation à l'ordre du Régiment ? Centre stratégique important, a subi stoï-quement de violents bombardements qui provoquèrent 12 morts et 15 blessés. La destruction de 148 immeubles sur 197 donne une idée de la violence de ces bombardements. Ses habitants, animés du plus ardent patriotisme et du plus grand mépris du danger, ont opposé une belle résistance sous toutes ses formes et tous les instants à l'ennemi. Village meurtri entre tous, a bien mérité de la patrie
MARGNY LES COMPIEGNE
PRES DE CORBEAU LIEU Aérodrome civil établi sur les hauts de Margny avant la Grande Guerre, le terrain d'aviation de Corbeaulieu fut le lieu de passage d'escadrilles françaises durant la Drôle de Guerre. La Compagnie de l'Air 49/104, placée sous le commandement du lieutenant Dewailly, y fut déployée du 4 janvier au 8 juin 1940. Les Groupes Aériens d'Observation 502 et 547, volant sur des Potez 63-11, occupèrent le terrain les 16 et 17 mai 1940. Le 1er juin, cinq canons de 25mm de la batterie 1016/403 des Forces Terrestres Antiaériennes défendirent le site qui fut abandonné une semaine plus tard. C'est sur ce terrain qu'Hitler atterrit le 20 juin 1941 en vue de préparer l'armistice dans la célèbre clairière de Compiègne. En novembre 1940, l'Etat-major du Ier Fliegerkorps y stationna une escadrille de liaison. Le terrain de Croutoy lui fut préféré en raison des turbulences au passage de l'Oise. Etendu sur environ 100 ha et doté de voies de circulation et de dispersion, le “ Flugplatz Compiègne” fut référencé par la Luftwaffe sous le numéro 547 de janvier à juin 1942, puis sous le numéro 251 de juillet 1942 à juin 1944.Le 8 août 1944, à 13h40, trois vagues de six bombardiers alliés bombardèrent le pied du plateau dominant Margny-lès-Compiègne, à proximité des hangars du terrain d'aviation sans faire de victimes. A la Libération, les Américains référencèrent le terrain ALG Y-35 et construisirent deux pistes en grilles longues de 910m et larges de 43m, liées entre elles par une voie de circulation. Ces pistes furent démontées et enherbées en 1947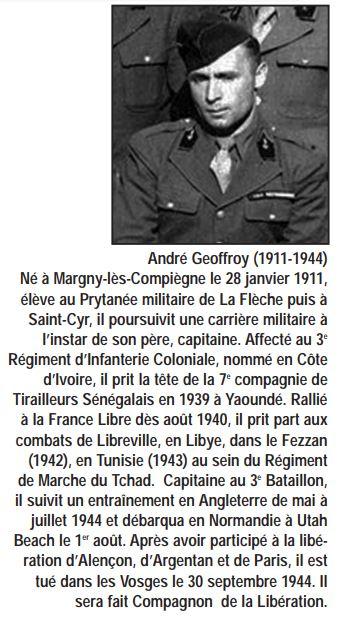
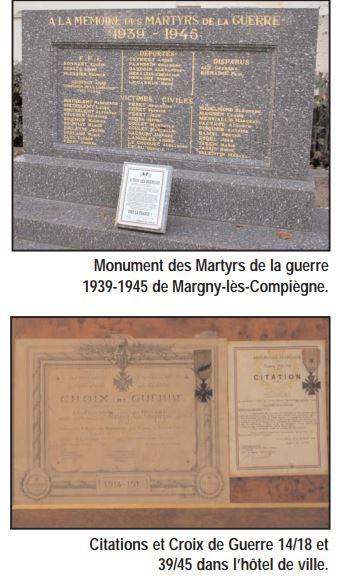 UNE RESISTANCE ACTIVE Avec le Régime de Vichy, un nouveau conseil municipal fut nommé, le radical socialiste Maurice Lambert conservant son poste de maire. Si le communiste André Ameuil fut arrêté le 16 juillet 1941 puis libéré, le conseiller municipal Maurice Simbozelle fut démis de ses fonctions en août suivant pour avoir critiqué le gouvernement. La Résistance fut active très tôt. Début 1941, un groupe se forma sur Compiègne et Margny-lès-Compiègne. Rattachés au réseau Hector du mouvement Combat, les membres du “Bataillon de France” constituèrent des dépôts d'armes, diffusèrent des tracts, recherchèrent des renseignements sur les troupes d'occupation et sabotèrent les liaisons de communication. Dénoncé par le traître Jacques Desoubrie, le groupe fut arrêté les 3 et 4 mars puis le 17 avril 1942, interrogé puis interné à Fresnes. Si Georges Fouquoire fut relâché pour raison de santé, les autres membres furent transférés en Allemagne le 17 septembre 1943et jugés en octobre suivant par le tribunal du peuple. Georges Bechon et Alfred Vervin décédèrent avant le procès. Gualbert Flandrin, Alexandre Gandoin, Gabriel Clara, Michel Edvire, Christian Héraude, Abel Laville, Robert Héraude, Auguste Vandendriesche et Georges Tainturier furent décapités à la hache le 7 décembre 1943. Pierre Bourson, Robert Toustou et François Claux décédèrent en déportation. Maurice Rousselet et René Nicot survécurent. Malgré la répression allemande, les actions de la Résistance se poursuivirent. Ainsi, le 1er mai 1942, trois jeunes de l'Organisation Spéciale (Etienne Drujon, Roger Visse et Robert Georgelin) incendièrent un hangar à avions sur l'aérodrome. La Feldgendarmerie procéda à des arrestations à Compiègne et Margny-lès-Compiègne les 15 et 17 juillet 1943. Elle procéda par la suite à l'arrestation de Marcel Guérin le 3 mai 1944 et d'Eugène Fournival le 13 juin 1944. La Résistance poursuivit ses actions avec, le 21 juillet 1944, le sabotage du groupe électrogène de l'usine Thomas-Essertier de Margny. LES BOMBARDEMENTS La ville connut onze bombardements notamment en mai 1940 et durant l'été 1944. Les principales cibles de l'aviation furent, à Compiègne, le pont de Soissons, le pont de l'Oise, la gare et la voie ferrée. Certains bombardements touchèrent aussi Margny-lès-Compiègne, ville cheminote. Si ceux du 21 juin et du 9 août 1944 ne firent pas de victimes, ceux des 16 et 17 août 1944 tuèrent onze Margnotins. Le 31 août, veille de la libération de la ville par les Américains, des convois allemands circulant sur l'axe principal furent mitraillés. A l'issue de la guerre, le nombre d'habitants tués lors des bombardements fut estimé à trente. Outre les seize soldats morts au champ d'honneur, dix autres hommes sont décédés en déportation. Au total, cinquante-six Margnotins sont morts durant le conflit. La Croix de Guerre avec étoile d'argent fut remise à la ville de Margny-lès-Compiègne le 8 mai 1949 dans le parc de la mairie par le sous-préfet de Compiègne, M. Patoux, en présence du sénateur Bouquerel, du député Legendre, du conseiller général Gand et du maire Gracin CITATIO N
UNE RESISTANCE ACTIVE Avec le Régime de Vichy, un nouveau conseil municipal fut nommé, le radical socialiste Maurice Lambert conservant son poste de maire. Si le communiste André Ameuil fut arrêté le 16 juillet 1941 puis libéré, le conseiller municipal Maurice Simbozelle fut démis de ses fonctions en août suivant pour avoir critiqué le gouvernement. La Résistance fut active très tôt. Début 1941, un groupe se forma sur Compiègne et Margny-lès-Compiègne. Rattachés au réseau Hector du mouvement Combat, les membres du “Bataillon de France” constituèrent des dépôts d'armes, diffusèrent des tracts, recherchèrent des renseignements sur les troupes d'occupation et sabotèrent les liaisons de communication. Dénoncé par le traître Jacques Desoubrie, le groupe fut arrêté les 3 et 4 mars puis le 17 avril 1942, interrogé puis interné à Fresnes. Si Georges Fouquoire fut relâché pour raison de santé, les autres membres furent transférés en Allemagne le 17 septembre 1943et jugés en octobre suivant par le tribunal du peuple. Georges Bechon et Alfred Vervin décédèrent avant le procès. Gualbert Flandrin, Alexandre Gandoin, Gabriel Clara, Michel Edvire, Christian Héraude, Abel Laville, Robert Héraude, Auguste Vandendriesche et Georges Tainturier furent décapités à la hache le 7 décembre 1943. Pierre Bourson, Robert Toustou et François Claux décédèrent en déportation. Maurice Rousselet et René Nicot survécurent. Malgré la répression allemande, les actions de la Résistance se poursuivirent. Ainsi, le 1er mai 1942, trois jeunes de l'Organisation Spéciale (Etienne Drujon, Roger Visse et Robert Georgelin) incendièrent un hangar à avions sur l'aérodrome. La Feldgendarmerie procéda à des arrestations à Compiègne et Margny-lès-Compiègne les 15 et 17 juillet 1943. Elle procéda par la suite à l'arrestation de Marcel Guérin le 3 mai 1944 et d'Eugène Fournival le 13 juin 1944. La Résistance poursuivit ses actions avec, le 21 juillet 1944, le sabotage du groupe électrogène de l'usine Thomas-Essertier de Margny. LES BOMBARDEMENTS La ville connut onze bombardements notamment en mai 1940 et durant l'été 1944. Les principales cibles de l'aviation furent, à Compiègne, le pont de Soissons, le pont de l'Oise, la gare et la voie ferrée. Certains bombardements touchèrent aussi Margny-lès-Compiègne, ville cheminote. Si ceux du 21 juin et du 9 août 1944 ne firent pas de victimes, ceux des 16 et 17 août 1944 tuèrent onze Margnotins. Le 31 août, veille de la libération de la ville par les Américains, des convois allemands circulant sur l'axe principal furent mitraillés. A l'issue de la guerre, le nombre d'habitants tués lors des bombardements fut estimé à trente. Outre les seize soldats morts au champ d'honneur, dix autres hommes sont décédés en déportation. Au total, cinquante-six Margnotins sont morts durant le conflit. La Croix de Guerre avec étoile d'argent fut remise à la ville de Margny-lès-Compiègne le 8 mai 1949 dans le parc de la mairie par le sous-préfet de Compiègne, M. Patoux, en présence du sénateur Bouquerel, du député Legendre, du conseiller général Gand et du maire Gracin CITATIO N 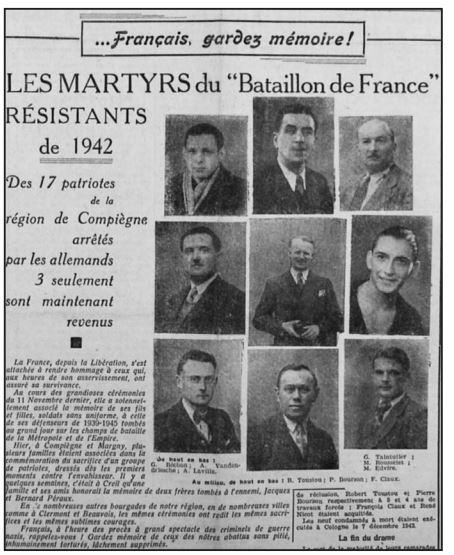 . Citation à l'ordre de la Division “ Bombardée par avions à 11 reprises, a fait preuve, malgré ses deuils et ses ruines, d'une inébranlable confiance dans les destinées du pays. A lutté contre l'occupant de toutes ses forces et de toute sa volonté, a participé malgré les menaces de représailles, à l'évasion et à l'accueil de nombreux déportés du camp de Royallieu. A perdu 56 de ses habitants : 16 au champ d'honneur, 30 par bombardements, 10 en déportation. Déjà citée au titre de la Guerre 1914- 1918.”
. Citation à l'ordre de la Division “ Bombardée par avions à 11 reprises, a fait preuve, malgré ses deuils et ses ruines, d'une inébranlable confiance dans les destinées du pays. A lutté contre l'occupant de toutes ses forces et de toute sa volonté, a participé malgré les menaces de représailles, à l'évasion et à l'accueil de nombreux déportés du camp de Royallieu. A perdu 56 de ses habitants : 16 au champ d'honneur, 30 par bombardements, 10 en déportation. Déjà citée au titre de la Guerre 1914- 1918.”
VERNEUIL EN HALATTE
UNE BASE AERIENNE Début juin 1940, l'invasion du département de l'Oise jeta les habitants de Verneuil (aujourd'hui Verneuil-en-Halatte) sur les routes de l'exode. Envahi par Fleurines, le village passa aux mains des Allemands qui réquisitionnèrent la mairie, l'école ainsi que quinze hectares du parc du château pour former, avec d'autres terrains situés à Creil, Apremont et Aumont, un vaste ensemble de 350 hectares (carte de la zone interdite en décembre 1941). Le petit aérodrome de la commune, établie durant la Première Guerre mondiale, fut ainsi aménagé par l'organisation Todt pour former un terrain d'aviation militaire pourvu, dès l'été 1940, de deux pistes bétonnées longues de 1700 mètres et larges de 49. Cette base allemande fut utilisée lors de la Bataille d'Angleterre. Devenu quartier général allemand, le château (XIXe siècle) fut peint en noir. Une salle de divertissement fut construite à proximité pour les loisirs des aviateurs tandis que des bunkers étaient maçonnés sur les hauteurs. L'aviation alliée bombarda à de nombreuses reprises la base aérienne allemande de Verneuil. L'armée allemande mina la base lors de son repli, en août 1944. L'aviation américaine occupa les lieux jusqu'en 1946. Le site devint par la suite la Base Aérienne 110. Citation à l'ordre du Régiment “ Commune essentiellement agricole, qui a souffert de nombreux bombardements en raison de la proximité du terrain d'aviation occupé par les Allemands. Malgré les dangers constants, les habLitants de cette petite commune sont demeurés courageusement à leur poste, freinant ainsi les réquisitions, et, de ce fait, l'extension plus rapide du terrain d'aviation. Treize habitants tués, dix-sept blessés au cours des opérations de guerre.” Une base aérienne Mutilé par les troupes allemandes en 1942, le monument aux morts de Verneuil-en-Halatte, orné d’un coq piétinant l’aigle impérial, fut reconstruit en 1946 LE MERITE ET LES SOUFFRANCES La remise de la Croix de Guerre eut lieu dans l'après-midi du dimanche 18 février 1951. Le rendez-vous avait été donné sur la place de l'église où les personnalités invitées se retrouvèrent après le banquet servi dans l'école des garçons. M. Marchois, maire de Verneuil, était entouré du préfet de l'Oise M. Cuttoli, du sous-préfet de Senlis M. Deliau, du conseiller général M. Firmin, de plusieurs maires de communes voisines, de nombreux invités de la société civile. Le préfet prit la parole : “(…) Verneuil, comme tant d'autres, n'a pas été épargnée. Elle a souffert des conséquences de la guerre et de l'invasion. La citation qu'on lui a décernée exprime bien le mérite et les souffrances de cette commune. Elle relate les pertes en vies humaines et les destructions matérielles, la dignité et l'esprit de résistance de la population. Je voudrais que nous élevions nos pensées vers tous ceux qui pendant cette sombre période, ont lutté, ont souffert, et sont morts pour la France. Et je voudrais aussi que les Forces de Paix, qui sont nombreuses dans le monde, l'emportent sur les puissances ténébreuses qui désirent la guerre, afin que nous ne voyions plus les cataclysmes qui ont ensanglanté notre douce Patrie ”. Après avoir lu la citation, le préfet épingla la Croix de Guerre sur un coussin brodé aux couleurs nationales tandis que l'harmonie des établissements Francolor exécutait la Marseillaise. Peu après, le cortège se rendit devant le monument aux morts où le maire et le préfet déposèrent un coussin fleuri. A l'issue de la cérémonie, la passerelle “Jean Biondi”, construite par la Société des Téléfériques Français et reliant Verneuil à Villers-Saint-Paul fut inaugurée, le mérite et les souffrances de la commune La remise de la Croix de Guerre eut lieu dans l'après-midi du dimanche 18 février 1951. Le rendez-vous avait été donné sur la place de l'église où les personnalités invitées se retrouvèrent après le banquet servi dans l'école des garçons. M. Marchois, maire de Verneuil, était entouré du préfet de l'Oise M. Cuttoli, du sous-préfet de Senlis M. Deliau, du conseiller général M. Firmin, de plusieurs maires de communes voisines, de nombreux invités de la société civile. Le préfet prit la parole : “(…) Verneuil, comme tant d'autres, n'a pas été épargnée. Elle a souffert des conséquences de la guerre et de l'invasion. La citation qu'onL lui a décernée exprime bien le mérite et les souffrances de cette commune. Elle relate les pertes en vies humaines et les destructions matérielles, la dignité et l'esprit de résistance de la population. Je voudrais que nous élevions nos pensées vers tous ceux qui pendant cette sombre période, ont lutté, ont souffert, et sont morts pour la France. Et je voudrais aussi que les Forces de Paix, qui sont nombreuses dans le monde, l'emportent sur les puissances ténébreuses qui désirent la guerre, afin que nous ne voyions plus les cataclysmes qui ont ensanglanté notre douce Patrie ”. Après avoir lu la citation, le préfet épingla la Croix de Guerre sur un coussin brodé aux couleurs nationales tandis que l'harmonie des établissements Francolor exécutait la Marseillaise. Peu après, le cortège se rendit devant le monument aux morts où le maire et le préfet déposèrent un coussin fleuri. A l'issue de la cérémonie, la passerelle “Jean Biondi”, construite par la Société des Téléfériques Français et reliant Verneuil à Villers-Saint-Paul fut inaugurée CITATION Citation à l'ordre du Régiment Commune essentiellement agricole, qui a souffert de nombreux bombardement en raison de la proximité du terrain d'aviation occupé par les Allemands. Malgré les dangers constants, les habitants de cette petite commune sont demeurés courageusement à leur poste, freinant ainsi les réquisitions, et, de ce fait, l'extension plus rapide du terrain d'aviation ,Treize habitants tués, dix-sept blessés au cours des opérations de guerre.
.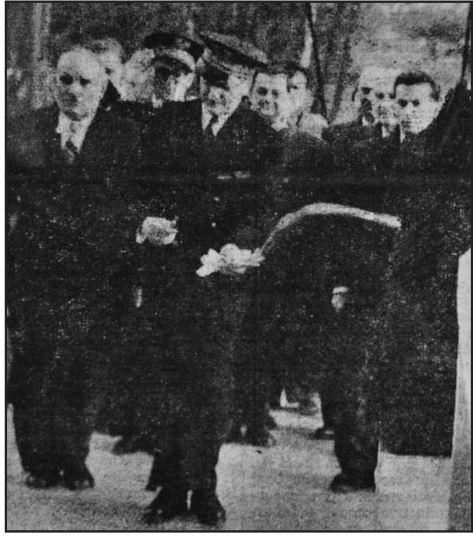
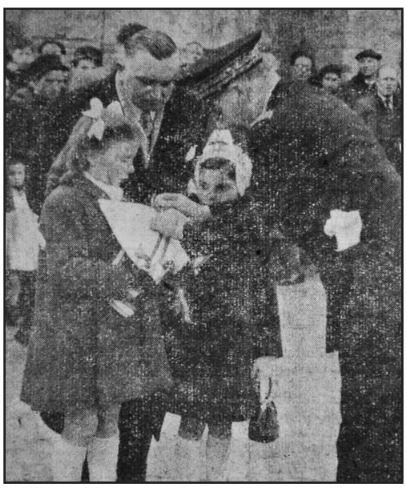

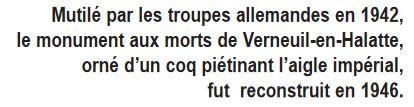
BEAUVAIS
CITATION A L ODRE DE L ARMEE Citation à l'ordre de l'Armée “ Ville dont le patriotisme et l'esprit de résistance à l'ennemi se sont affirmés au cours des siècles. Déjà titulaire de la Croix de Guerre 1914-1918, est restée égale à elle-même pendant la dernière guerre. Victime en mai-juin 1940 de violents bombardements allemands qui détruisirent 2700 immeubles, soit près de la moitié de la cité, et tuèrent des centaines d'habitants. Soumise à la même épreuve en 1943 et 1944, a conservé pendant toute la guerre sa foi agissante en la Patrie et en la Victoire. Fidèle à sa tradition, a fourni à la lutte clandestine contre l'ennemi la contribution efficace et continue de ses groupes résistants, sans se laisser décourager par l'internement et la déportation de son maire et de nombre de ses habitants. A, par son traditionnel patriotisme et ses épreuves, mérité de la reconnaissance du Pays.” UNE VILLE DETRUITE Avec la mobilisation générale, le 1er septembre 1939, le maire de Beauvais, Charles Desgroux fut envoyé sous les drapeaux comme bon nombre d'hommes. Le chef-lieu du département de l’Oise concentrant pouvoirs politique, administratif et militaire fut protégé par une Défense Contre-Avions installée sur l’aérodrome de Tillé. Dès les 20 et 21 mai 1940, Beauvais fut la proie des premiers bombardements allemands. Le préfet Maurice Mathieu lança alors l’ordre d’évacuation. Il fut remplacé deux jours plus tard par le préfet Paul Vacquier tandis qu’un contre -ordre d’évacuation était lancé sur les ondes. Entre le 4 et le 8 juin, de nouveaux bombardements provoquèrent la destruction des maisons médiévales du centre-ville, en grande partie composées de bois. Ne restaient place Jeanne Hachette que la façade de l'hôtel de ville et la statue de l'héroïne de Beauvais. L’occupation allemande commença le 10 juin dans une ville en ruines. Sur les 4250 habitations de la ville, 1978 étaient détruites et 750 partiellement endommagées. La municipalité travailla alors à déblayer les décombres, restaurer les réseaux d’eau et d’électricité, pourvoir à l’approvisionnement des habitants. De nombreux baraquements furent installés pour loger les 2000 habitants (au Jeu de Paume et au Franc Marché) et les 350 commerçants sans abri (place de l’Hôtel-de-Ville). Les travaux de déblaiement s’achevèrent début 1942. Le plan d’urbanisme, dessiné par Albert Parenty en 1927, fut réécrit par l’architecte Georges Noël et approuvé en mai 1942. L’année suivante, le 6 février 1943, les communes de Marissel, Notre-Dame-du-Thil, Saint Just-des-Marais et Voisinlieu furent réunies à Beauvais. La guerre se poursuivant, les travaux de reconstruction ne commencèrent qu’après 1945 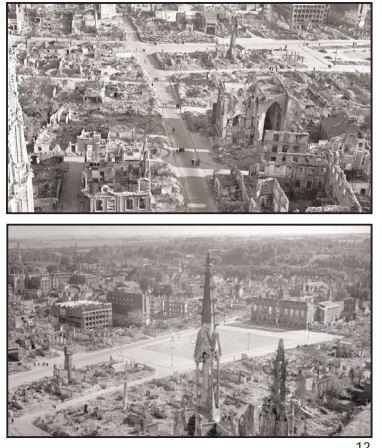 LA RESISTANCE A L OCCUPANT De par son statut de siège de la préfecture, Beauvais fut le relais départemental des décisions du gouvernement de Vichy. Le 7 novembre 1942, le préfet Paul Vacquier, jugé trop bienveillant envers les anciens élus du Front Populaire, fut remplacé par Georges Malick. Pour autant, des fonctionnaires de la préfecture participeront à la Résistance à l’instar du secrétaire général Guy Malines, révoqué en mai 1944 et entré en clandestinité. Beauvais devint le siège de la Feldkommandantur 638 en juin 1940, sous l’autorité du colonel Von Alberti, remplacée par une Kreiskommandantur en mars 1941 dirigée par le capitaine Mayer. La Feldkommandanture fut rétablie en juin 1942, avec pour chef les lieutenant-colonels Paechter puis Petri. Des réseaux de résistance se développèrent à Beauvais, notamment Confrérie Notre-Dame (CND) et Alliance, œuvrant à renseigner les Alliés des mouvements ennemis, mais aussi fabriquer des fauxpapiers, cacher des aviateurs et organiser des missions pick-up en lien avec le Bureau des Opérations Aériennes (BOA). L’agence de Beauvais du CND eut à sa tête Louis Prache puis Marcelle Geudelin. Démantelée dans l’Oise en juillet et novembre 1943, plusieurs de ses membres furent déportés. En parallèle, des mouvements de Résistance s’organisèrent pour mener des actions de contre-propagande, de sabotage... notamment le détachement FTP Jeanne- d’Arc (désorganisé en octobre 1943), le détachement FTP Jeanne Hachette (démantelé en janvier 1943)Libé-Nord et l’Organisation Civile et Militaire (OCM) dont Pierre Chardeaux, futur membre du Comité départemental de Libération. Les Allemands ou la police de Vichy utilisèrent la caserne Agel comme lieu de détention de résistants de l'Oise. Cet internement était précédé d'interrogatoires musclés et de tortures. Suivait la déportation au départ de Royallieu . Marcelle Geudelin (1896-1945) Fille et femme d’industriels et de conseillers généraux, membre du comité d’assistance aux prisonniers de guerre, elle entra au CND qu’elle anima à Beauvais. Elle fut déportée à Ravensbrück Louis Prache (1899-1979) Pilote d’avion durant la Grande Guerre, ingénieur électricien dans le civil, il entra au réseau F2 en novembre 1941 puis au CND en mars 1942 via Roger Hérissé. Il rejoignit Londres lors du démantèlement du réseau et participa à la reconquête du territoire dans l’armée Patton après avoir été parachuté en France. BOMBARDEMENTS ET LIBERATION A partir de septembre 1943, la gare (dépôt de machines, voies de garage), les ponts et l'aérodrome de Beauvais-Tillé furent la proie de bombardements alliés, provoquant de nombreuses victimes. Le septième bombardement de la ville, le 14 septembre 1943, toucha les quartiers nord, tuant 21 personnes et en blessant 35 autres. Les raids alliés s’accentuèrent avec la préparation du Débarquement. Les infrastructures ferroviaires et routières furent alors les cibles principales avec l’aérodrome de Tillé. Le vingt-neuvième bombardement, le 24 juin 1944, tua 23 personnes et en blessa 23 autres dans le quartier de la gare. Le 30 août 1944, les troupes britanniques poussèrent leur avance dans le sud ouest du département vers Beauvais. La ville fut libérée par la 8e Brigade blindée britannique sans rencontrer de résistance allemande. Les FFI Louis Pot et Henri Gaudichet furent tués dans les opérations de nettoyage menées dans la ville A partir de septembre 1943, la gare (dépôt de machines, voies de garage), les ponts et l'aérodrome de Beauvais-Tillé furent la proie de bombardements alliés, provoquant de nombreuses victimes. Le septième bombardement de la ville, le 14 septembre 1943, toucha les quartiers nord, tuant 21 personnes et en blessant 35 autres. Les raids alliés s’accentuèrent avec la préparation du Débarquement. Les infrasructures ferroviaires et routières furent alors les cibles principales avec l’aérodrome de Tillé. Le vingt-neuvième bombardement, le 24 juin 1944, tua 23 personnes et en blessa 23 autres dans le quartier de la gare. Le 30 août 1944, les troupes britanniques poussèrent leur avance dans le sudouest du département vers Beauvais. La ville fut libérée par la 8e Brigade blindée britannique sans rencontrer de résistance allemande. Les FFI Louis Pot et Henri Gaudichet furent tués dans les opérations de nettoyage menées dans la ville.A partir de septembre 1943, la gare (dépôt de machines, voies de garage), les ponts et l'aérodrome de Beauvais-Tillé furent la proie de bombardements alliés, provoquant de nombreuses victimes. Le septième bombardement de la ville, le 14 septembre 1943, toucha les quartiers nord, tuant 21 personnes et en blessant 35 autres. Les raids alliés s’accentuèrent avec la préparation du Débarquement. Les infrastrutures ferroviaires et routières furent alors les cibles principales avec l’aérodrome de Tillé. Le vingt-neuvième bombardement, le 24 juin 1944, tua 23 personnes et en blessa 23 autres dans le quartier de la gare. Le 30 août 1944, les troupes britanniques poussèrent leur avance dans le sudouest du département vers Beauvais. La ville fut libérée par la 8e Brigade blindée britannique sans rencontrer de résistance allemande. Les FFI Louis Pot et Henri Gaudichet furent tués dans les opérations de nettoyage menées dans la ville.A partir de septembre 1943, la gare (dépôt de machines, voies de garage), les ponts et l'aérodrome de Beauvais-Tillé furent la proie de bombardements alliés, provoquant de nombreuses victimes. Le septième bombardement de la ville, le 14 septembre 1943, toucha les quartiers nord, tuant 21 personnes et en blessant 35 autres. Les raids alliés s’accentuèrent avec la préparation du Débarquement. Les infrastrutures ferroviaires et routières furent alors les cibles principales avec l’aérodrome de Tillé. Le vingt-neuvième bombardement, le 24 juin 1944, tua 23 personnes et en blessa 23 autres dans le quartier de la gare. Le 30 août 1944, les troupes britanniques poussèrent leur avance dans le sudouest du département vers Beauvais. La ville fut libérée par la 8e Brigade blindée britannique sans rencontrer de résistance allemande. Les FFI Louis Pot et Henri Gaudichet furent tués dans les opérations de nettoyage menées dans la ville.A partir de septembre 1943, la gare (dépôt de machines, voies de garage), les ponts et l'aérodrome de Beauvais-Tillé furent la proie de bombardements alliés, provoquant de nombreuses victimes. Le septième bombardement de la ville, le 14 septembre 1943, toucha les quartiers nord, tuant 21 personnes et en blessant 35 autres. Les raids alliés s’accentuèrent avec la préparation du Débarquement. Les infrastructures ferroviaires et routières furent alors les cibles principales avec l’aérodrome de Tillé. Le vingt-neuvième bombardement, le 24 juin 1944, tua 23 personnes et en blessa 23 autres dans le quartier de la gare. Le 30 août 1944, les troupes britanniques poussèrent leur avance dans le sud ouest du département vers Beauvais. La ville fut libérée par la 8e Brigade blindée britannique sans rencontrer de résistance allemande. Les FFI Louis Pot et Henri Gaudichet furent tués dans les opérations de nettoyage menées dans la ville .A partir de septembre 1943, la gare (dépôt de machines, voies de garage), les ponts et l'aérodrome de Beauvais-Tillé furent la proie de bombardements alliés, provoquant de nombreuses victimes. Le septième bombardement de la ville, le 14 septembre 1943, toucha les quartiers nord, tuant 21 personnes et en blessant 35 autres. Les raids alliés s’accentuèrent avec la préparation du Débarquement. Les infrastructures ferroviaires et routières furent alors les cibles principales avec l’aérodrome de Tillé. Le vingt-neuvième bombardement, le 24 juin 1944, tua 23 personnes et en blessa 23 autres dans le quartier de la gare. Le 30 août 1944, les troupes britanniques poussèrent leur avance dans le sud ouest du département vers Beauvais. La ville fut libérée par la 8e Brigade blindée britannique sans rencontrer de résistance allemande. Les FFI Louis Pot et Henri Gaudichet furent tués dans les opérations de nettoyage menées dans la ville. CROIX DE GUERRE ET LEGION D HONNEUR Le 25 août 1949, le général Koenig vint remettre la Croix de Guerre à la ville de Beauvais, en présence du général Chevillon, commandant la 2e Région militaire, du général Warabiot et du sénateur maire Robert Séné. Une tribune officielle avait été aménagée, formée d’un portique rappelant la Grèce antique, décoré des armes de la ville et de la Croix de Guerre sur un fond de velours bleu. Koenig décora plusieurs résistants (dont Louis Prache), et épingla la médaille sur un coussin aux armes de la ville porté par trois orphelins de guerre dont la fille de M. Violette. Le 24 novembre 1957, le décret du 11 novembre 1948 attribuant la Croix de Guerre à Beauvais fut annulé. Il accorda à la ville dans la même cit
LA RESISTANCE A L OCCUPANT De par son statut de siège de la préfecture, Beauvais fut le relais départemental des décisions du gouvernement de Vichy. Le 7 novembre 1942, le préfet Paul Vacquier, jugé trop bienveillant envers les anciens élus du Front Populaire, fut remplacé par Georges Malick. Pour autant, des fonctionnaires de la préfecture participeront à la Résistance à l’instar du secrétaire général Guy Malines, révoqué en mai 1944 et entré en clandestinité. Beauvais devint le siège de la Feldkommandantur 638 en juin 1940, sous l’autorité du colonel Von Alberti, remplacée par une Kreiskommandantur en mars 1941 dirigée par le capitaine Mayer. La Feldkommandanture fut rétablie en juin 1942, avec pour chef les lieutenant-colonels Paechter puis Petri. Des réseaux de résistance se développèrent à Beauvais, notamment Confrérie Notre-Dame (CND) et Alliance, œuvrant à renseigner les Alliés des mouvements ennemis, mais aussi fabriquer des fauxpapiers, cacher des aviateurs et organiser des missions pick-up en lien avec le Bureau des Opérations Aériennes (BOA). L’agence de Beauvais du CND eut à sa tête Louis Prache puis Marcelle Geudelin. Démantelée dans l’Oise en juillet et novembre 1943, plusieurs de ses membres furent déportés. En parallèle, des mouvements de Résistance s’organisèrent pour mener des actions de contre-propagande, de sabotage... notamment le détachement FTP Jeanne- d’Arc (désorganisé en octobre 1943), le détachement FTP Jeanne Hachette (démantelé en janvier 1943)Libé-Nord et l’Organisation Civile et Militaire (OCM) dont Pierre Chardeaux, futur membre du Comité départemental de Libération. Les Allemands ou la police de Vichy utilisèrent la caserne Agel comme lieu de détention de résistants de l'Oise. Cet internement était précédé d'interrogatoires musclés et de tortures. Suivait la déportation au départ de Royallieu . Marcelle Geudelin (1896-1945) Fille et femme d’industriels et de conseillers généraux, membre du comité d’assistance aux prisonniers de guerre, elle entra au CND qu’elle anima à Beauvais. Elle fut déportée à Ravensbrück Louis Prache (1899-1979) Pilote d’avion durant la Grande Guerre, ingénieur électricien dans le civil, il entra au réseau F2 en novembre 1941 puis au CND en mars 1942 via Roger Hérissé. Il rejoignit Londres lors du démantèlement du réseau et participa à la reconquête du territoire dans l’armée Patton après avoir été parachuté en France. BOMBARDEMENTS ET LIBERATION A partir de septembre 1943, la gare (dépôt de machines, voies de garage), les ponts et l'aérodrome de Beauvais-Tillé furent la proie de bombardements alliés, provoquant de nombreuses victimes. Le septième bombardement de la ville, le 14 septembre 1943, toucha les quartiers nord, tuant 21 personnes et en blessant 35 autres. Les raids alliés s’accentuèrent avec la préparation du Débarquement. Les infrastructures ferroviaires et routières furent alors les cibles principales avec l’aérodrome de Tillé. Le vingt-neuvième bombardement, le 24 juin 1944, tua 23 personnes et en blessa 23 autres dans le quartier de la gare. Le 30 août 1944, les troupes britanniques poussèrent leur avance dans le sud ouest du département vers Beauvais. La ville fut libérée par la 8e Brigade blindée britannique sans rencontrer de résistance allemande. Les FFI Louis Pot et Henri Gaudichet furent tués dans les opérations de nettoyage menées dans la ville A partir de septembre 1943, la gare (dépôt de machines, voies de garage), les ponts et l'aérodrome de Beauvais-Tillé furent la proie de bombardements alliés, provoquant de nombreuses victimes. Le septième bombardement de la ville, le 14 septembre 1943, toucha les quartiers nord, tuant 21 personnes et en blessant 35 autres. Les raids alliés s’accentuèrent avec la préparation du Débarquement. Les infrasructures ferroviaires et routières furent alors les cibles principales avec l’aérodrome de Tillé. Le vingt-neuvième bombardement, le 24 juin 1944, tua 23 personnes et en blessa 23 autres dans le quartier de la gare. Le 30 août 1944, les troupes britanniques poussèrent leur avance dans le sudouest du département vers Beauvais. La ville fut libérée par la 8e Brigade blindée britannique sans rencontrer de résistance allemande. Les FFI Louis Pot et Henri Gaudichet furent tués dans les opérations de nettoyage menées dans la ville.A partir de septembre 1943, la gare (dépôt de machines, voies de garage), les ponts et l'aérodrome de Beauvais-Tillé furent la proie de bombardements alliés, provoquant de nombreuses victimes. Le septième bombardement de la ville, le 14 septembre 1943, toucha les quartiers nord, tuant 21 personnes et en blessant 35 autres. Les raids alliés s’accentuèrent avec la préparation du Débarquement. Les infrastrutures ferroviaires et routières furent alors les cibles principales avec l’aérodrome de Tillé. Le vingt-neuvième bombardement, le 24 juin 1944, tua 23 personnes et en blessa 23 autres dans le quartier de la gare. Le 30 août 1944, les troupes britanniques poussèrent leur avance dans le sudouest du département vers Beauvais. La ville fut libérée par la 8e Brigade blindée britannique sans rencontrer de résistance allemande. Les FFI Louis Pot et Henri Gaudichet furent tués dans les opérations de nettoyage menées dans la ville.A partir de septembre 1943, la gare (dépôt de machines, voies de garage), les ponts et l'aérodrome de Beauvais-Tillé furent la proie de bombardements alliés, provoquant de nombreuses victimes. Le septième bombardement de la ville, le 14 septembre 1943, toucha les quartiers nord, tuant 21 personnes et en blessant 35 autres. Les raids alliés s’accentuèrent avec la préparation du Débarquement. Les infrastrutures ferroviaires et routières furent alors les cibles principales avec l’aérodrome de Tillé. Le vingt-neuvième bombardement, le 24 juin 1944, tua 23 personnes et en blessa 23 autres dans le quartier de la gare. Le 30 août 1944, les troupes britanniques poussèrent leur avance dans le sudouest du département vers Beauvais. La ville fut libérée par la 8e Brigade blindée britannique sans rencontrer de résistance allemande. Les FFI Louis Pot et Henri Gaudichet furent tués dans les opérations de nettoyage menées dans la ville.A partir de septembre 1943, la gare (dépôt de machines, voies de garage), les ponts et l'aérodrome de Beauvais-Tillé furent la proie de bombardements alliés, provoquant de nombreuses victimes. Le septième bombardement de la ville, le 14 septembre 1943, toucha les quartiers nord, tuant 21 personnes et en blessant 35 autres. Les raids alliés s’accentuèrent avec la préparation du Débarquement. Les infrastructures ferroviaires et routières furent alors les cibles principales avec l’aérodrome de Tillé. Le vingt-neuvième bombardement, le 24 juin 1944, tua 23 personnes et en blessa 23 autres dans le quartier de la gare. Le 30 août 1944, les troupes britanniques poussèrent leur avance dans le sud ouest du département vers Beauvais. La ville fut libérée par la 8e Brigade blindée britannique sans rencontrer de résistance allemande. Les FFI Louis Pot et Henri Gaudichet furent tués dans les opérations de nettoyage menées dans la ville .A partir de septembre 1943, la gare (dépôt de machines, voies de garage), les ponts et l'aérodrome de Beauvais-Tillé furent la proie de bombardements alliés, provoquant de nombreuses victimes. Le septième bombardement de la ville, le 14 septembre 1943, toucha les quartiers nord, tuant 21 personnes et en blessant 35 autres. Les raids alliés s’accentuèrent avec la préparation du Débarquement. Les infrastructures ferroviaires et routières furent alors les cibles principales avec l’aérodrome de Tillé. Le vingt-neuvième bombardement, le 24 juin 1944, tua 23 personnes et en blessa 23 autres dans le quartier de la gare. Le 30 août 1944, les troupes britanniques poussèrent leur avance dans le sud ouest du département vers Beauvais. La ville fut libérée par la 8e Brigade blindée britannique sans rencontrer de résistance allemande. Les FFI Louis Pot et Henri Gaudichet furent tués dans les opérations de nettoyage menées dans la ville. CROIX DE GUERRE ET LEGION D HONNEUR Le 25 août 1949, le général Koenig vint remettre la Croix de Guerre à la ville de Beauvais, en présence du général Chevillon, commandant la 2e Région militaire, du général Warabiot et du sénateur maire Robert Séné. Une tribune officielle avait été aménagée, formée d’un portique rappelant la Grèce antique, décoré des armes de la ville et de la Croix de Guerre sur un fond de velours bleu. Koenig décora plusieurs résistants (dont Louis Prache), et épingla la médaille sur un coussin aux armes de la ville porté par trois orphelins de guerre dont la fille de M. Violette. Le 24 novembre 1957, le décret du 11 novembre 1948 attribuant la Croix de Guerre à Beauvais fut annulé. Il accorda à la ville dans la même cit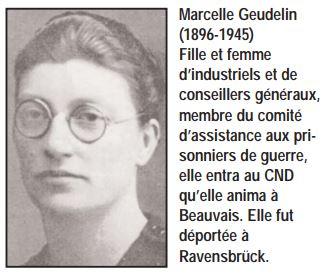 ation la Légion d’Honneur et la Croix de Guerre avec palme de bronze
ation la Légion d’Honneur et la Croix de Guerre avec palme de bronze 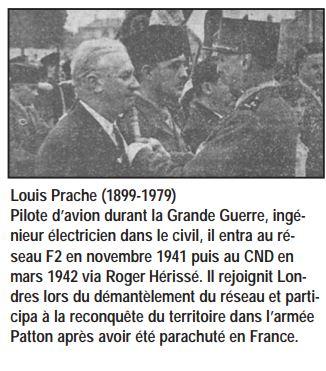
BRETEUIL
VILLE EN FEU Carrefour de communication, Breteuil, forte de 2 359 habitants à la veille de la guerre, était constituée d'un bâti ancien où les maisons à pan de bois dominaient. La ville devint un enjeu stratégique lorsque le général Frère, commandant la 7e Armée depuis le 17 mai 1940, installa son état major à l'Hôtel de France, lui permettant de diriger les combats dans le secteur d'Amiens et d'Abbeville où une tête de pont allemande s'était constituée. Deux jours plus tard, le 19 mai, jour des premières communions, la ville subit son premier bombardement qui se poursuivit le lendemain, tuant trois personnes rue Raoul Levasseur. Le PC du général Frère fut alors déplacé à Auneuil, au sud de Beauvais tandis que les premiers habitants prenaient la route de l'exode. Le 25 mai, plusieurs escadrilles allemandes survolèrent le centre-ville, larguant leurs bombes et tirant des balles incendiaires notamment place de Verdun. Une cinquantaine de maisons furent détruites rue de la République, une centaine d'autres rue Adrien Maître et rue Raoul Levavasseur par propagation du feu. Le lendemain, 26 mai, l'incendie commencé la veille reprit de la vigueur et consuma l'église et environ 300 maisons du centre ville. Le 31 mai, la 7e Armée reçut l'appui sur son flanc gauche de la 10e Armée nouvellement constituée afin de soutenir la défense de la ligne Somme-Aisne. L'offensive allemande sur la ligne Weygand, le 5 juin, appuyée par une forte artillerie et par l'aviation, provoqua une percée puis la dislocation de la 10e Armée française Placé dans le secteur de combat de la 4e Division d'Infanterie Coloniale, Breteuil connut alors un nouveau bombardement, le 7 juin après-midi, provoquant des ravages rue de Beauvais et rue des Ecoles. Au cours de cette journée, le maire, M. Huchez, et le lieutenant de pompiers Desquesne furent blessés ; à leurs côtés, M. Scaetjens était mort. Le lendemain, 8 juin, la ville où se cachaient une trentaine d'habitants, tombait aux mains allemandes. CITATION Citation à l'ordre du Corps d'Armée “ Petite cité sinistrée à 85% à la suite de nombreux et violents bombardements en 1940 ayant occasionné 23 morts et 11 blessés parmi sa population. Au cours de l'occupation allemande, a apporté une aide particulièrement efficace à la résistance, à l'évasion de prisonniers français et à l'hébergement de réfractaires et parachutistes alliés, ce qui lui a valu la déportation de deux de ses habitants morts dans les camps de concentration ennemis ” VIVRE DANS LES RUINES Sur 850 immeubles que comptait Breteuil en 1940, 475 étaient détruits et 95 endommagés. Tous les bâtiments publics étaient au sol hormis l'hôtel de ville, l'hospice et la gendarmerie. Commença alors le déblaiement et le nivellement des ruines puis la construction de baraquements. Les travaux de reconstruction ne commencèrent qu'en 1947 en suivant le plan de reconstruction et d'aménagement dessiné en 1941 par Georges Noël, architecte et urbaniste. Les habitants endurèrent aussi les conditions d'occupation qui purent conduire à des extrémités. En juillet 1941, le militant communiste Roger Cerveaux, typographe à l'Humanité, fut ainsi arrêté puis déporté un an plus tard par le convoi des 45 000 au départ de Compiègne à destination d'Auschwitz où il mourut le 15 septembre 1942. En avril 1944, René Dechaumont, natif de Breteuil, fut arrêté à Villers-Vicomte où il se cachait comme d'autres réfractaires au Service du Travail Obligatoire (STO). Arrêté pour avoir donné sa veste à un aviateur anglais, il décéda en déportation à Dachau le 28 avril 1945. Le 26 mai 1944, un employé de la SNCF fut tué par une sentinelle à l'entrée de la ville. Si, courant 1943 et début 1944, la voie ferrée passant par Breteuil put connaître des attaques par l'aviation alliée ou par la résistance, la gare subit plusieurs bombardements anglo-américains durant l'été 1944 notamment sur la gare le 20 mai, le 6 juin, le 8 juillet (un train de munitions touché) et le Dix ans jour pour jour après le grand bombardement de la ville, les habitants de Breteuil participèrent sur la place aux émouvantes cérémonies entourant la remise de la Croix de Guerre, sous le regard de M. Combes, premier adjoint au maire d'Orange, ville marraine de Breteuil. Ce 7 mai 1950, le drapeau des sapeurs-pompiers fut donné par le maire François Monnet au commandant Garbet. Le commandant Chauvet remit la Croix de Guerre à André Chagneau, ancien canonnier radio et agent de liaison durant la guerre. Ensuite, trois rues furent inaugurées, aux noms de Louis et Eugène Cappronnier, du général Leclerc et du général Frère, en présence de l'épouse de ce dernier. Puis l'ancien maire, Raoul Huchez, reçut la Légion d'Honneur des mains du ministre Jean Biondi, député maire de Creil, après que son premieradjoint François Monnet, devenu maire à son tour, ait retr13 août (mitraillage). Breteuil fut libéré le 31 août 1944 par les forces britanniques de la Division Blindée de la Garde UN JOUR SYMBOLIQUE 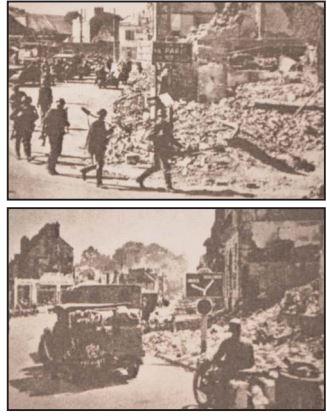
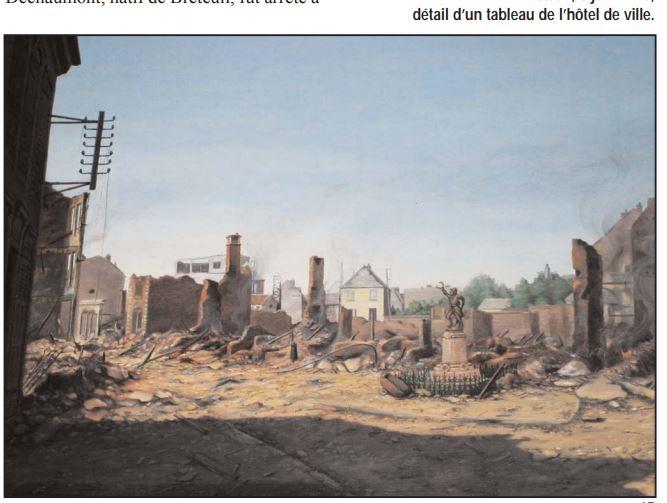 Dix ans jour pour jour après le grand bombardement de la ville, les habitants de Breteuil participèrent sur la place aux émouvantes cérémonies entourant la remise de la Croix de Guerre, sous le regard de M. Combes, premier adjoint au maire d'Orange, ville marraine de Breteuil. Ce 7 mai 1950, le drapeau des sapeurs-pompiers fut donné par le maire François Monnet au commandant Garbet. Le commandant Chauvet remit la Croix de Guerre à André Chagneau, ancien canonnier radio et agent de liaison durant la guerre. Ensuite, trois rues furent inaugurées, aux noms de Louis et Eugène Cappronnier, du général Leclerc et du général Frère, en présence de l'épouse de ce dernier. Puis l'ancien maire, Raoul Huchez, reçut la Légion d'Honneur des mains du ministre Jean Biondi, député maire de Creil, après que son premier adjoint François Monnet, devenu maire à son tour, ait retracé son parcours dans un récit émouvant matériellement ravagée, a su reprendre sa route” Enfin, le préfet Cuttoli lut la citation de la ville à l'ordre de l'Armée et épingla la Croix de Guerre sur un coussin porté par les jeunes Jean Dournel et Michèle Fortin, tous deux orphelins de guerre. Son discours rappela le coût des réparations à Breteuil (plus d'un milliard) et se conclut par ces mots : “La France, moralement disloquée et matériellement ravagée, a su reprendre sa route”.
Dix ans jour pour jour après le grand bombardement de la ville, les habitants de Breteuil participèrent sur la place aux émouvantes cérémonies entourant la remise de la Croix de Guerre, sous le regard de M. Combes, premier adjoint au maire d'Orange, ville marraine de Breteuil. Ce 7 mai 1950, le drapeau des sapeurs-pompiers fut donné par le maire François Monnet au commandant Garbet. Le commandant Chauvet remit la Croix de Guerre à André Chagneau, ancien canonnier radio et agent de liaison durant la guerre. Ensuite, trois rues furent inaugurées, aux noms de Louis et Eugène Cappronnier, du général Leclerc et du général Frère, en présence de l'épouse de ce dernier. Puis l'ancien maire, Raoul Huchez, reçut la Légion d'Honneur des mains du ministre Jean Biondi, député maire de Creil, après que son premier adjoint François Monnet, devenu maire à son tour, ait retracé son parcours dans un récit émouvant matériellement ravagée, a su reprendre sa route” Enfin, le préfet Cuttoli lut la citation de la ville à l'ordre de l'Armée et épingla la Croix de Guerre sur un coussin porté par les jeunes Jean Dournel et Michèle Fortin, tous deux orphelins de guerre. Son discours rappela le coût des réparations à Breteuil (plus d'un milliard) et se conclut par ces mots : “La France, moralement disloquée et matériellement ravagée, a su reprendre sa route”. 

CAUVIGNY
UN MAQUIS ACTIF En1944, le hameau de Château-Rouge, à Cauvigny, était le siège d'un groupe de résistants locaux placés sous la direction du fermier Marcel Stopin. Au début de juillet 1944, des jeunes FTP du d
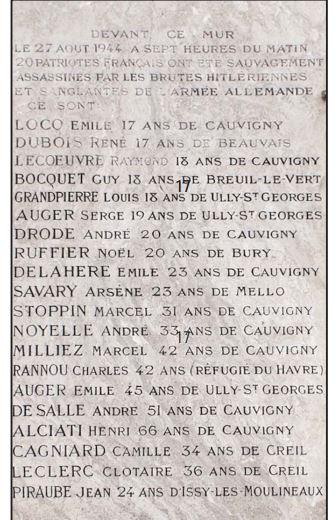
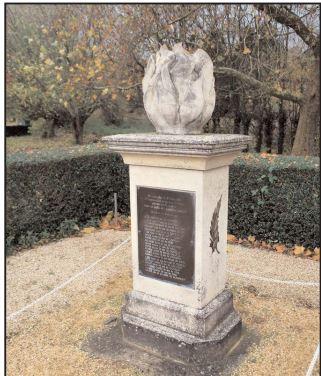 détachement Fournival créèrent, dans les bois proches du hameau, un maquis d'où ils menèrent des actions de sabotage et lancèrent des attaques contre les soldats allemands. Ainsi, le 15 août, une dizaine d'entre eux attaquèrent un convoi à Sainte Geneviève, mitraillèrent une voiture et incendièrent des remorques. Dix Allemands furent tués au cours de cette action. Dix jours plus tard, le 25 août, une embuscade dressée par dix-huit FTP près de la carrière en exploitation de Cauvigny permit de stopper une voiture allemande. Deux occupants furent tués et le troisième, blessé, fut emmené comme prisonnier dans une maison isolée du hameau de Château-Rouge Le lendemain, 26 août 1944, un avion de chasse allemand touché lors d'un combat aérien se posa près de Cauvigny. Les FTP intervinrent, firent prisonnier le pilote et incendièrent l'avion. Le pilote fut abattu dans la nuit tandis qu'il tentait de s'enfuir. L'ensemble de ces actions donna lieu à une terrible répression L ATTAQUE DU MA1QUIS ET LE MASSACRE Le matin du 27 août 1944, tandis que les forces alliées étaient aux portes du département de l'Oise, un détachement allemand encerclait le hameau de Château Rouge. Peu avant, dix maquisards étaient descendus de la forêt pour cacher deux prisonniers allemands dans les bâtiments de la colonie de vacances de l'abbé Séret située dans le hameau. A 6h45, les Allemands surgirent et bloquèrent tous les accès. Les lieutenants Dembrevalle et Roland parvinrent à s'échapper de la ferme de Marcel Stopin mais les autres FTP furent blessés dans leur fuite ou ne purent se replier. Mal armés, ils défendirent leur position attaquée par de nombreux soldats. Chargé de la garde des prisonniers, Noël Rufffier fut tué les armes à la main pendant l'assaut Les FTP blessés furent achevés sur place. Les deux prisonniers libérés, les Allemands détruisirent le local à l'aide de grenades incendiaires. Puis, ils regroupèrent la population civile devant la ferme Leroy-Omer, face au mur les mains en l'air, et leur commandant demanda à l'un des soldats libérés de désigner les hommes qui seraient passés par les armes. Douze hommes furent massacrés sur place, devant leur famille. Cachés dans les bois, les résistants FTP n'ouvrirent pas le feu pour ne pas mettre en péril les civils rassemblés. Une fosse commune fut alors creusée sur ordre afin d'inhumer les vingt corps sans vie. Cauvigny libéré, une exhumation fut réalisée le 9 septembre suivant et les cercueils furent placés dans la chapelle voisine jusqu'au 11 septembre, jour de l'inhumation finale. Une plaque rappelant les noms des vingt victimes fut scellée sur le mur de la ferme puis un monument fut érigé en face, au pied de la chapelle. CITATION Citation à l'ordre de la Division “ Le 27 août 1944, à la suite d'un coup de main effectué par un groupe de résistance au cours duquel deux soldats allemands furent tués et un troisième fait prisonnier, le hameau de Château rouge fut cerné par un détachement de SS et vingt hommes désignés comme otages furent fusillés sous les regards terrifiés des femmes et des enfants. La commune de Cauvigny a payé un large tribut à la cause de la Libération et a droit à la reconnaissance du pays.”
détachement Fournival créèrent, dans les bois proches du hameau, un maquis d'où ils menèrent des actions de sabotage et lancèrent des attaques contre les soldats allemands. Ainsi, le 15 août, une dizaine d'entre eux attaquèrent un convoi à Sainte Geneviève, mitraillèrent une voiture et incendièrent des remorques. Dix Allemands furent tués au cours de cette action. Dix jours plus tard, le 25 août, une embuscade dressée par dix-huit FTP près de la carrière en exploitation de Cauvigny permit de stopper une voiture allemande. Deux occupants furent tués et le troisième, blessé, fut emmené comme prisonnier dans une maison isolée du hameau de Château-Rouge Le lendemain, 26 août 1944, un avion de chasse allemand touché lors d'un combat aérien se posa près de Cauvigny. Les FTP intervinrent, firent prisonnier le pilote et incendièrent l'avion. Le pilote fut abattu dans la nuit tandis qu'il tentait de s'enfuir. L'ensemble de ces actions donna lieu à une terrible répression L ATTAQUE DU MA1QUIS ET LE MASSACRE Le matin du 27 août 1944, tandis que les forces alliées étaient aux portes du département de l'Oise, un détachement allemand encerclait le hameau de Château Rouge. Peu avant, dix maquisards étaient descendus de la forêt pour cacher deux prisonniers allemands dans les bâtiments de la colonie de vacances de l'abbé Séret située dans le hameau. A 6h45, les Allemands surgirent et bloquèrent tous les accès. Les lieutenants Dembrevalle et Roland parvinrent à s'échapper de la ferme de Marcel Stopin mais les autres FTP furent blessés dans leur fuite ou ne purent se replier. Mal armés, ils défendirent leur position attaquée par de nombreux soldats. Chargé de la garde des prisonniers, Noël Rufffier fut tué les armes à la main pendant l'assaut Les FTP blessés furent achevés sur place. Les deux prisonniers libérés, les Allemands détruisirent le local à l'aide de grenades incendiaires. Puis, ils regroupèrent la population civile devant la ferme Leroy-Omer, face au mur les mains en l'air, et leur commandant demanda à l'un des soldats libérés de désigner les hommes qui seraient passés par les armes. Douze hommes furent massacrés sur place, devant leur famille. Cachés dans les bois, les résistants FTP n'ouvrirent pas le feu pour ne pas mettre en péril les civils rassemblés. Une fosse commune fut alors creusée sur ordre afin d'inhumer les vingt corps sans vie. Cauvigny libéré, une exhumation fut réalisée le 9 septembre suivant et les cercueils furent placés dans la chapelle voisine jusqu'au 11 septembre, jour de l'inhumation finale. Une plaque rappelant les noms des vingt victimes fut scellée sur le mur de la ferme puis un monument fut érigé en face, au pied de la chapelle. CITATION Citation à l'ordre de la Division “ Le 27 août 1944, à la suite d'un coup de main effectué par un groupe de résistance au cours duquel deux soldats allemands furent tués et un troisième fait prisonnier, le hameau de Château rouge fut cerné par un détachement de SS et vingt hommes désignés comme otages furent fusillés sous les regards terrifiés des femmes et des enfants. La commune de Cauvigny a payé un large tribut à la cause de la Libération et a droit à la reconnaissance du pays.”
TROUSSENCOURT ET LAGNY
DES TIRS MEURTRIERS Petite commune de 250 habitants avant guerre, Troussencourt connut un bombardement tragique du fait de sa situation près de deux routes départementales menant à Breteuil. Tandis que l'offensive allemande enfonçait la ligne Weygand, le 5 juin 1940, la 4e Division d'Infanterie Coloniale défendait le secteur de Breteuil. Deux jours plus tard, le 7 juin 1940, Troussencourt subit un important bombardement qui fit neuf victimes civiles : Paul et Palmyre Gellée, Ernestine Dufour, Marie-Jeanne et Marguerite Marazanoff, André et Robert Mercier, Thérèse et Paul Caudron. Le lendemain, 8 juin, le front se rapprochant, les PC du général de la 16e DI et du chef du 12e Bataillon de Chars de Combat s'installèrent provisoirement dans le village avant de se replier. Troussencourt tomba aux mains allemandes le même jour. La commune connut une nouvelle tragédie le 28 août 1944. Ce jour-là, les troupes allemandes en repli traversèrent le village et tuèrent par balle Roger Mention agé de 44 ans L HOMMAGE AUX VICTIMES La Croix de Guerre fut remise à la commune par le préfet Maurice Cuttoli le dimanche 16 juillet 1950. La cérémonie se déroula en présence de M. Piani, sous-préfet de Clermont, des députés Biondi, Delahoutre et Brault, des sénateurs Séné et Bouquerel, du conseiller général Geffroy, de M. Lefèvre, maire et de son conseil municipal. Ce même jour, Jean Biondi, ancien ministre, inaugura la plaque du souvenir rappelant le sacrifice des victimes et la rue Roger Mention, victime des nazis en 1944. CITATION 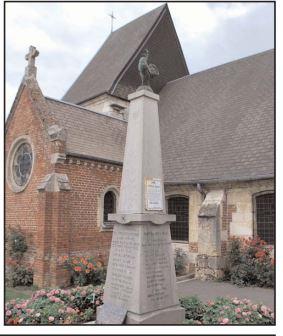
 Citation à l’ordre du Régiment “ Petite localité qui a subi de violents bombardements en 1940 causant la mort de douze habitants et détruisant ou endommageant cinquante habitations sur une centaine que comptait la commune. A lutté contre l'occupant avec énergie et courage .”
Citation à l’ordre du Régiment “ Petite localité qui a subi de violents bombardements en 1940 causant la mort de douze habitants et détruisant ou endommageant cinquante habitations sur une centaine que comptait la commune. A lutté contre l'occupant avec énergie et courage .”
LAGNY
DANS LES FLAMMES Le 7 juin 1940, après avoir combattu au sud d'Amiens, le 1er Bataillon du 7e Régiment d'Infanterie Coloniale occupa le secteur de Lagny, une “position facile à défendre” qui, selon le capitaine Forgeron, devait permettre de réaliser “d'excellents tirs de barrage” en raison de ses mouvements de terrain et de ses étendues plates. Le recul de la 7e Division d'Infanterie Coloniale, menacée sur ses flancs, imposa le repli du 7e RIC sur Mareuil-la-Motte. Lagny, proche des ponts du canal du Nord, fut alors pris sous le feu des bombardiers allemands faisant plusieurs victimes civiles. Le 8 juin, le 107e RI protégeant le repli de la division entra dans la commune en flammes, comme le décrivit Georges Gaudy dans son ouvrage Combats sans gloire : “Notre cantonnement flambe. Lagny, terme désigné de notre dur voyage, s'abîme dans un océan de flammes qu'on dirait jailli avec une force terrifiante des entrailles du sol. Aucun bruit, ni celui de la cloche qui tinte, de la pioche qui sonne, ni la voix de l'homme, ni celle de l'oiseau, . ni le murmure des fontaines. S'il en existe, elles sont desséchées. tâches de sang, plus visibles, pressées sur la terre, y forment des damiers lugubres. Lagny, bâti en longueur, s'étend sur trois kilomètres, composé de grandes fermes et de villas, qui toutes sans exception ont reçu l'implacable visite d'un acharné, savant, méthodique incendiaire”. Le lendemain, Lagny tombait aux mains allemandes. LE SECOURS AUX FUGITIFS Au cours de l'occupation, le village subit plusieurs incendies (une ferme le 19 septembre 1943, un hangar le 24 septembre suivant…). Malgré la proximité de l'aérodrome de Roye-Amy, le mouvement Résistance put y trouver des soutiens, dont Kléber Gorlet et René Martin. Des habitants hébergèrent des pilotes alliés abattus en les cachant dans leurs fermes. Ainsi, la famille Dacheux, propriétaire de deux fermes à Lagny, donna gîte et couvert à plusieurs aviateurs, lesquels étaient cachés lors de visites allemandes dans un poulailler à double plancher. Alexia Dacheux-Frizon (1890-1981), membre du mouvement Résistance, reçut après guerre la médaille de la Résistance, la croix d’officier du mérite et dévouement, la médaille des passeurs, la croix de chevalier “encouragement et dévouement”, la croix du combattant de l'Europe et la reconnaissance du peuple américain. Elle se rendit aux Etats-Unis à l'invitation d'un pilote hébergé chez elle
THIVERNY ET REMY
UN SITE STRATEGIQUE Commune de 750 habitants en 1939 située en rive droite de la confluence du Thérain et de l'Oise, Thiverny s'inscrit dans la partie sud ouest de l'agglomération formée avec Creil, Montataire, Nogent-sur-Oise et Villers-Saint-Paul. Durant les mois de mai et juin 1940, la commune, administrée par Jean Cassé, subit des bombardements allemands prenant pour cible la voie ferrée, les ponts sur l'Oise, les axes routiers et l'aérodrome de Creil. Durant l'occupation, Thiverny devint un site stratégique pour l'armée allemande en raison de sa situation à proximité de sites industriels, de l'Oise et du centre de triage ferroviaire “ Le Petit Thérain ”. Durant le printemps et l'été 1944, les carrières souterraines de Saint-Leu-d'Esserent ,Thiverny furent utilisées par les Allemands comme lieu d'assemblage des armes de représailles de type V1 protégé par une importante DCA installée notamment sur le plateau de Thiverny UNE RESISTANCE ACTIVE Agglomération ouvrière aux militants communistes actifs, le Creillois connut une forte activité résistante organisée notamment par les cheminots. Outre la recherche de renseignements, les résistants réalisèrent des actions de sabotages, notamment sur le site du Petit-Thérain, et diffusèrent de la propagande antiallemande et anti vichyste. Le Patriote de l'Oise, journal du Front National de Lutte pour l'Indépendance de la France, fut ainsi édité chez un épicier de Thiverny. En recherche de tickets de rationnement et de papiers d'identité, le groupe FTP Valmy attaqua la mairie de Thiverny le 21 janvier 1944. Durant l'été suivant, Thiverny connut de nombreux bombardements par l'aviation alliée cherchant à détruire les voies de communication, notamment ferroviaires, et les sites d'assemblage de V1. Trois raids furent particulièrement destructeurs pour Thiverny : le 12 juillet (168 Halifax, 46 Lancaster et 8 Mosquito), la nuit du 19 au 20 juillet et le 5 août (196 Halifax 60 Lancaster, 7 Mosquito). Le village fut relativement épargné par les bombes détruisant principalement les installations industrielles. CITATION  Citation à l'ordre du Régiment “ Commune sinistrée, a subi 28 raids aériens au cours de la guerre 1939-1945. Nombreuses habitations détruites ou endommagées, neuf habitants tués au cours des opérations de guerre.”
Citation à l'ordre du Régiment “ Commune sinistrée, a subi 28 raids aériens au cours de la guerre 1939-1945. Nombreuses habitations détruites ou endommagées, neuf habitants tués au cours des opérations de guerre.”
REMY
Le 10 mai 1940, les premiers passages de réfugiés belges et les premiers survols d'avions allemands annoncèrent aux habitants de Rémy le début de la Bataille de France. Le 21 mai, lors d'un combat aérien, un chasseur français (Morane Saulnier 406) s'écrasa sur le territoire communal. Son parachute ne s'étant pas ouvert, le pilote fut tué en touchant le sol. Il s'agit du capitaine Georges Lacombe, chef de l'escadrille V du Groupe de Chasse III/7. Son corps repose dans le cimetière. Le même jour, la préfecture donna l'ordre à la population d'évacuer le village. L'arrêt provisoire de l'avancée allemande permit aux habitants de revenir dans leurs foyers le 25 mai. Mais un nouvel ordre d'évacuation fut donné le 7 juin, tandis que les troupes françaises s'étaient regroupées derrière la ligne Weygand. Des défenses furent organisées autour de l'entrée nord du village et une batterie de 75 fut installée au croisement des routes Monchy Humières - Baugy. Les replis successifs conduisirent le 107e RI dans le Compiégnois où une section prit possession du cimetière et creusa des meurtrières dans le mur. Les mitrailleurs combattirent jusqu'à épuisement des munitions. Si certains purent échapper, d'autres furent faits prisonniers et faillirent être passés par les armes. Le nord du village fut fortement bombardé par l'aviation et les canons allemands. Fortement endommagée, l'église servit de lieu de regroupement des prisonniers et des blessés avant leur évacuation. La population revint dans le village le 27 juin 1940 et subit les affres de l'occupation allemande. Citation à l'ordre de la Brigade “ Déjà citée pour son comportement en 1914-1918, a été à nouveau cruellement meurtrie par les bombardements au cours de la guerre 1939-1945. Malgré ses ruines, a donné un bel exemple de sang-froid et de patriotisme en participant de son mieux à la lutte contre l'occupant.” De par la présence d'une voie ferrée, la Résistance réalisa quelques actions sur le territoire communal : déraillement d'un train le 27 juin 1944 revendiqué par les FTP, sabotage de la voie ferrée les 4 et 26 juillet suivants...
L EXPLOSION DU 2 AOUT Dans l'après-midi du 2 août 1944, un train de marchandises allemand arrêté en gare de Rémy fut mitraillé par quatre P51 Mustang de la 8e US Air Force (364 Fighter Group 383 Fighter Squadron). Après une première attaque infructueuse de la patrouille du capitaine Marvin W. Glasgow, la seconde attaque atteignit sa cible et toucha le train transportant… des explosifs. Les tirs du deuxième avion provoquèrent une explosion formidable. Pris dans l'action, le pilote du troisième avion ne parvint pas à se dégager. Son avion explosa et alla s'écraser à quelques centaines de mètres de la gare, dans une rue du village. Le corps en partie carbonisé du Lieutenant Houston L. Braly, pilote d'origine américaine, fut transporté dans un bâtiment proche du crash. Le fleurissement de son corps par la population fut reproché par l'autorité allemande qui fit retirer les bouquets et exigea une inhumation dans le cimetière communal sans autre cérémonie. Dans le village, le bilan de l'explosion était lourd : une tranchée profonde de 4 mètres et longue d'une centaine de mètres remplaçait la voie ferrée. Le site de la gare, dont l'horloge resta bloquée à 17h30, et les dépôts de planches de la scierie étaient détruits. Toutes les maisons du village furent endommagées par les effets de l'explosion : toits soufflés, murs abattus, vitres brisées... par les projections de débris. Des morceaux de rails furent retrouvés à plus d'un kilomètre du lieu d'impact… La commune recensa de nombreux blessés dans la population civile et déplora la mort du jeune Denis Coupelle, 14 ans, tué par un rail projeté. Le lendemain, 3 août, la voie unique fut bombardée par l'aviation alliée, interrompant le trafic ferroviaire entre Compiègne et Beauvais pendant cinq jours. Quelques semaines plus tard, avec la progression alliée, les troupes d'occupation se replièrent. Une pièce d'artillerie allemande fut cependant installée devant l'église le 31 août. Elle quitta Rémy dans la soirée. Le lendemain, 1er septembre, vers 15 heures, deux FFI dans un side-car devançant les forces américaines furent pris à partie par deux soldats allemands cachés dans une maison, au carrefour des rues de l'Eglise et de Francières. Louis Boilet, de Pont-Sainte-Maxence, fut tué. Les Américains entrèrent dans le village une heure plus tard pour le libérer définitivement. Les importantes destructions subies par la commune lui valurent l'attribution de la Croix de Guerre avec étoile de bronze, médaille épinglée le 3 décembre 1950 par le sous-préfet Patou sur un coussin porté par le jeune Yves Capelle. 
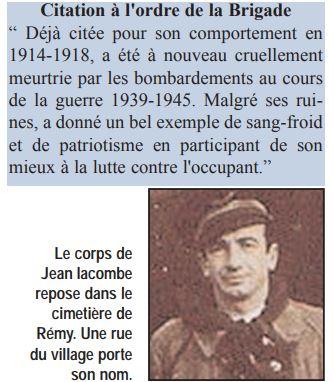
SENLIS
UNE CITE BOMBARDEE Senlis connut les premiers bombardements allemands le 19 mai 1940, rue de Meaux et rue du Châtel. Le 21, jour du bombardement de l'avenue Foch, la ville fut évacuée sur ordre de la préfecture. L'ordre fut rapporté le lendemain. Le 2 juin, jour de la Fête-Dieu, sous la pression des alertes par les sirènes, l'archiprêtre prononça un vœu à Notre-Dame. Les 6 et 7, de nouveaux bombardements frappèrent la ville. Si, le 8, une grande partie de la population avait quitté Senlis, l'ordre d'évacuation fut donné le lendemain. Les bombardements se multiplièrent alors toute cette journée, accompagnant le regroupement des troupes françaises derrière la ligne Chauvineau, compliqué par l'exode des civils. Le 10 juin, le dernier train de matériel quitta la ville. Les ponts de la Nonette, rues de Paris et de la République, furent détruits dans la nuit Des combats se déroulèrent alors le long de la ligne fortifiée créée durant la Drôle de Guerre. Elle fut dépassée par l'armée allemande le 12 juin. LA RESISTANCE SENLISIENNE Des Senlisiens participèrent à l'animation de réseaux de Résistance, tels Paul Bonamy dans le réseau Cartwright (renseignement) ou René Charpentier dans le réseau Bourgogne (passeurs d'aviateurs alliés). Des mouvements se développèrent également, tels le Front National mené par André Décatoire, chef du secteur 4 et de la section de Senlis, ou l'Organisation Civile et Militaire (OCM) conduite à Senlis par l'abbé Amyot d'Inville (alias Lejeune) puis Pierre Patria. Les principales actions des résistants à Senlis furent la cache d'aviateurs, le renseignement, la propagande, le sabotage de lignes de télécommunication.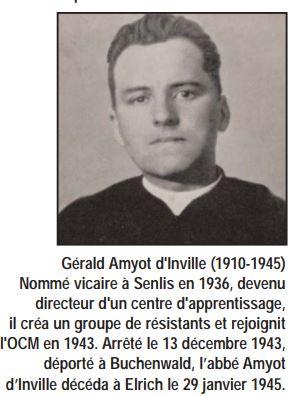
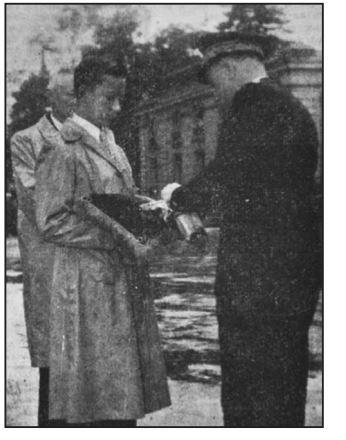 Le sous-préfet Brottes épinglant la Croix de Guerre sur le coussin de la ville
Le sous-préfet Brottes épinglant la Croix de Guerre sur le coussin de la ville
 L AUTEUR DE CE DEVOIR DE MEMOIRE
L AUTEUR DE CE DEVOIR DE MEMOIRE
AMY
LES COMBATS DE JUIN 40 En 1936, Amy était le siège d'un terrain d'aviation civile établi par des habitants du secteur de Roye (Somme). L'aérodrome, doté d'une piste en herbe et de hangars, avait la particularité d'être entouré d'espaces totalement découverts. Durant la Drôle de Guerre, l'armée y installa les infrastructures d'une base aérienne (accueil des unités, protection au sol et antiaérienne, service médical, gestion du personnel, service logistique, subsistance et météo) administrée par les Compagnies de l'Air 58/110, du 29 août au 3 octobre 1939, et 84/107, du 21 novembre 1939 au 17 mai 1940. Le terrain fut le lieu de stationnement de Groupes de Bombardement : le GB II/34 du 10 avril au 10 mai 1940, le GBII/54 du 10 au 13 mai 1940 puis le GBI/31, du 13 au 16 mai 1940. Entre le 24 septembre et le 18 octobre 1939, le terrain d'Amy-Roye fut aussi utilisé par la Royal Air Force avec le Squadron 57 équipé du bombardier léger rapide triplace Bristol Blenheim Mk IV. A la suite d'un bombardement allemand le 18 mai 1940, le terrain ne semble plus avoir été utilisé par l'aviation alliée. L'offensive allemande sur la ligne Weygand, le 5 juin 1940, conduisit l'étatmajor français à établir au sud de l'Avre une ligne tenue par la 29e DI avec en soutien la 47e DI. Le 109e RI, renforcé par un barrage antichar, fut ainsi disposé entre Beuvraignes et Crapeausmesnil. Le dispositif adopté fit du chemin Amy-Fresnières un enjeu stratégique pour le 2e bataillon du régiment. Amy subit plusieurs bombardements allemands le 6 juin 1940, notamment en soiréeEn 1936, Amy était le siège d'un terrain d'aviation civile établi par des habitants du secteur de Roye (Somme). L'aérodrome, doté d'une piste en herbe et de hangars, avait la particularité d'être entouré d'espaces totalement découverts. Durant la Drôle de Guerre, l'armée y installa les infrastructures d'une base aérienne (accueil des unités, protection au sol et antiaérienne, service médical, gestion du personnel, service logistique, subsistance et météo) administrée par les Compagnies de l'Air 58/110, du 29 août au 3 octobre 1939, et 84/107, du 21 novembre 1939 au 17 mai 1940. Le terrain fut le lieu de stationnement de Groupes de Bombardement : le GB II/34 du 10 avril au 10 mai 1940, le GBII/54 du 10 au 13 mai 1940 puis le GBI/31, du 13 au 16 mai 1940. Entre le 24 septembre et le 18 octobre 1939, le terrain d'Amy-Roye fut aussi utilisé par la Royal Air Force avec le Squadron 57 équipé du bombardier léger rapide triplace Bristol Blenheim Mk IV. A la suite d'un bombardement allemand le 18 mai 1940, le terrain ne semble plus avoir été utilisé par l'aviation alliée. L'offensive allemande sur la ligne Weygand, le 5 juin 1940, conduisit l'étatmajor français à établir au sud de l'Avre une ligne tenue par la 29e DI avec en soutien la 47e DI. Le 109e RI, renforcé par un barrage antichar, fut ainsi disposé entre Beuvraignes et Crapeausmesnil. Le dispositif adopté fit du chemin Amy-Fresnières un enjeu stratégique pour le 2e bataillon du régiment. Amy subit plusieurs bombardements allemands le 6 juin 1940, notamment en soiréeEn 1936, Amy était le siège d'un terrain d'aviation civile établi par des habitants du secteur de Roye (Somme). L'aérodrome, doté d'une piste en herbe et de hangars, avait la particularité d'être entouré d'espaces totalement découverts. Durant la Drôle de Guerre, l'armée y installa les infrastructures d'une base aérienne (accueil des unités, protection au sol et antiaérienne, service médical, gestion du personnel, service logistique, subsistance et météo) administrée par les Compagnies de l'Air 58/110, du 29 août au 3 octobre 1939, et 84/107, du 21 novembre 1939 au 17 mai 1940. Le terrain fut le lieu de stationnement de Groupes de Bombardement : le GB II/34 du 10 avril au 10 mai 1940, le GBII/54 du 10 au 13 mai 1940 puis le GBI/31, du 13 au 16 mai 1940. Entre le 24 septembre et le 18 octobre 1939, le terrain d'Amy-Roye fut aussi utilisé par la Royal Air Force avec le Squadron 57 équipé du bombardier léger rapide triplace Bristol Blenheim Mk IV. A la suite d'un bombardement allemand le 18 mai 1940, le terrain ne semble plus avoir été utilisé par l'aviation alliée. L'offensive allemande sur la ligne Weygand, le 5 juin 1940, conduisit l'étatmajor français à établir au sud de l'Avre une ligne tenue par la 29e DI avec en soutien la 47e DI. Le 109e RI, renforcé par un barrage antichar, fut ainsi disposé entre Beuvraignes et Crapeausmesnil. Le dispositif adopté fit du chemin Amy-Fresnières un enjeu stratégique pour le 2e bataillon du régiment. Amy subit plusieurs bombardements allemands le 6 juin 1940, notamment en soirée Le lendemain, 7 juin, les blindés, cavaliers et fantassins allemands débarqués en camion à l'ouest du village furent pris à partie par l'infanterie française. Les tirs vers Amy s'estompèrent lorsque la ligne Beuvraignes-Crapeaumensil tomba, dans la soirée. UN AERODROME POUR LA LUFTWAFFE Dès juin 1940, les autorités d'occupation réquisitionnèrent des terrains pour agrandir la piste d'aviation et créer un aérodrome militaire sur les territoires d'Amy et de Crapeaumesnil. La Luftwaffe répertoria le “Flugplatz Roye-Amy” sous le code 584 de septembre 1940 à juin 1942, puis sous le code 248S de juillet 1942 à juin 1944. Trois pistes bétonnées larges de 50m et longues de 1770m, de 1650m et de 1590m furent construites, reliées par des voies de circulation conduisant à des aires de stationnement, des hangars et des casemates. Outre le balisage des pistes, un système d'approche par mauvais temps fut installé ainsi que plusieurs aires de dispersion. Les installations étaient protégées par deux batteries de trois canons de 88 et une batterie de sept pièces de 20 et 37. De mars à juin 1941, l'aérodrome d'Amy fut le siège de l'escadre de bombardement III/KG1 (Kampfgeschwader 1). Equipé de chasseurs-bombardiers Ju 88A (Junkers), elle participa à la Bataille d'Angleterre. Plus tard, du 9 mars au 15 mai 1944, il fut utilisé par l'escadron rapide de bombardement I/SKG10 (Schnellkampfgeschwader 10) équipé de chasseurs-bombardiers FW190A (Focke-Wulf). Sa mission était d'intercepter de jour les bombardiers américains lors de leurs raids sur l'Allemagne. Devenu un site sensible, l'autorité d'occupation procéda à l'évacuation totale de la population le 20 juin 1942, laquelle se réfugia dans les communes voisines. Durant ces deux années, le maire aurait établi des cartes d'identité (vraies ou fausses), et fourni des titres d'alimentation à des prisonniers de guerre nord-africains évadés du terrain d'aviation pendant leur travail, souvent avec l'aide des habitants. L'agrandissement du terrain d'aviation d'Amy fut réalisé par des prisonniers notamment soviétiques et des requis de la région. L'un d'entre eux, Hubert Guinard, de Noyon, y fut tué par un garde le 22 juillet 1941. A AMY ET LES ALLIES 
 Plus tard, du 9 mars au 15 mai 1944, il fut utilisé par l'escadron rapide de bombardement I/SKG10 (Schnellkampfgeschwader 10) équipé de chasseurs-bombardiers FW190A (Focke-Wulf). Sa mission était d'intercepter de jour les bombardiers américains lors de leurs raids sur l'Allemagne. Devenu un site sensible, l'autorité d'occupation procéda à l'évacuation totale de la population le 20 juin 1942, laquelle se réfugia dans les communes voisines. Durant ces deux années, le maire aurait établi des cartes d'identité (vraies ou fausses), et fourni des titres d'alimentation à des prisonniers de guerre nord-africains évadés du terrain d'aviation pendant leur travail, souvent avec l'aide des habitants. L'agrandissement du terrain d'aviation d'Amy fut réalisé par des prisonniers notamment soviétiques et des requis de la région. L'un d'entre eux, Hubert Guinard, de Noyon, y fut tué par un garde le 22 juillet 1941. Un aérodrome pour la Luftwaffe Vestiges des pistes en béton de l’aérodrome d’Amy-Roye L'aérodrome fut pris à partie de nombreuses fois par l'aviation alliée notamment les 26 novembre 1943, 31 janvier 1944, 3 mars 1944, 27 avril 1944, 1er mai 1944, 12 juin 1944 et 18 août 1944. Plusieurs attaques furent réalisées par l'escorte des bombardiers de la 8e Armée de l'air américaine, équipée de P-51 Mustang. Malgré les bombardements alliés, plusieurs agriculteurs poursuivirent leur activité dans les champs dont ils avaient encore la libre disposition. De par l'absence de masque végétal, l'aérodrome d'Amy-Roye, ses installations et leurs environs furent fortement touchés. A la Libération, sur 101 habitations, 21 étaient totalement détruites et les autres partiellement sinistrées. Trois habitants avaient été tués et un blessé. L'US Air Force prit possession de l'aérodrome, répertorié A-73, et le répara. Un village de tentes pour le cantonnement fut installé ainsi que des structures. Se succédèrent ainsi le 370e Fighter Group, sur P47 “Thunderbolts” du 11 au 26 septembre 1944, le 391e Bomber Group, sur B26 “Marauders” du 19 septembre 1944 au 16 avril 1945, le 349e Troop Carrier Group, sur C47 Skytrains, du 13 avril à juillet 1945. Le terrain d'aviation d'Amy fut ouvert à la circulation aérienne publique en 1947 malgré la faiblesse de ses équipements. Envisagé pour servir de terrain d'opérations de l'OTAN mais non retenu en 1951, l'aérodrome fut abandonné par l'armée de l'air en 1954 puis par l'aviation civile en 1969. Les pistes furent démantelées sur une partie de leur largeur pour être rendues à l'agriculture, le reste étant utilisé comme voies d'accès CITATION Localité évacuée totalement sur les ordres de l'autorité occupante, dont toute les maisons ont été détruites, soit sinis-trées et dont la population a fait preuve decourage dans l'épreuve et dans la lutte contre l'ennemi.Déjà citée au titre de la Guerre 1914-1918.””
Plus tard, du 9 mars au 15 mai 1944, il fut utilisé par l'escadron rapide de bombardement I/SKG10 (Schnellkampfgeschwader 10) équipé de chasseurs-bombardiers FW190A (Focke-Wulf). Sa mission était d'intercepter de jour les bombardiers américains lors de leurs raids sur l'Allemagne. Devenu un site sensible, l'autorité d'occupation procéda à l'évacuation totale de la population le 20 juin 1942, laquelle se réfugia dans les communes voisines. Durant ces deux années, le maire aurait établi des cartes d'identité (vraies ou fausses), et fourni des titres d'alimentation à des prisonniers de guerre nord-africains évadés du terrain d'aviation pendant leur travail, souvent avec l'aide des habitants. L'agrandissement du terrain d'aviation d'Amy fut réalisé par des prisonniers notamment soviétiques et des requis de la région. L'un d'entre eux, Hubert Guinard, de Noyon, y fut tué par un garde le 22 juillet 1941. Un aérodrome pour la Luftwaffe Vestiges des pistes en béton de l’aérodrome d’Amy-Roye L'aérodrome fut pris à partie de nombreuses fois par l'aviation alliée notamment les 26 novembre 1943, 31 janvier 1944, 3 mars 1944, 27 avril 1944, 1er mai 1944, 12 juin 1944 et 18 août 1944. Plusieurs attaques furent réalisées par l'escorte des bombardiers de la 8e Armée de l'air américaine, équipée de P-51 Mustang. Malgré les bombardements alliés, plusieurs agriculteurs poursuivirent leur activité dans les champs dont ils avaient encore la libre disposition. De par l'absence de masque végétal, l'aérodrome d'Amy-Roye, ses installations et leurs environs furent fortement touchés. A la Libération, sur 101 habitations, 21 étaient totalement détruites et les autres partiellement sinistrées. Trois habitants avaient été tués et un blessé. L'US Air Force prit possession de l'aérodrome, répertorié A-73, et le répara. Un village de tentes pour le cantonnement fut installé ainsi que des structures. Se succédèrent ainsi le 370e Fighter Group, sur P47 “Thunderbolts” du 11 au 26 septembre 1944, le 391e Bomber Group, sur B26 “Marauders” du 19 septembre 1944 au 16 avril 1945, le 349e Troop Carrier Group, sur C47 Skytrains, du 13 avril à juillet 1945. Le terrain d'aviation d'Amy fut ouvert à la circulation aérienne publique en 1947 malgré la faiblesse de ses équipements. Envisagé pour servir de terrain d'opérations de l'OTAN mais non retenu en 1951, l'aérodrome fut abandonné par l'armée de l'air en 1954 puis par l'aviation civile en 1969. Les pistes furent démantelées sur une partie de leur largeur pour être rendues à l'agriculture, le reste étant utilisé comme voies d'accès CITATION Localité évacuée totalement sur les ordres de l'autorité occupante, dont toute les maisons ont été détruites, soit sinis-trées et dont la population a fait preuve decourage dans l'épreuve et dans la lutte contre l'ennemi.Déjà citée au titre de la Guerre 1914-1918.””
CAISNES
UN VILLAGE REFUGE Petit village noyonnais situé sur la rive gauche de l'Oise en bordure du plateau du Soissonnais, Caisnes fut, durant la Seconde Guerre mondiale, le centre de ce qu'on appelle localement un “ maquis ”. Le vallonnement prononcé, l'éloignement des centres urbains, la situation de carrefour entre Noyon, Soissons et Compiègne, l'importante végétation forestière et les nombreuses carrières souterraines favorisèrent le dépôt, dans des caches, des armes récupérées de la débâcle de 1940 et lors de parachutages alliés. Mais les bois de Caisnes furent surtout, pour les habitants, le lieu où se cachèrent des résistants recherchés entrés en clandestinité, des communistes et des Républicains espagnols, des déserteurs de l'armée allemande (Yougoslaves), des évadés soviétiques et polonais, des réfractaires au STO.... La venue de réfugiés du Havre masqua ces mouvements de population. En effet, après le bombardement du Havre par les Anglais (1942), les populations des quartiers détruits, notamment celui “des Neiges”, furent déplacées dans le Noyonnais. Une partie de ces réfugiés, environ une trentaine, dont beaucoup d'enfants, fut hébergée à Caisnes. Le village connaissant une baisse démographique, la préfecture réquisitionna plusieurs maisons inhabitées. Ces nouveaux habitants travaillèrent alors à la culture (beaucoup d'hommes manquaient) et dans les bois où était fabriqué le charbon de bois dit “saucisson” destiné au Royal Elysée. Certains d'entre eux furent employés sous une fausse identité dans les fermes, notamment à Bellefontaine. A la veille du Débarquement, une quarantaine d'hommes formaient ce maquis ravitaillé par les gens du pays, dont Max Brézillon, apportant gigots et haricots dans son Ford . En marge de cette vie clandestine des réfugiés, des actions de résistance étaient organisées dans la commune par des hommes du Noyonnais (MM. Delignières, Terqueux, Valois, Dhaty, Leroy, Salvage) sous la direction de l'instituteur Pierre Pichot et du capitaine Giboux, en liaison avec le responsable de l'OCM de Noyon, le capitaine Fourrier. Le groupe de Caisnes réunit un stock d'armes issu de parachutages alliés dans le secteur de Varennes. Les conteneurs étaient vidés la nuit et leur contenu transféré dans la Carrière Mériot à Nampcel. Ce dépôt de “la creute de la Montagne” aurait contenu jusqu'à 130 mitraillettes de tous modèles, plusieurs milliers de cartouches, des grenades, des pétards aimantés... mais peu de fusils. Le dépôt de Caisnes permit d'alimenter les groupes voisins tels celui de Chauny ou celui de Compiègne, qui fit exploser les cuves de l'entreprise Ternac contenant de l'alcool pour les V1. Outre le parachutage, le groupe de Caisnes travailla au ravitaillement en nourriture du maquis (réfugiés, émigrés, résistants, réfractaires STO...), à la fourniture de papiers d'identité et de cartes, à l'approvisionnement en armes des groupes voisins puis, à partir de juin 1944, au sabotage des lignes (coupures des câbles, sciages des poteaux) et des ponts. A la suite de rumeurs de dénonciation, ce stock d'armes de la Carrière Mériot fut transféré en pleine nuit par tombereaux tirés par des chevaux dans une sape du Grand Bois. Quelques jours plus tard, la Carrière Mériot fut investie et fouillée par les troupes allemandes. En parallèle, en juin 1944, trois Américains furent parachutés sur Caisnes pour le renseignement des troupes alliées débarquée LA RAFLE DU 26 JUILLET 1944 Le 23 juin 1944, le maquis des Usages à Crisolles était attaqué par les Allemands. Le 1er juillet, les Allemands procédèrent à une rafle à Salency. La plupart des réfugiés du maquis de Caisnes furent arrêtés par l'armée allemande le 26 juillet 1944 au cours d'une rafle, sur dénonciation du traître Adrien Souris. Ce fils de gendarme était connu à Caisnes où il venait parfois à la poste du village. Les premiers avertis de la rafle furent les braconniers qui, tandis qu’ils posaient des collets dans les bois, virent le village se faire encercler par les Allemands. Toute la population fut réunie sur la place du village, surveillée par des soldats miLa rafle du 26 juillet 1944 Résistants rescapés du groupe de Caisnes-Noyon posant, après-guerre, devant la carrière Mériot. traillette au poing et par deux mitrailleuses. Un soldat allemand hurla en tapant du pied: “Si vous bougez, vous serez hachés! Je le répèterai pas deux fois ! ” Après contrôle de l'identité, le soldat fit sa sélection : les Yougoslaves, les Polonais et les Russes furent faits prisonniers. L'un d'entre eux, caché sur une branche haute d'un sapin, fut arrêté et passé à tabac après que la branche ait cédé sous son poids. Les cinq Espagnols du village déclinèrent leur identité en invoquant la neutralité de leur pays. L'Allemand contrôla les papiers puis en frappant du pied au sol hurla “Terroriste ! Communiste ! ” et les fit arrêter. La plupart des bûcherons furent ainsi arrêtés, de même que des réfractaires au STO (comme Jacques Willecocq emmené dans un camion avec son vélo) mais aussi des hommes du cru. Réfugié du Havre et hébergé à Caisnes, Roger Affagard fut arrêté en tant que résistant, puis déporté dans un camp de concentration à Thale, dans le Harz. Libéré le 6 mai 1945 mais profondément marqué par ses conditions de détention, il en garda des séquelles jusqu'à sa mort. En tout, vingt-six personnes furent raflées à Caisnes ce jour-là. Dix-huit d'entre-elles furent déportées à Buchenwald. Seules, trois d'entre-elles en revinrent. Un des Espagnol fut, dit-on, exécuté d'une balle dans la tête après avoir subi les morsures des chiens de garde pour avoir ramassé un chou-navet dans le camp. Après la rafle de Caisnes, tous les résistants rescapés de la rafle entrèrent dans la clandestinité. A la Libération, la Résistance s'éteignit d'elle même. Néanmoins, certains résistants amalgamés dans l’armée régulière entrèrent dans le 67e RI basé à Compiègne et combattirent pour libérer les quelques villes encore tenues par les Allemands (Dunkerque). Les autres reprirent leurs activités d'avant guerre et travaillèrent à la reconstruction du pays. Le village de Caisnes se vit attribuer en 1948 la Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile de vermeil. Ses habitants furent reçus à Vincennes par le Général Hanote 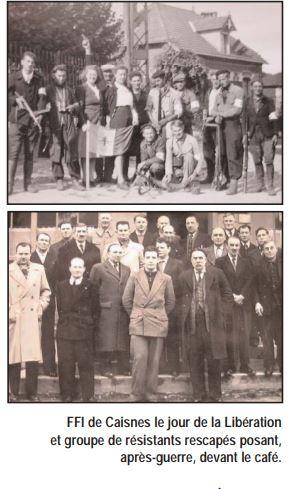
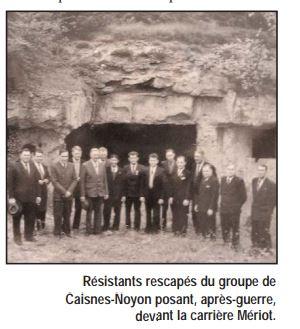
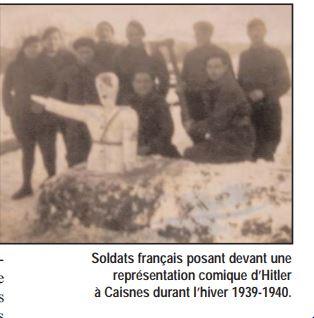
CLERMONT ET SAINT JUST EN CHAUSSEE
LES BOMBES DE 1940 Les premiers bombardements aériens de la ville et des environs commencèrent le 19 mai 1940, conduisant la municipalité à donner un ordre d'évacuation deux jours plus tard. Le 26 mai 1940, un nouveau bombardement détruisit le tribunal, rue du Châtellier, et une partie de l'hôpital psychiatrique. Lorsque les combats atteignirent le Clermontois, le 9 juin, le maire ordonna l'évacuation générale de la pop ulation. Les premiers blindés allemands entrèrent dans Clermont le 10 juin et installèrent une Kommandantur dès le lendemain. UN FOYER DE RESISTANCE Les premiers ferments de la Résistance dans la région de Clermont émanèrent de l'Armée Secrète animée dans le département par Marcel Sailly et Roland Delnef. Contacté à la fin de 1941, Georges Fleury procéda au recrutement de personnes sûres pour constituer des groupes, participant au fil du temps à la récupération et à la cache d'aviateurs, à la récupération de parachutages, puis à des actions de sabotage sur les voies ferrées, les lignes téléphoniques et électriques. Rattachée à l'OCM, la Résistance clermontoise subit des représailles comme la rafle de Boulincourt (Agnetz) le 17 juin 1944 ou l'arrestation du radio- électricien Jean Corroyer le 6 août 1944, qui fut abattu tandis qu'il s'échappait. Sa femme Léonie et son fils Guy furent arrêtés et décédèrent en déportation L AVIATIO
ulation. Les premiers blindés allemands entrèrent dans Clermont le 10 juin et installèrent une Kommandantur dès le lendemain. UN FOYER DE RESISTANCE Les premiers ferments de la Résistance dans la région de Clermont émanèrent de l'Armée Secrète animée dans le département par Marcel Sailly et Roland Delnef. Contacté à la fin de 1941, Georges Fleury procéda au recrutement de personnes sûres pour constituer des groupes, participant au fil du temps à la récupération et à la cache d'aviateurs, à la récupération de parachutages, puis à des actions de sabotage sur les voies ferrées, les lignes téléphoniques et électriques. Rattachée à l'OCM, la Résistance clermontoise subit des représailles comme la rafle de Boulincourt (Agnetz) le 17 juin 1944 ou l'arrestation du radio- électricien Jean Corroyer le 6 août 1944, qui fut abattu tandis qu'il s'échappait. Sa femme Léonie et son fils Guy furent arrêtés et décédèrent en déportation L AVIATIO 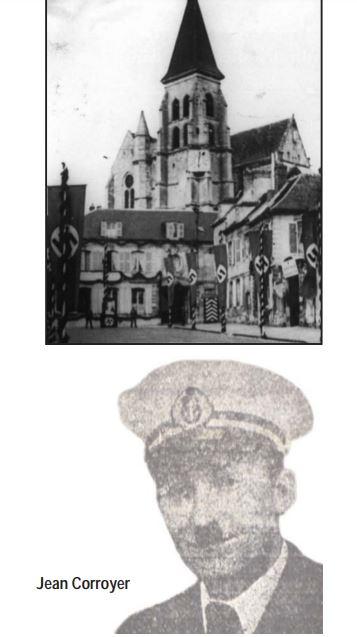 LES DESTRUCTONS ALLIES a gare, les voies routières et ferroviaires et les usines furent les cibles de l'aviation alliée. Le 15 mai 1944, un premier bombardement manqua la voie ferrée. Sept autres bombardements suivirent dont quelques-uns, particulièrement violents, touchèrent la ville : le 2 août, 28 bombes furent larguées sur le nord de la ville. Le 16 août, un bombardement visa la voie ferrée. Enfin, le 25 août, vers 12h40, plusieurs tonnes de bombes furent larguées sur les installations allemandes du quartier Belle Assise (centre de ravitaillement installé dans l'usine Gervais), de l'Equipée et la Croix-Saint-Laurent par 30 bombardiers du 342e escadron Lorraine et du 88e escadron de la Royal Air Force. 378 impacts furent recensés sur Clermont, Agnetz et Fitz-James. 46 personnes furent tuées et autant blessées au cours de ce raid allié. Clermont fut libéré le 1er septembre suivant par les Américains.
LES DESTRUCTONS ALLIES a gare, les voies routières et ferroviaires et les usines furent les cibles de l'aviation alliée. Le 15 mai 1944, un premier bombardement manqua la voie ferrée. Sept autres bombardements suivirent dont quelques-uns, particulièrement violents, touchèrent la ville : le 2 août, 28 bombes furent larguées sur le nord de la ville. Le 16 août, un bombardement visa la voie ferrée. Enfin, le 25 août, vers 12h40, plusieurs tonnes de bombes furent larguées sur les installations allemandes du quartier Belle Assise (centre de ravitaillement installé dans l'usine Gervais), de l'Equipée et la Croix-Saint-Laurent par 30 bombardiers du 342e escadron Lorraine et du 88e escadron de la Royal Air Force. 378 impacts furent recensés sur Clermont, Agnetz et Fitz-James. 46 personnes furent tuées et autant blessées au cours de ce raid allié. Clermont fut libéré le 1er septembre suivant par les Américains.
SAINT JUST EN CHAUSSEE ICI A DROITE EDMOND/ CAILLARD
LES CIBLES DE L AVIATION Entre septembre 1939 et mai 1940, la ferme de Lèvremont, à Plainval, commune limitrophe de Saint-Just-en-Chaussée, fut le siège d'un centre de rassemblement de “ressortissants ennemis”. Des aviateurs allemands y furent détenus après le déplacement des internés vers la zone sud. Ville située à la croisée de deux voies de grande communication et à proximité d'une voie ferrée, Saint-Just-en-Chaussée subit de nombreux bombardements durant la guerre. Ainsi, 150 maisons furent détruites et une centaine endommagées après les combats de 1940. Le 8 juin, Saint- just-en-Chaussée se trouva dans le secteur de repli de la 19e DI. Devenue allemande le 9 juin, la ville fut bombardée par la suite par l'aviation alliée prenant pour cible les voies et la gare, provoquant d'importantes destructions. Ainsi, le 16 décembre 1942, deux bombes ratèrent leur cible (la sucrerie) pour exploser sur une maison faisant plusieurs victimes. Durant l'année 1944, les bombardements et mitraillages alliés s'intensifièrent : le 27 Entre septembre 1939 et mai 1940, la ferme de Lèvremont, à Plainval, commune limitrophe de Saint-Just-en-Chaussée, fut le siège d'un centre de rassemblement de “ressortissants ennemis”. Des aviateurs allemands y furent détenus après le déplacement des internés vers la zone sud. Ville située à la croisée de deux voies de grande communication et à proximité d'une voie ferrée, Saint-Just-en-Chaussée subit de nombreux bombardements durant la guerre. Ainsi, 150 maisons furent détruites et une centaine endommagées après les combats de 1940. Le 8 juin, Saint-Just-en-Chaussée se trouva dans le secteur de repli de la 19e DI. Devenue allemande le 9 juin, la ville fut bombardée par la suite par l'aviation alliée prenant pour cible les voies et la gare, provoquant d'importantes destructions. Ainsi, le 16 décembre 1942, deux bombes ratèrent leur cible (la sucrerie) pour exploser sur une maison faisant plusieurs victimes. Durant l'année 1944, les bombardements et mitraillages alliés s'intensifièrent : le 27mai, un train en gare de Saint Just fut prit pour cible causant un mort et deux blessés Le 21 juin, un avion allié mitrailla de nouveau la gare. Le jour suivant, 22 juin, seize avions alliés bombardèrent en soirée un train de munitions stationné depuis quatre jours en gare. L'incendie durait encore le lendemain matin lorsqu'un bombardier y largua deux nouvelles bombes. Le 25 juin, les habitants assistèrent au bombardement des voies par trois fois dans la matinée. Puis, le 2 août, la gare fut de nouveau mitraillée. Le 8 août, à la suite du bombardement par l'aviation alliée d'un train de sucre destiné à l'Allemagne stationné en gare, les Allemands tirèrent à la mitrailleuse sur les habitants venus récupérer la cargaison, faisant un mort et plusieurs blessés. La ville fut libérée le 31 août 1944 par les troupes américaines. LA RESISTANCE EN ACTION L Durant l'occupation, le maire Léon Baticle fut confirmé dans sa fonction. Il prépara la reconstruction de la ville, qui reçut le parrainage de Loriol-sur-Drôme. Le 9 juillet 1941, les forces d'occupation arrêtèrent le militant communiste et syndicaliste Pierre Bogaert, conseiller municipal déchu de son mandat par le gouvernement Daladier. Déporté à Auschwitz le 6 juillet 1942, il y décéda le 15 octobre suivant. En mars 1942, les FTP de Saint-Just-en-Chaussée créèrent le détachement Jacques Bonhomme, dont le responsable fut Georges Jauneau. Plusieurs actions de sabotage contre des fils téléphoniques et électriques furent menées dans le secteur. D'autres firent du renseignement ou vinrent en aide aux aviateurs alliés tombés dans la région. Au volant de sa Simca 5, le Dr Edmond Caillard (ci-dessous) porta ainsi secours à 87 aviateurs alliés, pour la plupart américains. Le 3 juillet 1944, au lendemain d'arrestations à Beauvais et Montreuil-sur-Brêche, les forces allemandes appréhendèrent Louis Bizet, Georges Degroote, Paul Vikovski, Charles Fromentin, Roger Chambin, Charles Davy, Marie Dubezack, Pierre Dubois, Albert Maillard. Tous furent déportés. Les quatre premiers et leur délateur décédèrent en déportation, à Buchenwald. Quelques jours après la libération, le 19 septembre 1944, le Comité cantonal de Libération Nationale proposa une nouvelle liste municipale où figuraient Jean Crouet (chef de la Résistance locale), le Dr Caillard, Pierre Bogaert et le Dr Yves Delignon, futur maire.
SALENCY ET RIBECOURT
MARQUE PAR LA RAFL E Le village de Salency fut un lieu de combat les 5, 6 et 7 juin 1940 au cours desquels les soldats français (notamment le 25e Groupe de Reconnaissance de Corps d'Armée, le 52e Bataillon de Mitrailleurs Motorisés et le 442e Régiment de Pionniers) subirent d'importantes pertes. Plus tard, durant l'occupation allemande, plusieurs habitants de Salency participèrent à des actes de résistance (renseignements, récupération d'armes, cache de parachutages dans le château…) puis à l'approvisionnement du maquis dans le bois des Usages, à Crisolles. L'arrestation et l'interrogatoire par les Allemands d'un agent de liaison demeurant à Salency fut à l'origine de l'attaque du maquis des Usages. Le 23 juin 1944, soir de l'attaque du Maquis de Crisolles, des camions allemands stationnèrent sur la place du village. Liste de noms en main, des Allemands se présentèrent à la mairie pour procéder à des arrestations. Ils soupçonnaient des relations entre les villageois et le maquis mais n'avaient pas de preuves. Si cette visite n'eut pas de conséquences immédiates, le 1er juillet suivant, une cinquantaine de camions allemands pénétrèrent dans Salency. Deux cents Allemands conduits par leur chef Schmidt, cernèrent le village et arrêtèrent hommes, femmes et jeunes qu'ils regroupèrent en divers lieux notamment près du jeu d'arc et du Cavin. Les Allemands inspectèrent les maisons, procédèrent à de nombreuses arrestations sommaires dans le village de Salency. Après avoir écarté les femmes, les jeunes et les hommes de plus de quarante ans, 34 hommes furent rassemblés au Cavin. Il s'agit de Fernand Bohère, Kléber Boitieux (Noyon), André Boulanger, Georges Boulanger, Honoré Bulfoni, Gabriel Capelle, Albert Carbonnier, Marcel Carreau, Joseph Cavé, Michel Dawosyr (Sempigny), René Décressionnière, Maurice Derrieux, Guy Desaint Quentin (Noyon), Adrien Desprez, Frédéric Doré, Louis Dubois, Reynold Duchauffour, Georges Dufour (Noyon), Jacques Gaudet, Jean Lalouette, Clément Leclerc, Jeannot Lesueur, Noël Lesueur, Jean Le Floch, Maurice Momeux, Marcel Momeux, Edmond Paulin, Jean Picard, Henri Pineau, Germain Quillet, Louis Rémia (Longueil-Annel), James Sézille, Yves Sézille et Ernest Trouvay. En fin de journée, au lancement de fusées dans le ciel, les Allemands se rassemblèrent. Les hommes raflés furent conduits par camions à Compiègne, où ils furent incarcérés dans la maison d'arrêt et interrogés en présence d'un interprète. Le maire, Médard Doré, accusé de fournir des cartes d'alimentation, subit le même sort.Louis Rémia fut relâché en fin de journée. Carbonnier, Derrieux, Dawosyr, Dubois et Marcel Momeux furent relâchés une semaine plus tard. Le 13 juillet, neuf hommes furent désignés pour travailler en Allemagne au titre du STO dans l'industrie de guerre. Il s'agit de Bohère, Desprez, Duchauffour, Lalouette, Lesueur Noël, Lesueur Jeannot, Momeux Maurice, Quillet et James Sézille. Transférés par train dans des wagons à bestiaux à la caserne de la Pépinière à Paris, ils furent dirigés vers Magdebourg où ils furent séparés. Ainsi, Noël Lesueur, Jeannot Lesueur et Reynold Duchauffour travaillèrent dans une usine de munitions. James Sézille, Maurice Momeux et Jean Lalouette devinrent chauffeur de locomotives. Adrien Desprez fut affecté dans une fonderie d'aluminium.L'un d'entre eux, Fernand Bohère, fut tué lors d'un bombardement de Dessau, le 7 mars 1945. Le 6 août, les détenus salenciens de la prison d'arrêt furent internés au camp de Royallieu. Au cours de cette période d'internement, quatorze des dixneuf raflés de Salency furent désignés pour participer aux travaux de dégagement de la gare de Compiègne, en partie détruite par les bombardements alliés. Le 9 août 1944, l'aviation américaine bombarda de nouveau les voies de Compiègne, provoquant d'importantes destructions et de nombreuses morts parmi les gardes allemands et les prisonniers. Trois salenciens y trouvèrent la mort : Georges Boulanger, étouffé sous les gravats, Jean Le Floch, déchiqueté et Ernest Trouvay. Les dix autres salenciens profitèrent des circonstances pour s'évader. Un seul d'entre eux fut repris et renvoyé à Royallieu. Le 17 août, les six hommes restant de la rafle de Salency furent embarqués dans le dernier train partant de Compiègne pour Buchenwald. Quatre d'entre eux décédèrent en déportation : André Boulanger, Frédéric Doré, Jean Picard et Edmond Polin 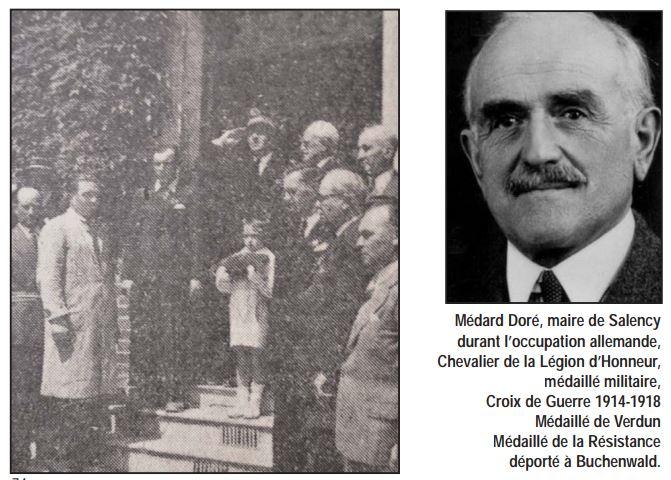
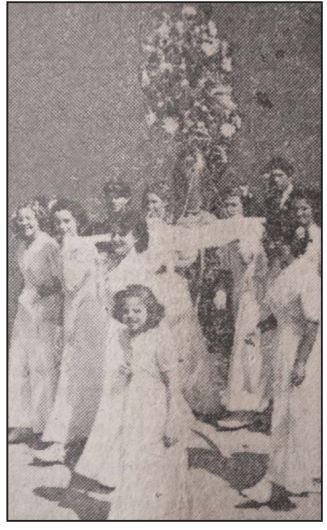 L'un d'entre eux, Fernand Bohère, fut tué lors d'un bombardement de Dessau, le 7 mars 1945. Le 6 août, les détenus Salenciens de la prison d'arrêt furent internés au camp de Royallieu. Au cours de cette période d'internement, quatorze des dix neuf raflés de Salency furent désignés pour participer aux travaux de dégagement de la gare de Compiègne, en partie détruite par les bombardements alliés. Le 9 août 1944, l'aviation américaine bombarda de nouveau les voies de Compiègne, provoquant d'importantes destructions et de nombreuses morts parmi les gardes allemands et les prisonniers. Trois salenciens y trouvèrent la mort : Georges Boulanger, étouffé sous les gravats, Jean Le Floch, déchiqueté et Ernest Trouvay. Les dix autres salenciens profitèrent des circonstances pour s'évader. Un seul d'entre eux fut repris et renvoyé à Royallieu. Le 17 août, les six hommes restant de la rafle de Salency furent embarqués dans le dernier train partant de Compiègne pour Buchenwald. Quatre d'entre eux décédèrent en déportation : André Boulanger, Frédéric Doré, Jean Picard et Edmond Polin. Plaque et stèle apposées au lieu-dit Le Cavin rappelant la rafle de Salency. Louis Rémia fut relâché en fin de journée. Carbonnier, Derrieux, Dawosyr, Dubois et Marcel Momeux furent relâchés une semaine plus tard. Le 13 juillet, neuf hommes furent désignés pour travailler en Allemagne au titre du STO dans l'industrie de guerre. Il s'agit de Bohère, Desprez, Duchauffour, Lalouette, Lesueur Noël, Lesueur Jeannot, Momeux Maurice, Quillet et James Sézille. Transférés par train dans des wagons à bestiaux à la caserne de la Pépinière à Paris, ils furent dirigés vers Magdebourg où ils furent séparés. Ainsi, Noël Lesueur, Jeannot Lesueur et Reynold Duchauffour travaillèrent dans une usine de munitions. James Sézille, Maurice Momeux et Jean Lalouette devinrent chauffeur de locomotives. Adrien Desprez fut affecté dans un e fonderie d'aluminium. 73 UUU UNE CROIX ET UN BOUQUET UNE UU La cérémonie de remise de la Croix de Guerre avec étoile d'argent se déroula le dimanche 4 juin 1950. Ce jour-là, M. DesaintQuentin, maire, recevait le sous-préfet de Compiègne, M. Patou, les sénateurs Séné et Bouquerel, le député Biondi, le conseiller général Dubé, les maires du canton, Mgr Bellanger… Après un mot d'accueil et de remerciements du maire, le sous-préfet épingla la Croix de Guerre sur le coussin porté par une enfant sur les marches de la mairie. Le discours du représentant du gouvernement retraça l'histoire de la commune durant la guerre et se termina par un appel à l'union de tous les Français. Les archers furent aussi mis à l'honneur puisqu'à cette cérémonie fut couplé un Bouquet provincial dont la parade dans le village réjouit les cœurs émus par cette journée du souvenir.
L'un d'entre eux, Fernand Bohère, fut tué lors d'un bombardement de Dessau, le 7 mars 1945. Le 6 août, les détenus Salenciens de la prison d'arrêt furent internés au camp de Royallieu. Au cours de cette période d'internement, quatorze des dix neuf raflés de Salency furent désignés pour participer aux travaux de dégagement de la gare de Compiègne, en partie détruite par les bombardements alliés. Le 9 août 1944, l'aviation américaine bombarda de nouveau les voies de Compiègne, provoquant d'importantes destructions et de nombreuses morts parmi les gardes allemands et les prisonniers. Trois salenciens y trouvèrent la mort : Georges Boulanger, étouffé sous les gravats, Jean Le Floch, déchiqueté et Ernest Trouvay. Les dix autres salenciens profitèrent des circonstances pour s'évader. Un seul d'entre eux fut repris et renvoyé à Royallieu. Le 17 août, les six hommes restant de la rafle de Salency furent embarqués dans le dernier train partant de Compiègne pour Buchenwald. Quatre d'entre eux décédèrent en déportation : André Boulanger, Frédéric Doré, Jean Picard et Edmond Polin. Plaque et stèle apposées au lieu-dit Le Cavin rappelant la rafle de Salency. Louis Rémia fut relâché en fin de journée. Carbonnier, Derrieux, Dawosyr, Dubois et Marcel Momeux furent relâchés une semaine plus tard. Le 13 juillet, neuf hommes furent désignés pour travailler en Allemagne au titre du STO dans l'industrie de guerre. Il s'agit de Bohère, Desprez, Duchauffour, Lalouette, Lesueur Noël, Lesueur Jeannot, Momeux Maurice, Quillet et James Sézille. Transférés par train dans des wagons à bestiaux à la caserne de la Pépinière à Paris, ils furent dirigés vers Magdebourg où ils furent séparés. Ainsi, Noël Lesueur, Jeannot Lesueur et Reynold Duchauffour travaillèrent dans une usine de munitions. James Sézille, Maurice Momeux et Jean Lalouette devinrent chauffeur de locomotives. Adrien Desprez fut affecté dans un e fonderie d'aluminium. 73 UUU UNE CROIX ET UN BOUQUET UNE UU La cérémonie de remise de la Croix de Guerre avec étoile d'argent se déroula le dimanche 4 juin 1950. Ce jour-là, M. DesaintQuentin, maire, recevait le sous-préfet de Compiègne, M. Patou, les sénateurs Séné et Bouquerel, le député Biondi, le conseiller général Dubé, les maires du canton, Mgr Bellanger… Après un mot d'accueil et de remerciements du maire, le sous-préfet épingla la Croix de Guerre sur le coussin porté par une enfant sur les marches de la mairie. Le discours du représentant du gouvernement retraça l'histoire de la commune durant la guerre et se termina par un appel à l'union de tous les Français. Les archers furent aussi mis à l'honneur puisqu'à cette cérémonie fut couplé un Bouquet provincial dont la parade dans le village réjouit les cœurs émus par cette journée du souvenir.
RIIBECOURT DES ACTIO NS SUR RAIL Ville industrielle et chef-lieu de canton, Ribécourt connut des actions de sabotage par la Résistance locale. Ainsi, le 1er juin 1941, la signalisation de la ligne SNCF fut sabotée. Puis, dans la nuit du 10 au 11 septembre 1943, des FTP (détachement Marseillaise) firent dérailler un train entre Ribécourt et Thourotte. En mai 1944, des FTP enlevèrent des armes et des munitions. D'autres groupes agirent aussi sur ce secteur : dans la nuit du 11 au 12 juillet, des FFI de Compiègne coupèrent le câble Paris-Lille près de Ribécourt. En 1944, les FFI de Ribécourt étaient dirigés par Etienne Karoubi (futur président du CLL puis maire de La commune), Gabriel Regnier, René Martin et Raymond Angot. Le 1er septembre, le jeune André Régnier fut tué dans les combats de la Libération de la ville. LES BOMBES DE L ETE 44 L'attribution de la Croix de Guerre fut légitimée par les destructions provoquées lors des bombardements des voies ferrées. Un premier bombardement eut ainsi lieu le 3 juin 1944, quelques jours avant le débarquement allié en Normandie. Le 22 juin 1944, plus de quatre-vingts wagons d'un train d'armes et de munitions sautèrent dans un bombardement, provoquant d'importants dégâts dans la ville. La gare fut de nouveau prise pour cible par l'aviation alliée le 7 août suivant. Le nom de Ribécourt fut placé sur le devant de la scène Isarienne lorsque le chef de laboratoire de recherches de l'usine de produits chimiques, André Boullevraye de Passillé (ci-contre) , fut nommé sous préfet de Compiègne le 5 septembre 1944. La Croix de Guerre fut décernée à la ville avec attribution de l'étoile de bronze CITATION 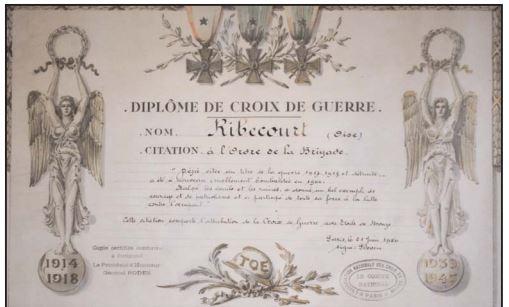 Citation à l'ordre de la Brigade “ Déjà citée au titre de la guerre 1914- 1918 et détruite, a été à nouveau cruellement bombardée en 1944. Malgré les deuils et les ruines, a donné un bel exemple de courage et de patriotisme et a participé de toute sa force à la lutte contre l'occupant.”
Citation à l'ordre de la Brigade “ Déjà citée au titre de la guerre 1914- 1918 et détruite, a été à nouveau cruellement bombardée en 1944. Malgré les deuils et les ruines, a donné un bel exemple de courage et de patriotisme et a participé de toute sa force à la lutte contre l'occupant.”
SAINT LEU
SANS DEFENSE Proche d'une voie navigable (l'Oise), d'une route, d'une voie ferrée et d'une gare de stockage, Saint-Leu-d'Esserent eut également à craindre du rôle stratégique de ses galeries souterraines d'extraction de pierre. Dès octobre 1939, par crainte des bombardements allemands, l'usine métallurgique de Creil-Montataire Brissonneau & Lotz déplaça une partie de sa production de fuselages de bombardiers LéO 45 dans la vaste carrière souterraine du Couvent, à Saint-Leud'Esserent. Un millier d'ouvriers travailla à partir de janvier 1940 dans ces galeries bétonnées, pourvues de ventilations, de chauffages ainsi que de cantines et de dortoirs. Depuis août 1939, des pièces de 75mm servies par des soldats du Régiment d'Artillerie de Défense Contre Avions protégeait la ville qui connut ses premiers bombardements par les Allemands les 18 mai, 21 mai et 1er juin 1940. La population se lança sur les routes de l'exode. Le 8 juin, sous la pression ennemie, le régiment dut quitter ses positions dans un mouvement général de repli de la 10e Armée en rive droite de l'Oise. Certains ponts de l'Oise furent rompus, laissant les troupes à leur sort Les câbles du pont de Saint-Leud'Esserent furent ainsi sectionnés, faisant tomber le tablier dans la rivière. Le 10 juin en soirée, les troupes françaises de la 7e DINA étaient retranchées derrière l'Oise, face à la ville. Saint-Leu-d'Esserent tomba aux mains allemandes. Le nouveau dispositif de défense se figea les 11 et 12 juin derrière l'Oise et la Nonette, le long de la ligne Chauvineau, puis le 13 juin l'ordre de retraite fut lancé. UNE RESISTANCE ACTIVE Une Résistance active Durant l'occupation, l'armée allemande réquisitionna le château de la Guesdière, l'école des garçons et construisit des baraquements pour les hommes de troupes. A partir de décembre 1941, des munitions destinées à la base de Creil furent stockées dans les carrières. Puis, en mai 1943, le 155 Flak Regiment W installa sur 10 ha dans les carrières du Couvent et de SaintChristophe une usine de montage de V1 construits dans l'usine de Peenemunde. Ce dépôt avancé (Feldmulag) fut ouvert le 1er juin 1944 et alimenta 70% des V1 tirés durant ce mois. L'état-major allemand lui attribua le nom de code “ Léopold ”. Des ouvrages fortifiés furent construits dans le bassin creillois (batteries de DCA, bunkers, dépôts d'armes, de munitions, de carburant…) pour défendre le site. Les Alliés furent informés de cette activité notamment grâce aux renseignements fournis par les FTP du groupe Valmy, par les réseaux Marco Polo et Octave, ou par l'Intelligence Service. A Saint-Leud'Esserent, Léon Carbon, responsable Front National, participa à des sabotages dans le détachement Valmy tandis que son épouse transportait des tracts, des messages et des journaux clandestins. L'Hôtel de l'Oise, dirigé par Henriette Peyredevint un lieu de réunions des résistants FTP du bassin creillois.L'un d'entre eux, Marcel Coëne, s'installa chez Madeleine Rifflard et y cacha un dépôt d'armes. Ce réseau permit à deux enrôlés de force dans l'armée allemande d'origine alsacienne, Pierre Michel et Joseph Reith, de livrer de précieux renseignement sur les installations de V1. Il réalisa également des actions de sabotage et organisa, peu après le Débarquement, un maquis dans le Bois Saint-Michel. Dirigé par Roland Jacques, il fut dispersé le 11 juillet 1944. BOMBARDIERS CONTRE V1 Pour lutter contre ces bombes volantes dirigées sur Londres de juin 1943 à août 1944, les Alliés lancèrent en décembre 1943 l'opération Crossbow (Arbalète). Il s'agissait de détruire les sites de stockage et les rampes de lancement. Du 17 mars au 28 août 1944, Saint-Leu-d'Esserent subit dix-huit bombardements imposant à la population demeurée sur place de se réfugier dans des galeries souterraines aménagées en dortoirs, comme celles du Prieuré, de la rue Dernier Bourguignon ou la carrière des Danses. Le message “Ce soir nous irons à la bonne aventure”, envoyé sur les ondes de la BBC début juillet, prévint les résistants du bombardement des carrières proches de la maison du garde-barrière M. Bonnaventure. Dans la nuit du 4 au 5 juillet, 231 Lancasters déversèrent leurs bombes sur le site. Au cours de cette opération, la RAF perdit treize avions détruits par la chasse de nuit de la Luftwaffe, dont sept s'écrasèrent dans le département de l'Oise. Dans la nuit du 7 au 8 juillet, 1138 tonnes de projectiles furent lancés par 221 bombardiers de la RAF qui perdit 31 Lancasters abattus par la chasse allemande et la DCA allemande (la Flak) De nouveau, le 5 août, 431 bombardiers de la RAF 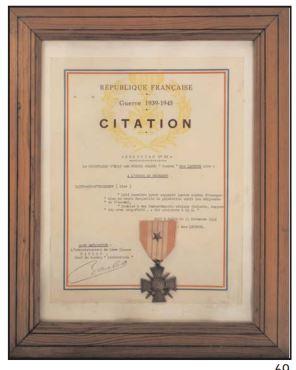 larguèrent 2000 tonnes de bombes sur la commune. Un Halifax touché par la Flak s'abattit au sud-est de la ville, tuant ses huit occupants. Les carrières souterraines résistèrent bien aux bombardements et le site fonctionna jusqu'en août 1944. Des prisonniers soviétiques et des déportés du travail furent utilisés pour évacuer les déblais et travailler aux carrières. Logés dans un camp près de Mouy ou à Précysur-Oise, mal nourris, certains s'évadèrent et furent cachés dans des maquis, comme à Saint-Vaast-les-Mello. Les installations souterraines et une partie des V1 furent détruites par les Allemands lors de leur retraite. Une grande partie des 1600 habitants ayant été évacués, la ville n'eut à déplorer que 16 morts parmi les civils. En outre, sept aviateurs alliés furent abattus par la chasse et la DCA allemandes sur le territoire communal dont William Merriam, pilote d'un Thunderboldt (mort le 3 juin 1944) et cinq hommes d'équipage d'un B-26 Marauder qui s'écrasa le 12 juin 1944. Libérée le 31 août 1944 par les Américains, la ville n'était plus que ruines, détruite à 85%. Ce jour-là, monté sur une moto pour assurer une mission de liaison, Maurice Dubois, résistant FTP, fut abattu au passage à niveau de la ville. CITATION Citation à l'ordre du Régiment “ Cité ouvrière ayant supporté quatre années d'occupation au cours desquelles la population subit les exigences de l'ennemi. Soumise à des bombardements aériens violents, supportés avec sangfroid, a été sinistrée à 85%.”
larguèrent 2000 tonnes de bombes sur la commune. Un Halifax touché par la Flak s'abattit au sud-est de la ville, tuant ses huit occupants. Les carrières souterraines résistèrent bien aux bombardements et le site fonctionna jusqu'en août 1944. Des prisonniers soviétiques et des déportés du travail furent utilisés pour évacuer les déblais et travailler aux carrières. Logés dans un camp près de Mouy ou à Précysur-Oise, mal nourris, certains s'évadèrent et furent cachés dans des maquis, comme à Saint-Vaast-les-Mello. Les installations souterraines et une partie des V1 furent détruites par les Allemands lors de leur retraite. Une grande partie des 1600 habitants ayant été évacués, la ville n'eut à déplorer que 16 morts parmi les civils. En outre, sept aviateurs alliés furent abattus par la chasse et la DCA allemandes sur le territoire communal dont William Merriam, pilote d'un Thunderboldt (mort le 3 juin 1944) et cinq hommes d'équipage d'un B-26 Marauder qui s'écrasa le 12 juin 1944. Libérée le 31 août 1944 par les Américains, la ville n'était plus que ruines, détruite à 85%. Ce jour-là, monté sur une moto pour assurer une mission de liaison, Maurice Dubois, résistant FTP, fut abattu au passage à niveau de la ville. CITATION Citation à l'ordre du Régiment “ Cité ouvrière ayant supporté quatre années d'occupation au cours desquelles la population subit les exigences de l'ennemi. Soumise à des bombardements aériens violents, supportés avec sangfroid, a été sinistrée à 85%.” 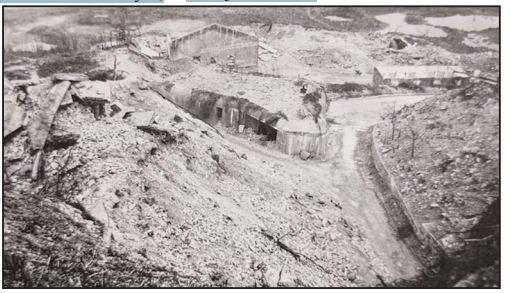
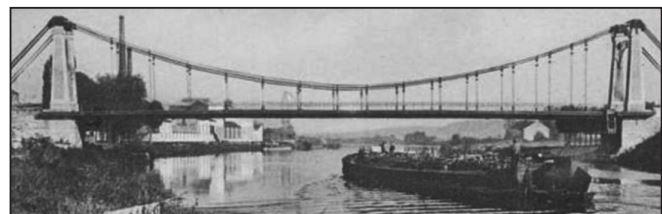
COMPIEGNE
LES BOMBES DE 1940 Dès le 10 mai 1940, Compiègne reçut les premiers blessés de bombardements allemands. L'exode commença : 30 000 évacués traversèrent la ville chaque jour, à la recherche de ravitaillement. Le 17 mai 1940, à midi, un avion allemand mitrailla un train civil en gare avant d'être abattu par un avion français. Deux heures plus tard, des bombardiers allemands lâchaient leurs bombes sur la ville tuant 18 personnes et en blessant 80 autres. L'Ecole d'Etat-major fut dissoute et les officiers vinrent en appui des troupes. Le 18 mai, Compiègne subit cinq bombardements sur son centre. Le 20 mai, le centre-ville fut de nouveau bombardé sept fois. Le lendemain, l'autorité militaire ordonna l'évacuation, mais cette décision fut rapportée le jour suivant. Jusqu'au 25 mai, Compiègne connut d'importants bombardements qui ravagèrent le centre historique de la ville. Le 6 juin, un nouvel ordre d'évacuation fut lancé. L'exode des derniers civils compliqua le repli des troupes françaises dans une ville protégée par un bataillon d'instruction du 141e RI, deux compagnies polonaises et des gardes civiles. Malgré la destruction du pont sur l'Oise la veille, la 94e Division d'Infanterie allemande occupa Compiègne le 9 juin Le général Blaskowitz, nommé par Hitler gouverneur militaire en France, installa son administration à Compiègne le 13 juin. Le général Streccius le remplaça le 30 suivant. Les bombes de mai - juin 1940 avaient détruit cinq maisons et endommagé 314 autres  LA VILLE DE L ARMISTICE Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain nommé président du Conseil des ministres annonça à la radio sa demande de cessation des combats. Goebbels, ministre allemand de la propagande, aurait alors suggéré à Adolf Hitler de signer l'armistice sur les lieux mêmes de celui du 11 novembre 1918, dans la célèbre Clairière de Compiègne, près de la gare de Rethondes. Le 21 juin, Hitler atterrit sur l'aérodrome de Corbeaulieu pour rejoind re la clairière où se tenait la délégation allemande constituée de Wilhelm Keitel, Rudolf Hess, Hermann Göring, Erich Raeder et Joachim von Ribbentrop. Après avoir reçu les honneurs et contemplé avec dédain la dalle sacrée, ils pénétrèrent dans la voiture du maréchal Foch sortie de son musée l'avant-veille. Vers 15h30, la délégation française nommée par le général Weygand prit place dans le wagon historique. Constituée de Charles Huntziger, Léon Noël, Jean Bergeret et Maurice Le Luc, elle reçut le préambule des négociations, lu par Keitel : “C'est dans le même wagon que commença le calvaire du peuple allemand… Cet endroit a été choisi pour effacer une fois pour toutes, par un acte de justice réparateur, un souvenir qui, pour la France, n'était pas une page honorable de son histoire… La France est vaincue. Le but de l'Allemagne est d'empêcher une reprise des hostilités, d'offrir aux armées du Reich toute sécurité pour poursuivre la guerre contre l'Angleterre…”. Hitler quitta alors les lieux, en ordonna la destruction et fut conduit à Compiègne dans l'hôtel particulier qu'avait réquisitionné le général Blaskowitz. Signé le lendemain, 22 juin, l'armistice n'entra en vigueur que le 25, à 00h35, une fois l'armistice avec l'Italie signé. LE CAMP DE ROYALLIEU L Ouvert en 1940, le Frontstalag 170KM 654 compta jusqu'à 6000 prisonniers de différentes nationalités, dont bon nombre furent déportés en Allemagne. Avec l'invasion de l'Union soviétique le 21 juin 1941, la caserne de Royallieu devint un “camp de concentration permanent pour éléments ennemis actifs” puis “camp de détention de police” sous le contrôle direct de l'armée allemande. Il fut désigné sous le nom Frontstalag 122. A la suite d'assassinats perpétrés contre l'occupant, les civils qui y étaient internés, majoritairement des politiques (communistes), furent considérés comme otages. Plusieurs d'entre eux furent fusillés en représailles d’attentats en forêt de Compiègne, à Amiens ou au MontOuvert en 1940, le Frontstalag 170KM 654 compta jusqu'à 6000 prisonniers de différentes nationalités, dont bon nombre furent déportés en Allemagne. Avec l'invasion de l'Union soviétique le 21 juin 1941, la caserne de Royallieu devint un “camp de concentration permanent pour éléments ennemis actifs” puis “camp de détention de police” sous le contrôle direct de l'armée allemande. Il fut désigné sous le nom Frontstalag 122. A la suite d'assassinats perpétrés contre l'occupant, les civils qui y étaient internés, majoritairement des politiques (communistes), furent considérés comme otages. Plusieurs d'entre eux furent fusillés en représailles d’attentats en forêt de Compiègne, à Amiens ou au MontValérien. A la politique de fusillades des otages succéda la déportation des otages à l'est. Entre le 27 mars 1942 et le 17 août 1944, trente convois de déportés quittèrent Compiègne pour les camps d'extermination ou de concentration d'Allemagne, soit près de 40000 détenus. Les convois des 27 mars et 5 juin 1942 étaient constitués d'otages juifs, celui du 24 janvier 1943 exclusivement de femmes.
LA VILLE DE L ARMISTICE Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain nommé président du Conseil des ministres annonça à la radio sa demande de cessation des combats. Goebbels, ministre allemand de la propagande, aurait alors suggéré à Adolf Hitler de signer l'armistice sur les lieux mêmes de celui du 11 novembre 1918, dans la célèbre Clairière de Compiègne, près de la gare de Rethondes. Le 21 juin, Hitler atterrit sur l'aérodrome de Corbeaulieu pour rejoind re la clairière où se tenait la délégation allemande constituée de Wilhelm Keitel, Rudolf Hess, Hermann Göring, Erich Raeder et Joachim von Ribbentrop. Après avoir reçu les honneurs et contemplé avec dédain la dalle sacrée, ils pénétrèrent dans la voiture du maréchal Foch sortie de son musée l'avant-veille. Vers 15h30, la délégation française nommée par le général Weygand prit place dans le wagon historique. Constituée de Charles Huntziger, Léon Noël, Jean Bergeret et Maurice Le Luc, elle reçut le préambule des négociations, lu par Keitel : “C'est dans le même wagon que commença le calvaire du peuple allemand… Cet endroit a été choisi pour effacer une fois pour toutes, par un acte de justice réparateur, un souvenir qui, pour la France, n'était pas une page honorable de son histoire… La France est vaincue. Le but de l'Allemagne est d'empêcher une reprise des hostilités, d'offrir aux armées du Reich toute sécurité pour poursuivre la guerre contre l'Angleterre…”. Hitler quitta alors les lieux, en ordonna la destruction et fut conduit à Compiègne dans l'hôtel particulier qu'avait réquisitionné le général Blaskowitz. Signé le lendemain, 22 juin, l'armistice n'entra en vigueur que le 25, à 00h35, une fois l'armistice avec l'Italie signé. LE CAMP DE ROYALLIEU L Ouvert en 1940, le Frontstalag 170KM 654 compta jusqu'à 6000 prisonniers de différentes nationalités, dont bon nombre furent déportés en Allemagne. Avec l'invasion de l'Union soviétique le 21 juin 1941, la caserne de Royallieu devint un “camp de concentration permanent pour éléments ennemis actifs” puis “camp de détention de police” sous le contrôle direct de l'armée allemande. Il fut désigné sous le nom Frontstalag 122. A la suite d'assassinats perpétrés contre l'occupant, les civils qui y étaient internés, majoritairement des politiques (communistes), furent considérés comme otages. Plusieurs d'entre eux furent fusillés en représailles d’attentats en forêt de Compiègne, à Amiens ou au MontOuvert en 1940, le Frontstalag 170KM 654 compta jusqu'à 6000 prisonniers de différentes nationalités, dont bon nombre furent déportés en Allemagne. Avec l'invasion de l'Union soviétique le 21 juin 1941, la caserne de Royallieu devint un “camp de concentration permanent pour éléments ennemis actifs” puis “camp de détention de police” sous le contrôle direct de l'armée allemande. Il fut désigné sous le nom Frontstalag 122. A la suite d'assassinats perpétrés contre l'occupant, les civils qui y étaient internés, majoritairement des politiques (communistes), furent considérés comme otages. Plusieurs d'entre eux furent fusillés en représailles d’attentats en forêt de Compiègne, à Amiens ou au MontValérien. A la politique de fusillades des otages succéda la déportation des otages à l'est. Entre le 27 mars 1942 et le 17 août 1944, trente convois de déportés quittèrent Compiègne pour les camps d'extermination ou de concentration d'Allemagne, soit près de 40000 détenus. Les convois des 27 mars et 5 juin 1942 étaient constitués d'otages juifs, celui du 24 janvier 1943 exclusivement de femmes. 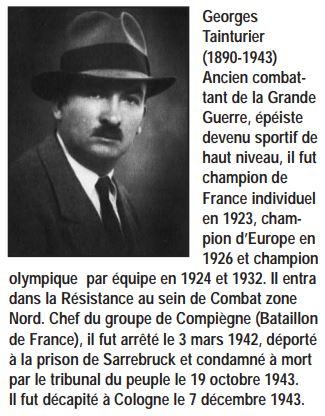 COLLABORATION ET RESISTANCE En l'absence du maire James de Rothschild, mobilisé puis rallié à la France Libre, la municipalité eut à sa tête le 1er adjoint Daniel, puis le 2e adjoint Cosyns avant que ne fut désigné Jean Lhuillier comme maire en janvier 1941. Le conseil municipal, qui manifesta sa fidélité au maréchal Pétain, travailla à la reconstruction de la ville et au ravitaillement des habitants. La ville connut d'importantes déportations raciales, notamment à la suite des rafles des 19 juillet 1942 et 4 janvier 1944 qui conduisirent trente trois juifs de Compiègne à Drancy puis aux chambres à gaz d'Auschwitz. Face à l'administration de Vichy et allemande, des résistants s'organisèrent en réseaux et mouvements pou r aider les aviateurs alliés, renseigner sur les positions allemandes, diffuser de la contrepropagande ou réaliser des sabotages. Compiègne connut le Bataillon de France (Georges Tainturier), le groupe Bleuets (André Pons) lié au réseau Buckmaster, le groupe de la Police rattaché au Front National (Hubert Laffitte), les réseaux Hunter et Tempo, les mouvements Résistance (Eugénie Louis, André Baduel), OCM (Amédée Bouquerelle), les FTP (Norbert Hilger puis Gabriel Leclercq)… Plusieurs de ces réseaux furent démantelés et une quarantaine de Compiégnois décédèrent en déportation. Georges Tainturier (1890-1943) Ancien combattant de la Grande Guerre, épéiste devenu sportif de haut niveau, il fut champion de France individuel en 1923, champion d’Europe en 1926 et champion olympique par équipe en 1924 et 1932. Il entra dans la Résistance au sein de Combat zone Nord. Chef du groupe de Compiègne (Bataillon de France), il fut arrêté le 3 mars 1942, déporté à la prison de Sarrebruck et condamné à mort par le tribunal du peuple le 19 octobre 1943. Il fut décapité à Cologne le 7 décembre 1943 LE RETOUR DES PRISONNIERS Le 22 juin 1942, Pierre Laval, rappelé à la tête du gouvernement deux mois plus tôt, annonça à la radio l'instauration de la Relève, dispositif permettant le retour de prisonniers de guerre en contrepartie du départ d'ouvriers qualifiés volontaires pour travailler en Allemagne. La ville de Compiègne fut choisie pour accueillir les prisonniers au Quartier Bourcier, converti en Centre de Réception et de Triage des Prisonniers de Guerre (CRTPG). Le 11 août 1942, une cérémonie très médiatisée célébra en gare de Compiègne l’accueil du premier train de 1300 prisonniers libérés des Stalags 1A et 1B et du départ d'un train de volontaires Pierre Laval y justifia sa politique de collaboration, en présence d'autorités militaires allemandes dont les délégués d'Otto Abetz, ambassadeur de l'Allemagne, et de Fritz Sauckel, plénipotentiaire général pour l'emploi de la main d'œuvre. Le peu de succès de ce dispositif conduisit Pierre Laval à créer le Service du Travail Obligatoire par la loi du 16 février 1943
COLLABORATION ET RESISTANCE En l'absence du maire James de Rothschild, mobilisé puis rallié à la France Libre, la municipalité eut à sa tête le 1er adjoint Daniel, puis le 2e adjoint Cosyns avant que ne fut désigné Jean Lhuillier comme maire en janvier 1941. Le conseil municipal, qui manifesta sa fidélité au maréchal Pétain, travailla à la reconstruction de la ville et au ravitaillement des habitants. La ville connut d'importantes déportations raciales, notamment à la suite des rafles des 19 juillet 1942 et 4 janvier 1944 qui conduisirent trente trois juifs de Compiègne à Drancy puis aux chambres à gaz d'Auschwitz. Face à l'administration de Vichy et allemande, des résistants s'organisèrent en réseaux et mouvements pou r aider les aviateurs alliés, renseigner sur les positions allemandes, diffuser de la contrepropagande ou réaliser des sabotages. Compiègne connut le Bataillon de France (Georges Tainturier), le groupe Bleuets (André Pons) lié au réseau Buckmaster, le groupe de la Police rattaché au Front National (Hubert Laffitte), les réseaux Hunter et Tempo, les mouvements Résistance (Eugénie Louis, André Baduel), OCM (Amédée Bouquerelle), les FTP (Norbert Hilger puis Gabriel Leclercq)… Plusieurs de ces réseaux furent démantelés et une quarantaine de Compiégnois décédèrent en déportation. Georges Tainturier (1890-1943) Ancien combattant de la Grande Guerre, épéiste devenu sportif de haut niveau, il fut champion de France individuel en 1923, champion d’Europe en 1926 et champion olympique par équipe en 1924 et 1932. Il entra dans la Résistance au sein de Combat zone Nord. Chef du groupe de Compiègne (Bataillon de France), il fut arrêté le 3 mars 1942, déporté à la prison de Sarrebruck et condamné à mort par le tribunal du peuple le 19 octobre 1943. Il fut décapité à Cologne le 7 décembre 1943 LE RETOUR DES PRISONNIERS Le 22 juin 1942, Pierre Laval, rappelé à la tête du gouvernement deux mois plus tôt, annonça à la radio l'instauration de la Relève, dispositif permettant le retour de prisonniers de guerre en contrepartie du départ d'ouvriers qualifiés volontaires pour travailler en Allemagne. La ville de Compiègne fut choisie pour accueillir les prisonniers au Quartier Bourcier, converti en Centre de Réception et de Triage des Prisonniers de Guerre (CRTPG). Le 11 août 1942, une cérémonie très médiatisée célébra en gare de Compiègne l’accueil du premier train de 1300 prisonniers libérés des Stalags 1A et 1B et du départ d'un train de volontaires Pierre Laval y justifia sa politique de collaboration, en présence d'autorités militaires allemandes dont les délégués d'Otto Abetz, ambassadeur de l'Allemagne, et de Fritz Sauckel, plénipotentiaire général pour l'emploi de la main d'œuvre. Le peu de succès de ce dispositif conduisit Pierre Laval à créer le Service du Travail Obligatoire par la loi du 16 février 1943
LES BOMBARDEMRNTS ALLIES S
Entre le 14 mai et le 31 août 1944, Compiègne connut plusieurs bombardements alliés prenant pour cible la gare et les ponts. Ainsi, le 11 juin, un bombardement toucha le dépôt des machines de la gare de Compiègne. Le 21 juin, un autre toucha la cité des cheminots. Quatre jours plus tard, dans l'espoir d'éviter de nouveaux bombardements et d'obtenir une libération heureuse, le conseil municipal et le clergé, réunis dans l'église Saint Jacques, firent vœu de se rendre chaque 15 août en action de grâces au sanctuaire de Notre-Dame de Bon -Secours. L'activité de l'aviation alliée devint massive en août suivant. Le 5 août, entre 12h05 et 12h10, 150 bombes de gros calibres furent larguées sur le quartier de la gare par quatre vagues de six bombardiers alliés tuant 33 personnes (dont six cheminots) et blessant 69 autres. Les bombardements alliés On dénombra 87 points de chute en ville et 410 sinistrés. Le 9 août 1944, entre 12h35 et 12h39, six vagues de six bombardiers américains déversèrent une centaine de bombes sur le pont ferroviaire (dont la travée centrale fut détruite), la ligne Compiègne-Soissons, les rives de l'Oise et le chantier des voies ferrées en cours de réparation par 200 internés du camp de Royallieu. Durant le bombardement, les sentinelles allemandes interdirent aux détenus de se mettre à l'abri et mitraillèrent les fuyards. Une vingtaine d'habitants et une soixantaine d'internés furent tués. Une vingtaine de détenus parvinrent à s'enfuir. Le lendemain, 10 août, vers 18h20, le dépôt des machines de la ville fut bombardé par quatre avions. Une dernière action aérienne alliée eut lieu le 13 août. Le quartier du Petit-Margny fut presqu'entièrement rasé par les bombardements de l'été 44. DE LA LIBERATION A LA PURIFICATION L'avancée américaine fut accompagnée par de nombreux actes de sabotage de la part de la Résistance. Le 31 août, la 47e Division Blindée allemande tint un front en limite sud de la forêt de Compiègne, fermant ainsi la route aux 4e Division d'Infanterie et 5e Division Blindée américaine. Le lendemain, 1er septembre, le Ve Corps d'Armée américain fit son entrée dans Compiègne et lança un nouveau pont sur l'Oise pour pousser son avance en rive droite. Les FFI compiégnois prirent possession des sites stratégiques et procédèrent au “ nettoyage” de la ville. Un Comité Local de Libération prit possession de la mairie et décida, le 5 septembre, de maintenir Jean Lhuillier parmi les membres du conseil provisoire qui élit Emile Dubé comme président le 15. Le 21 octobre 1944, à l'occasion de la visite du général Koenig, du général Chaban Delmas, du commissaire régional de la République Pierre Pène et du préfet Pérony, une première cérémonie se tint à la Clairière de l'Armistice où trônait, seule, la statue de Foch Le 11 novembre suivant, une cérémonie de purification des lieux permit de renouer la France à son histoire et d'assainir un site symbolique souillé par les nazis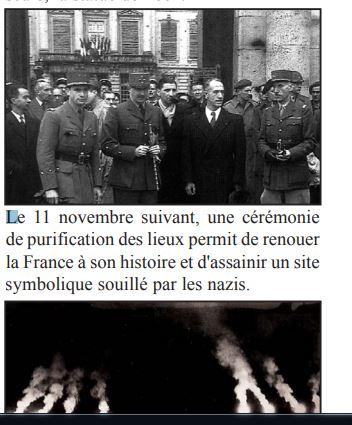
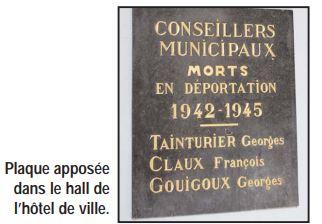
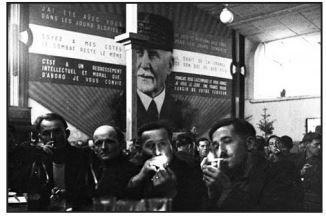
CREPY EN VALOIS
LES COMBATS DE JUIN 40 Crépy connut un premier bombardement peu après le 10 mai, l'aviation allemande ayant pris pour cible la voie de chemin de fer. Le 18 mai, un bombardement toucha la ville, tuant des civils et des soldats français employés à la boulangerie militaire. La nuit suivante, l'exode des Crépynois commença. Un nouveau bombardement affecta la ville les 20 et 23 mai tuant des habitants ainsi que vingt-trois soldats dans un train. L'ordre officiel d'évacuation fut donné par les autorités une première fois le 23 mai, puis, après une courte période de calme, une seconde fois le 8 juin. Entretemps, la ville avait subi un 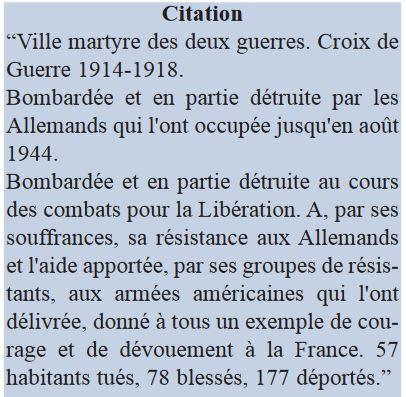 bombardement le 26 mai. Avec la mise en place de la ligne Weygand, Crépy-en-Valois se trouva dans le périmètre de la 11e DI puis de la 87e Division d'Infanterie d'Afrique (DIA) le 7 juin. Le soir même, les Allemands parvinrent à franchir l'Aisne à l'est de Soissons provoquant le repli progressif des forces françaises sur l'Ourcq le 9 juin. Ce jour-là, en fin d'après-midi, Crépy-en-Valois essuya un bombardement qui embrasa les rues Jeanne d'Arc et Nationale. Le 10 juin, face à la poussée allemande, la 87e DIA tenta de se replier par Crépy-en-Valois, sous la protection de la 3e Division Légère d'Afrique (DLA) La ville étant déjà tombée aux mains ennemies, le 11 juin, le 1er bataillon du 17e Tirailleurs Algériens, aidé du 141e RI, tenta de bousculer les barricades allemandes. Malgré les attaques de nuit menées par le 17e Tirailleurs Algériens et le 141e Régiment d'Infanterie, le passage ne put être forcé et il fallut l'aide du 9e Zouaves pour permettre de se dégager. Protégeant le repli, ce dernier parvint à tenir ses positions puis à se dégager en petits groupes dans la nuit du 12 au 13 juin UNE RESISTANCE ACTIVE Les premiers habitants revinrent fin juin dans la ville administrée par un commerçant puis le juge de paix, en l'absence du maire Jean Vassal. Ce dernier reprit sa place à son place à son retour, le 5 juillet. Il fut maintenu à son poste par Vichy. Dès décembre 1940, un premier groupe de résistants se forma à Crépy-en-Valois, lequel se rattacha aux FTP deux ans plus tard. Parmi ces résistants, le mécanicien Les premiers habitants revinrent fin juin dans la ville administrée par un commerçant puis le juge de paix, en l'absence du maire Jean Vassal. Ce dernier reprit sa place à son retour Gabriel Bellard fut arrêté le 31 mars 1943. Interné à Compiègne, Saint-Quentin puis Royallieu, il parvint à s'évader du train de déportés et regagna la Résistance en région parisienne. Un autre, Marcel Page fut déporté. Ce groupe réalisa l'attaque de la gendarmerie de Crépy-en-Valois le 26 janvier 1944.Les premiers habitants revinrent fin juin dans la ville administrée par un commerçant puis le juge de paix, en l'absence du maire Jean Vassal. Ce dernier reprit sa place à s on retour, le 5 juillet. Il fut maintenu à son poste par Vichy. Dès décembre 1940, un premier groupe de résistants se forma à Crépy-en-Valois, lequel se rattacha aux FTP deux ans plus tard. Parmi ces résistants, le mécanicien Gabriel Bellard fut arrêté le 31 mars 1943. Interné à Compiègne, Saint-Quentin puis Royallieu, il parvint à s'évader du train de déportés et regagna la Résistance en région parisienne. Un autre, Marcel Page fut déporté. Ce groupe réalisa l'attaque de la gendarmerie de Crépy-en-Valois le 26 janvier 1944.Un second groupe, né fin 1940, se rattacha à l'OCM. Ses membres, M. Dhaussy, Paul Pauchet (chef de district à la SNCF, arrêté le 7 décembre 1943, mort en déportation), Georges Ardenois, Ernest Véry, Georges Détré, Jacques Gardinier, Léon Mercier, Turenne Dervillé, François Soret (déporté)… travaillèrent aussi au sein de réseaux de renseignements et de parachutages. ( Jean Vassal (1870-1953) Maire de Crépyen-Valois de 1919 à 1953 et député SFIO de l’Oise de 1928 à 1942, il est absent lors du vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain° ) LA GARE POUR CIBLE A partir de mai 1944, l'aviation alliée procéda à des survols de la ville à basse altitude et au mitraillage ou au bombardement de la voie ferrée. Plusieurs cheminots de Crépy furent tués lors des interventions aériennes anglaises, tels Ernest Estier, le 24 mai, Frédéric Demazure, le 27 mai, et Ferdinand Ledoux le 28 mai. Puis, avec le Débarquement, les bombardements s'intensifièrent. Le 17 juin, deux “ doubles-queues ” déversèrent onze bombes sur les avenues de Senlis et Pasteur et rue Sainte-Agathe provoquant d'importants dégâts. Le 19 juin, le bombardement d'un train stationné dans la gare blessa plusieurs voyageurs. Un nouveau bombardement, le 27 juin, détruisit le bâtiment de la Petite Vitesse et fit deux tués. Les mitraillages se poursuivirent en juillet et août provoquant la mort du Crépynois François Fauvel le 1er août et l'incendie du magasin d'un grainetier le 12 août Le 16 août, un dernier train arriva en gare de Crépy en provenance de la capitale, qui fut libérée quelques jours plus tard. Commença alors le long défilé des troupes allemandes en retraite. Le 28 août, dans la confusion de la libération, le Crépynois Marie Rotsen fut abattu par une rafale de mitraillette et achevé d'une balle dans la tête par un officier allemand. Deux jours plus tard, tandis que des échanges d'artillerie retentissaient aux abords de la ville, des blindés allemands traversèrent Crépy. Le 31 août, la ville vide d'Allemands était libérée par les Américains Les allemands porte de Paris
bombardement le 26 mai. Avec la mise en place de la ligne Weygand, Crépy-en-Valois se trouva dans le périmètre de la 11e DI puis de la 87e Division d'Infanterie d'Afrique (DIA) le 7 juin. Le soir même, les Allemands parvinrent à franchir l'Aisne à l'est de Soissons provoquant le repli progressif des forces françaises sur l'Ourcq le 9 juin. Ce jour-là, en fin d'après-midi, Crépy-en-Valois essuya un bombardement qui embrasa les rues Jeanne d'Arc et Nationale. Le 10 juin, face à la poussée allemande, la 87e DIA tenta de se replier par Crépy-en-Valois, sous la protection de la 3e Division Légère d'Afrique (DLA) La ville étant déjà tombée aux mains ennemies, le 11 juin, le 1er bataillon du 17e Tirailleurs Algériens, aidé du 141e RI, tenta de bousculer les barricades allemandes. Malgré les attaques de nuit menées par le 17e Tirailleurs Algériens et le 141e Régiment d'Infanterie, le passage ne put être forcé et il fallut l'aide du 9e Zouaves pour permettre de se dégager. Protégeant le repli, ce dernier parvint à tenir ses positions puis à se dégager en petits groupes dans la nuit du 12 au 13 juin UNE RESISTANCE ACTIVE Les premiers habitants revinrent fin juin dans la ville administrée par un commerçant puis le juge de paix, en l'absence du maire Jean Vassal. Ce dernier reprit sa place à son place à son retour, le 5 juillet. Il fut maintenu à son poste par Vichy. Dès décembre 1940, un premier groupe de résistants se forma à Crépy-en-Valois, lequel se rattacha aux FTP deux ans plus tard. Parmi ces résistants, le mécanicien Les premiers habitants revinrent fin juin dans la ville administrée par un commerçant puis le juge de paix, en l'absence du maire Jean Vassal. Ce dernier reprit sa place à son retour Gabriel Bellard fut arrêté le 31 mars 1943. Interné à Compiègne, Saint-Quentin puis Royallieu, il parvint à s'évader du train de déportés et regagna la Résistance en région parisienne. Un autre, Marcel Page fut déporté. Ce groupe réalisa l'attaque de la gendarmerie de Crépy-en-Valois le 26 janvier 1944.Les premiers habitants revinrent fin juin dans la ville administrée par un commerçant puis le juge de paix, en l'absence du maire Jean Vassal. Ce dernier reprit sa place à s on retour, le 5 juillet. Il fut maintenu à son poste par Vichy. Dès décembre 1940, un premier groupe de résistants se forma à Crépy-en-Valois, lequel se rattacha aux FTP deux ans plus tard. Parmi ces résistants, le mécanicien Gabriel Bellard fut arrêté le 31 mars 1943. Interné à Compiègne, Saint-Quentin puis Royallieu, il parvint à s'évader du train de déportés et regagna la Résistance en région parisienne. Un autre, Marcel Page fut déporté. Ce groupe réalisa l'attaque de la gendarmerie de Crépy-en-Valois le 26 janvier 1944.Un second groupe, né fin 1940, se rattacha à l'OCM. Ses membres, M. Dhaussy, Paul Pauchet (chef de district à la SNCF, arrêté le 7 décembre 1943, mort en déportation), Georges Ardenois, Ernest Véry, Georges Détré, Jacques Gardinier, Léon Mercier, Turenne Dervillé, François Soret (déporté)… travaillèrent aussi au sein de réseaux de renseignements et de parachutages. ( Jean Vassal (1870-1953) Maire de Crépyen-Valois de 1919 à 1953 et député SFIO de l’Oise de 1928 à 1942, il est absent lors du vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain° ) LA GARE POUR CIBLE A partir de mai 1944, l'aviation alliée procéda à des survols de la ville à basse altitude et au mitraillage ou au bombardement de la voie ferrée. Plusieurs cheminots de Crépy furent tués lors des interventions aériennes anglaises, tels Ernest Estier, le 24 mai, Frédéric Demazure, le 27 mai, et Ferdinand Ledoux le 28 mai. Puis, avec le Débarquement, les bombardements s'intensifièrent. Le 17 juin, deux “ doubles-queues ” déversèrent onze bombes sur les avenues de Senlis et Pasteur et rue Sainte-Agathe provoquant d'importants dégâts. Le 19 juin, le bombardement d'un train stationné dans la gare blessa plusieurs voyageurs. Un nouveau bombardement, le 27 juin, détruisit le bâtiment de la Petite Vitesse et fit deux tués. Les mitraillages se poursuivirent en juillet et août provoquant la mort du Crépynois François Fauvel le 1er août et l'incendie du magasin d'un grainetier le 12 août Le 16 août, un dernier train arriva en gare de Crépy en provenance de la capitale, qui fut libérée quelques jours plus tard. Commença alors le long défilé des troupes allemandes en retraite. Le 28 août, dans la confusion de la libération, le Crépynois Marie Rotsen fut abattu par une rafale de mitraillette et achevé d'une balle dans la tête par un officier allemand. Deux jours plus tard, tandis que des échanges d'artillerie retentissaient aux abords de la ville, des blindés allemands traversèrent Crépy. Le 31 août, la ville vide d'Allemands était libérée par les Américains Les allemands porte de Paris
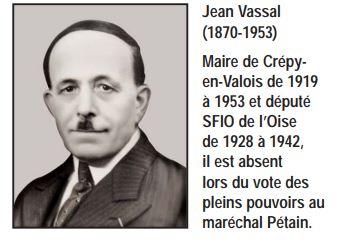
CROUTOY
LES COMBATS DU 9 JUIN A Croutoy, les hostilités commencèrent le 21 mai 1940, avec la destruction partielle du pont d'Attichy par le Génie. Dans la soirée, les gendarmes prévinrent le maire de l'ordre d'évacuation de la population. Les jours suivants, les militaires prenaient possession des lieux. Le château devint l'état-major du 237e RI puis du 1er Bataillon du 170e RI. Le 8 juin, Croutoy fut transformé en point d'appui par les troupes en repli et se trouva encerclé. Le 9 juin, le village fut soumis à des bombardements aériens ciblés auxquels succédèrent des combats de rue acharnés. Les pertes françaises s'élevèrent à neuf soldats et trois brancardiers du 170e RI, un soldat du 26e RI, un autre du 8e RAD et six hommes du Groupe des brancardiers divisionnaires. Ces derniers furent exécutés tandis qu’ils sortaient d’une cave. Tous furent inhumés sur la place de l'église. Lors de leur exhumation, en 1941, les corps avaient le bras droit sectionné au niveau du poignet… Les combats pour le passage de l'Aisne se poursuivirent dans la nuit et le lendemain. Le 25 juin, lorsque la population revint dans le village, vingt-cinq maisons avaient été brûlées ou bombardées. Malgré son aspect sinistré, le village fut le lieu de cantonnement de la Wehrmacht et de la Luftwaffe. L'armée allemande construisit avec les ruines des maisons les pistes d'un terrain d'aviation sur le plateau et procéda régulièrement à des réquisitions. Si le premier plan de reconstruction du village dessiné par M. Le Caisne, architecte-urbaniste, fut proposé à la commune en juillet 1943, les travaux ne furent menés que six ans plus tard. Avec le Débarquement en Normandie, le terrain d'aviation de Croutoy fut réactivé par la Luftwaffe et bombardé par les avions alliés. Le village fut libéré le 1er septembre 1944 par la 1ère Armée américaine à la poursuite des Allemands en retraite. En novembre, le terrain d'aviation fut reconverti par le Continental Central Prisoners of War Enclosure (CCPWE) en camp de prisonniers, le plus important de France, avec un effectif de détenus allemands qui put atteindre 100 000 hommes. Ce camp ferma début 1947 et les terrains furent rendus à la culture l'année suivante. LES PERTES LES LABEURS ET LES DEUILS 

 Les travaux de reconstruction des 23 maisons totalement détruites commencèrent le 25 mars 1949, jour de la cérémonie de pose de la première pierre. Les travaux furent officiellement achevés le 23 mai 1954, jour de la cérémonie dite “de la résurrection de Croutoy ”. Entre-temps, le 10 septembre 1950, la Croix de Guerre avait été remise à la commune par le souspréfet de Compiègne, M. Patou. Le général de France, maire de Croutoy, avait prononcé un discours d'espoir et d'union : “Oh ! vous qui m'écoutez et qui, suivant votre âge, avez été des témoins ou des acteurs dans ces périodes d'incertitude, de souffrances, de dévastations, Vous, les Anciens Combattants des deux guerres, Vous, les anciens prisonniers, les déportés, à qui s'adresse mon admiration pour le caractère tenace et persévérant de votre attitude à l'égard de vos geôliers pendant Les travaux de reconstruction des 23 maisons totalement détruites commencèrent le 25 mars 1949, jour de la cérémonie de pose de la première pierre. Les travaux furent officiellement achevés le 23 mai 1954, jour de la cérémonie dite “de la résurrection de Croutoy ”. Entre-temps, le 10 septembre 1950, la Croix de Guerre avait été remise à la commune par le souspréfet de Compiègne, M. Patou. Le général de France, maire de Croutoy, avait prononcé un discours d'espoir et d'union : “Oh ! vous qui m'écoutez et qui, suivant votre âge, avez été des témoins ou des acteurs dans ces périodes d'incertitude, de souffrances, de dévastations, Vous, les Anciens Combattants des deux guerres, Vous, les anciens prisonniers, les déportés, à qui s'adresse mon admiration pour le caractère tenace et persévérant de votre attitude à l'égard de vos geôliers pendanLes travaux de reconstruction des 23 maisons totalement détruites commencèrent le 25 mars 1949, jour de la cérémonie de pose de la première pierre. Les travaux furent officiellement achevés le 23 mai 1954, jour de la cérémonie dite “de la résurrection de Croutoy ”. Entre-temps, le 10 septembre 1950, la Croix de Guerre avait été remise à la commune par le souspréfet de Compiègne, M. Patou. Le général de France, maire de Croutoy, avait prononcé un discours d'espoir et d'union : “Oh ! vous qui m'écoutez et qui, suivant votre âge, avez été des témoins ou des acteurs dans ces périodes d'incertitude, de souffrances, de dévastations, Vous, les Anciens Combattants des deux guerres, Vous, les anciens prisonniers, les déportés, à qui s'adresse mon admiration pour le caractère tenace et persévérant de votre attitude à l'égard de vos geôliers pendanLes travaux de reconstruction des 23 maisons totalement détruites commencèrent le 25 mars 1949, jour de la cérémonie de pose de la première pierre. Les travaux furent officiellement achevés le 23 mai 1954, jour de la cérémonie dite “de la résurrection de Croutoy ”. Entre-temps, le 10 septembre 1950, la Croix de Guerre avait été remise à la commune par le souspréfet de Compiègne, M. Patou. Le général de France, maire de Croutoy, avait prononcé un discours d'espoir et d'union : “Oh ! vous qui m'écoutez et qui, suivant votre âge, avez été des témoins ou des acteurs dans ces périodes d'incertitude, de souffrances, de dévastations, Vous, les Anciens Combattants des deux guerres, Vous, les anciens prisonniers, les déportés, à qui s'adresse mon admiration pour le caractère tenace et persévérant de votre attitude à l'égard de vos geôliers pendanLes travaux de reconstruction des 23 maisons totalement détruites commencèrent le 25 mars 1949, jour de la cérémonie de pose de la première pierre. Les travaux furent officiellement achevés le 23 mai 1954, jour de la cérémonie dite “de la résurrection de Croutoy ”. Entre-temps, le 10 septembre 1950, la Croix de Guerre avait été remise à la commune par le souspréfet de Compiègne, M. Patou. Le général de France, maire de Croutoy, avait prononcé un discours d'espoir et d'union : “Oh ! vous qui m'écoutez et qui, suivant votre âge, avez été des témoins ou des acteurs dans ces périodes d'incertitude, de souffrances, de dévastations, Vous, les Anciens Combattants des deux guerres, Vous, les anciens prisonniers, les déportés, à qui s'adresse mon admiration pour le caractère tenace et persévérant de votre attitude à l'égard de vos geôliers pendanLes travaux de reconstruction des 23 maisons totalement détruites commencèrent le 25 mars 1949, jour de la cérémonie de pose de la première pierre. Les travaux furent officiellement achevés le 23 mai 1954, jour de la cérémonie dite “de la résurrection de Croutoy ”. Entre-temps, le 10 septembre 1950, la Croix de Guerre avait été remise à la commune par le souspréfet de Compiègne, M. Patou. Le général de France, maire de Croutoy, avait prononcé un discours d'espoir et d'union : “Oh ! vous qui m'écoutez et qui, suivant votre âge, avez été des témoins ou des acteurs dans ces périodes d'incertitude, de souffrances, de dévastations, Vous, les Anciens Combattants des deux guerres, Vous, les anciens prisonniers, les déportés, à qui s'adresse mon admiration pour le caractère tenace et persévérant de votre attitude à l'égard de vos geôliers pendant votre si longue épreuve, Vous, habitants de Croutoy, résistants silencieux mais inflexibles, qui n'avez pas cédé aux exigences de l'intraitable vainqueur, Soyez tous aujourd'hui à l'honneur. Accueillez avec fierté la récompense que vous avez bien méritée et qui s'ajoute à celle décernée le 24 février 1921. Qu'elle vous paie de vos pertes, de vos labeurs, de vos deuils. Qu'elle vivifie vos espérances en des jours meilleurs. Croutoy a toujours relevé et achèvera de relever ses ruines, de même que la France ne saurait mourir” CITATION Citation à l’ordre de la Brigade “ Localité dont toutes les habitations ont été sinistrées et dont la population a fait preuve de courage dans l'épreuve et dans la lutte contre l'ennemi. Déjà citée au titre de la guerre 1914- 1918”.
Les travaux de reconstruction des 23 maisons totalement détruites commencèrent le 25 mars 1949, jour de la cérémonie de pose de la première pierre. Les travaux furent officiellement achevés le 23 mai 1954, jour de la cérémonie dite “de la résurrection de Croutoy ”. Entre-temps, le 10 septembre 1950, la Croix de Guerre avait été remise à la commune par le souspréfet de Compiègne, M. Patou. Le général de France, maire de Croutoy, avait prononcé un discours d'espoir et d'union : “Oh ! vous qui m'écoutez et qui, suivant votre âge, avez été des témoins ou des acteurs dans ces périodes d'incertitude, de souffrances, de dévastations, Vous, les Anciens Combattants des deux guerres, Vous, les anciens prisonniers, les déportés, à qui s'adresse mon admiration pour le caractère tenace et persévérant de votre attitude à l'égard de vos geôliers pendant Les travaux de reconstruction des 23 maisons totalement détruites commencèrent le 25 mars 1949, jour de la cérémonie de pose de la première pierre. Les travaux furent officiellement achevés le 23 mai 1954, jour de la cérémonie dite “de la résurrection de Croutoy ”. Entre-temps, le 10 septembre 1950, la Croix de Guerre avait été remise à la commune par le souspréfet de Compiègne, M. Patou. Le général de France, maire de Croutoy, avait prononcé un discours d'espoir et d'union : “Oh ! vous qui m'écoutez et qui, suivant votre âge, avez été des témoins ou des acteurs dans ces périodes d'incertitude, de souffrances, de dévastations, Vous, les Anciens Combattants des deux guerres, Vous, les anciens prisonniers, les déportés, à qui s'adresse mon admiration pour le caractère tenace et persévérant de votre attitude à l'égard de vos geôliers pendanLes travaux de reconstruction des 23 maisons totalement détruites commencèrent le 25 mars 1949, jour de la cérémonie de pose de la première pierre. Les travaux furent officiellement achevés le 23 mai 1954, jour de la cérémonie dite “de la résurrection de Croutoy ”. Entre-temps, le 10 septembre 1950, la Croix de Guerre avait été remise à la commune par le souspréfet de Compiègne, M. Patou. Le général de France, maire de Croutoy, avait prononcé un discours d'espoir et d'union : “Oh ! vous qui m'écoutez et qui, suivant votre âge, avez été des témoins ou des acteurs dans ces périodes d'incertitude, de souffrances, de dévastations, Vous, les Anciens Combattants des deux guerres, Vous, les anciens prisonniers, les déportés, à qui s'adresse mon admiration pour le caractère tenace et persévérant de votre attitude à l'égard de vos geôliers pendanLes travaux de reconstruction des 23 maisons totalement détruites commencèrent le 25 mars 1949, jour de la cérémonie de pose de la première pierre. Les travaux furent officiellement achevés le 23 mai 1954, jour de la cérémonie dite “de la résurrection de Croutoy ”. Entre-temps, le 10 septembre 1950, la Croix de Guerre avait été remise à la commune par le souspréfet de Compiègne, M. Patou. Le général de France, maire de Croutoy, avait prononcé un discours d'espoir et d'union : “Oh ! vous qui m'écoutez et qui, suivant votre âge, avez été des témoins ou des acteurs dans ces périodes d'incertitude, de souffrances, de dévastations, Vous, les Anciens Combattants des deux guerres, Vous, les anciens prisonniers, les déportés, à qui s'adresse mon admiration pour le caractère tenace et persévérant de votre attitude à l'égard de vos geôliers pendanLes travaux de reconstruction des 23 maisons totalement détruites commencèrent le 25 mars 1949, jour de la cérémonie de pose de la première pierre. Les travaux furent officiellement achevés le 23 mai 1954, jour de la cérémonie dite “de la résurrection de Croutoy ”. Entre-temps, le 10 septembre 1950, la Croix de Guerre avait été remise à la commune par le souspréfet de Compiègne, M. Patou. Le général de France, maire de Croutoy, avait prononcé un discours d'espoir et d'union : “Oh ! vous qui m'écoutez et qui, suivant votre âge, avez été des témoins ou des acteurs dans ces périodes d'incertitude, de souffrances, de dévastations, Vous, les Anciens Combattants des deux guerres, Vous, les anciens prisonniers, les déportés, à qui s'adresse mon admiration pour le caractère tenace et persévérant de votre attitude à l'égard de vos geôliers pendanLes travaux de reconstruction des 23 maisons totalement détruites commencèrent le 25 mars 1949, jour de la cérémonie de pose de la première pierre. Les travaux furent officiellement achevés le 23 mai 1954, jour de la cérémonie dite “de la résurrection de Croutoy ”. Entre-temps, le 10 septembre 1950, la Croix de Guerre avait été remise à la commune par le souspréfet de Compiègne, M. Patou. Le général de France, maire de Croutoy, avait prononcé un discours d'espoir et d'union : “Oh ! vous qui m'écoutez et qui, suivant votre âge, avez été des témoins ou des acteurs dans ces périodes d'incertitude, de souffrances, de dévastations, Vous, les Anciens Combattants des deux guerres, Vous, les anciens prisonniers, les déportés, à qui s'adresse mon admiration pour le caractère tenace et persévérant de votre attitude à l'égard de vos geôliers pendant votre si longue épreuve, Vous, habitants de Croutoy, résistants silencieux mais inflexibles, qui n'avez pas cédé aux exigences de l'intraitable vainqueur, Soyez tous aujourd'hui à l'honneur. Accueillez avec fierté la récompense que vous avez bien méritée et qui s'ajoute à celle décernée le 24 février 1921. Qu'elle vous paie de vos pertes, de vos labeurs, de vos deuils. Qu'elle vivifie vos espérances en des jours meilleurs. Croutoy a toujours relevé et achèvera de relever ses ruines, de même que la France ne saurait mourir” CITATION Citation à l’ordre de la Brigade “ Localité dont toutes les habitations ont été sinistrées et dont la population a fait preuve de courage dans l'épreuve et dans la lutte contre l'ennemi. Déjà citée au titre de la guerre 1914- 1918”.
ERQUINVILLERS CHAMANT ET GRANDVILLIERS
UN COMBAT DE CHARS Le 5 juin 1940, à l'aube, les forces ennemies lançaient l'offensive sur la ligne Weygand établie derrière la Somme. Le dispositif défensif français céda le lendemain entre la mer et Amiens mais aussi entre l'Aisne et l'Oise. Le 7 juin, la dislocation de la 10e Armée face aux coups de boutoir allemands permit aux Panzers de s'ouvrir la route de Rouen. L'ordre de repli de la 7e Armée et d'une partie de la 10e Armée française derrière l'Oise fut alors donné. Sur le plateau picard, 1ère Division Cuirassée et certaines troupes coloniales (4e DIC) reçurent l'ordre de couvrir la retraite du 1er corps d'Armée. Le 8 juin, la 10e Panzer Division venant de Saint-Just-en-Chaussée poursuivit sa progression sur la RN16 (actuelle RD916) entra à Erquinvilliers, petit village de 85 habitants, et se heurta aux troupes françaises du 94e RAM qu'elle fit prisonnières. Après avoir planté un drapeau nazi piégé par une mine, les Allemands se retirèrent provisoirement. En position à Maignelay-Montigny, le 34e Bataillon de Chars de Combat (34e BCC), constitué de chars légers R35 (Renault), reçut l'ordre le 9 juin à l'aube de se porter sur la rivière Arré entre Saint-Just-en-Chaussée et Clermont pour tenir tête à l'ennemi. Devancé par les Allemands, le 34e BCC affronta des éclaireurs à Ravenel (vers 5 heures) puis les chars du 7e régiment de Panzer et une défense antichars retranchés dans la Ferme de la Folie entre Lieuvillers et Erquinvillers. L'engagement décima le 34e BCC qui dut décrocher par Cressonsacq en début d'après-midi. Le bataillon perdit vingt-deux chars, dix tués et une quinzaine de blessés dans cette action. (('Robert Bassac (1910-1940) Comédien d'origine niçoise, il joua dans quatre films de Marcel Pagnol (il fut l'instituteur dans “La femme du boulanger ”). Engagé volontaire, motocycliste au 81e RANA, il fut mortellement blessé par une mitrailleuse le 8 juin 1940 à Erquinvilliers. Très croyant, ses derniers mots furent : “J'offre ma vie à ma famille, pour la France, pour m es copains. J'offre ma vie en union avec le sacrifice du Christ.”)) MASSACRES EN SERIE En fin d'après-midi du 9 juin, la 4e Division d'Infanterie coloniale (4e DIC), constituée du 2e Régiment d'Infanterie Colon iale (2e RIC), du 16e Régiment de Tirailleurs Sénégalais (16e RTS), du 24e Régiment de Tirailleurs Sénégalais (24e RTS) et du 12e Régiment d'Artillerie Coloniale (12e RAC), prit position à Angivillers mais s'y trouva encerclée. Coupés de leur poste de commandement, les colonels présents décidèrent de se replier en passant en force sur deux axes : Cressonsacq et Erquinvilliers passé aux mains allemandes. Un bataillon du 24e RTS, des tirailleurs marocains, des éléments du 12e RAC et du Génie de la 4e DIC gagnèrent Erquinvilliers dans la nuit, combattant maison par maison. Au matin du 10 juin, les Allemands reprirent l'offensive et firent prisonniers de nombreux hommes de la 4e DIC. Certains d'entre eux furent massacrés par les Allemands, comme le furent les tirailleurs à Cressonsacq. Les autres furent dirigés vers Saint-Just-en-Chaussée pour être envoyés dans des stalags en Allemagne. Quelques jours plus tard, un cimetière militaire regroupant 130 combattants de la 4e DIC fut aménagé à l'entrée d'Erquinvillers sous l'autorité du maire M. Manceron. Ce cimetière reçut la bénédiction de Mgr Roeder, évêque de Beauvais, le 9 juin 1941. CITATION 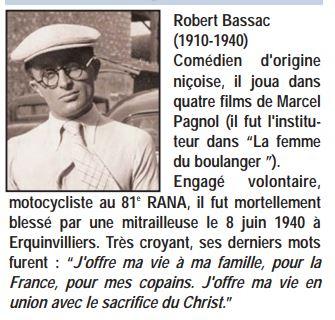
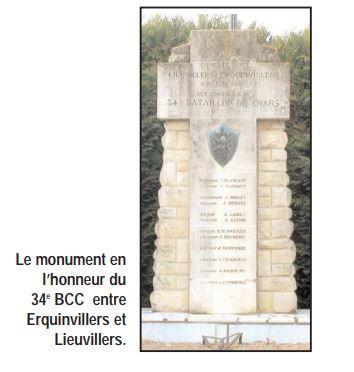 “ Commune particulièrement éprouvée, dont la presque totalité des immeubles a été détruite par les Allemands par mesure de représailles à la suite de la résistance rencontrée dans le village défendu par les éléments d'une Division d'Infanterie Coloniale. Dès leur entrée au village, les habitants ont participé volontairement et spontanément à l'identification et à l'inhumation des soldats “Morts pour la France
“ Commune particulièrement éprouvée, dont la presque totalité des immeubles a été détruite par les Allemands par mesure de représailles à la suite de la résistance rencontrée dans le village défendu par les éléments d'une Division d'Infanterie Coloniale. Dès leur entrée au village, les habitants ont participé volontairement et spontanément à l'identification et à l'inhumation des soldats “Morts pour la France
CHAMANT
HIPPODROME ET AERODROME Commune proche de Senlis et de Chantilly, Chamant possédait un hippodrome, le “Senlis Horse Race Course”, qui fut utilisé durant la Grande Guerre comme champ d'aviation par le Royal Flying Corps. Durant la Seconde Guerre mondiale, ce champ de course fut utilisé par la Luftwaffe comme terrain de desserrement pour les chasseurs de l'aérodrome de Creil. Répertorié commLLLe “Flugplatz Senlis” (n°560), plusieurs groupes d'aviation y passèrent en 1944 notamment le Groupe II/JG 2 (Bf 109 G6) en mai et le Groupe I/JG 2 (FW 109 A-8) en juin, juillet et août. Surnommé “l'hippodrome” (“Rennbahn”) par ses pilotes, il fut utilisé comme base par l’aviation allemande lors des opérations aériennes du 6 juin 1944Le 22 juin 1944, un avion de la Royal Air Force (Squadron 464) chargé d'attaquer à basse altitude des routes, rails et aérodromes, s'écrasa à Chamant tuant ses deux occupants, John-Langham Martin (pilote) et Haydn-Llewelyn Morgan (navigateur). LE BOMBARDEMENT DU 12 AOUT 44 A la suite de la dissolution du conseil municipal de Chamant, une délégation spéciale fut constituée. La présence de la Luftwaffe et d'installations militaires compliqua le quotidien des habitants qui vécurent un cauchemar, à quelques jours de la Libération. Le 12 août 1944, vers 11h30, des bombardiers Fortress B17 larguèrent leurs bombes entre Senlis et Chamant, tuant douze habitants de la commune (Jules et André Nonin, Amédée Hénoux, Andréa Cabrol, Jeanne Frelet, Jules Diximus, Nestor Carlier, Henriette Messié, Emilie Rousseau, Marie-Louise Buge, Yvonne Gaquelle et Marie-Louise Deslandes). Spontanément, au mépris du danger, les habitants se portèrent au secours des victimes et procédèrent aux évacuations. Une de ces bombes de 250 kg fut retrouvée intacte en 2002 à Senlis, rue de Villevert. La Croix de Guerre avec étoile de bronze fut remise le 23 avril 1950 par le députémaire de Creil Jean Biondi, en présence du préfet Maurice Cuttoli, du maire René Frelet, du conseiller général Alphonse Warusfel, du sous-préfet de Senlis, du colonel de Chabot, commandant le 1er groupe de Spahis algériens, et d'une foule nombreuse CITATION . Citation à l'ordre de la Brigade “ Population laborieuse et patriote ; malgré le danger suscité par la présence, dans le centre de l'agglomération, d'un terrain d'aviation comptant 50 chasseurs bombardiers, un important dépôt de carburant, et trois bombardements précurseurs, a conservé calme et sang-froid, confiante en la victoire. S'est portée spontanément, au mépris du danger, le 12 août 1944, au secours des victimes du bombardement qui fit 12 tués et 12 blessés graves ”.? GRANDVILLIERS
BOMBES ET COMBATS Les 6 et 7 juin 1940, Grandvilliers connut d'importants bombardements par l’aviation allemande qui détruisirent notamment l'ancienne halle, la salle des fêtes et l'hôtel de ville. Deux habitants et un réfugié furent tués ainsi que des soldats du 60e RI. Un recensement daté de juillet 1940 indique 161 maisons complètement brûlées, 20 inhabitables, une quinzaine endommagées. Dès son retour, le maire, Frédéric Petit, organisa le logement des sinistrés, le remembrement et la reconstruction de la commune. Cette dernière put commencer début 1942. Le 30 août 1944, des soldats du 44e RTR de la 7e Division Blindée britannique entrèrent dans Grandvilliers. Ils affrontèrent les soldats du LXXIV Korps allemand. Avec l'aide des FFI, Grandvilliers fut libéré et une centaine d'Allemands furent faits prisonniers. Huit canons antichars et deux canons de campagne furent pris. Le résistant OCM René Lointier fut tué lors des combats du 31 août 1944. Dès le 3 septembre suivant, une cérémonie patriotique fut organisée en hommage aux soldats morts DECORE PAR UN GENERL La Croix de Guerre fut remise le mardi 30 août 1949, jour de la fête patronale, par le général Warabiot, natif de Grandvilliers, et en présence de la maréchale Leclerc, du conseiller général Weil-Raynal, du maire. Durant sa prise de parole, le général Warabiot déclama son attachement à sa commune natale: “C’est une seconde mère que je vais décorer, une mère qui souffrit atrocement mais qui n’accepta jamais la défaite”. Il épingla peu après la Croix de Guerre 39/45 auprès de celle de 14/18 sur un coussin de velours aux armes de Grandvilliers, porté par le jeune André Lhoyer, dont le père et le frère avaient été tués pendant la guerre et la mère grièvement blessée. Trois rues de Grandvilliers furent ensuite baptisées respectivement au nom du docteur Eugène de Saint-Fuscien (ex rue de Beauvais), de Frédéric Petit (ex rue d’Aumale) et du Général Leclerc (ex rue de Calais) CITATION Citation à l'ordre du Régiment “ Sévèrement meurtri de 1939 à 1944, bombardé et incendié volontairement en mai et juin 1940. A vu sa population réduite de 312 habitants, 250 foyers détruits, 50 civils blessés, 34 tués ou morts en déportation. Ses survivants, animés du plus ardent patriotisme et du plus grand mépris du danger, ont opposé une résistance héroïque sous toutes ses formes et de tous les instants à l'occupant. Centre stratégique important, a subi stoïquement les bombardements alliés. A pris une part très active à la Libération du territoire les 30 et 31 août 1944.”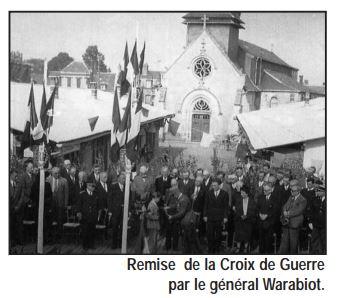
FORMERIE
UN HERISSON SI FRAGILE Important carrefour routier, Formerie fut le siège d'un point de résistance à l'avancée allemande, un “hérisson”, par un régiment à peine reconstitué, le 114e RI. A peine arrivés, le 6 juin 1940, les soldats furent pris sous le bombardement de la Luftwaffe. Mal armés, les fantassins dressèrent des barricades de fortune dans les rues et résistèrent à la pression allemande. Face aux tirs de mortiers et aux incursions allemandes, dépourvus de canons, de mines et de grenades, les mitrailleurs français harcelèrent l'assaillant, refusant toute relève. Malgré l'encerclement par les colonnes blindées et l'absence de moyens, les soldats du commandant Rougier décidèrent de poursuivre le combat coûte que coûte. Le 9 juin, après 55 heures de combat, le drapeau blanc fut hissé par l'aspirant Fleck tandis que, côté allemand, l'ordre d'anéantissement du village était donné en représailles. L'armée allemande détruisit 132 maisons de Formerie. Reconstitué le 28 mai 1940, le 114e RI fut détruit le 9 juin suivant après trois jours de combats acharnés et dissout le 18 juin 1940 à Limoges. Pierre Tisseyre fit le récit de ces combats dans son ouvrage “55 heures de guerre” publié en 1943 tandis qu’il était prisonnier en Allemagne. Il reçut le prix Cazes en 1944 pour son récit. Au cours de c es trois jours de combat, 18 soldats ainsi qu'une civile, Mme Dupuis, furent tués. Une rue de la ville porte le nom du “ 9 juin 1940”. RESISTER DANS LES RUINES Durant l'occupation, la Résistance s'organisa, réalisant des sabotages, aidant les aviateurs alliés en les recueillant, les cachant et en facilitant leur retour Outre Manche. Elle mena des actions notamment contre la voie ferrée, comme le 14 septembre 1943 lorsqu’elle provoqua le déraillement de trente wagons entre Formerie et Taillefontaine. L'aviation alliée fut aussi active en mitraillant les trains (comme le 15 novembre 1943) ou en bombardant la gare (comme les 11 et 28 mai 1944), occasionnant la mort de civils tels Auguste et Albertine Descroix. Le 4 janvier 1944, cinq juifs domiciliés dans la commune furent arrêtés puis déportés à Auschwitz le 20 janvier suivant par le convoi n° 66. Il s'agissait de Beila, Nathan et David Gerzst, Mathilde et Victor Cohen Le 31 août 1944, les Résistants du secteur, sous la direction du vétérinaire Maurice Baillon (Libé-Nord), livrèrent combat contre les Allemands en repli. Ils parvinrent à capturer 1500 soldats, à délivrer trois habitants sur le point d'être fusillés mais perdirent trois hommes. Formerie fut libéré par le XIIe Corps britannique. DEUX FOIS SOUILLEE TROIS MEURTRIE La cérémonie patriotique du 21 octobre 1951 débuta le matin par la remise du drapeau par Emile Durier au docteur Jean Gaudefroy, président de l'association des rapatriés, puis par sa bénédiction par l'abbé Patria. Par la suite, le général Warabiot découvrit la plaque de marbre, où sont inscrit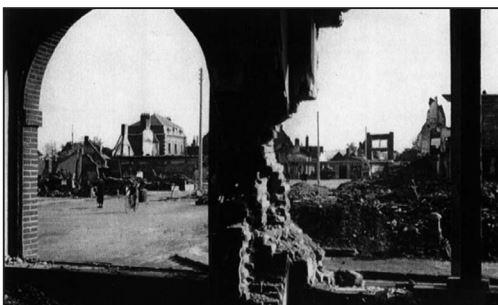 s les noms des cinq militaires et des six civils tués en 1940, avant d'inaugurer la rue de Trélazé.L'après-midi, place Dornat, en présence du préfet, des députés Prache et Patria, du sénateur Séné, du conseiller général Buisson et d’une nombreuse foule, le docteur Jean Gaudefroy, maire de Formerie, évoqua l'occupation tandis que le général Warabiot retraça l'histoire de la ville. Peu après le dernier discours, prononcé par le préfet, le général Warabiot épingla la Croix de Guerre sur le coussin présenté par le maire
s les noms des cinq militaires et des six civils tués en 1940, avant d'inaugurer la rue de Trélazé.L'après-midi, place Dornat, en présence du préfet, des députés Prache et Patria, du sénateur Séné, du conseiller général Buisson et d’une nombreuse foule, le docteur Jean Gaudefroy, maire de Formerie, évoqua l'occupation tandis que le général Warabiot retraça l'histoire de la ville. Peu après le dernier discours, prononcé par le préfet, le général Warabiot épingla la Croix de Guerre sur le coussin présenté par le maire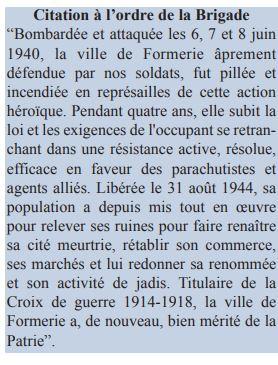 .
.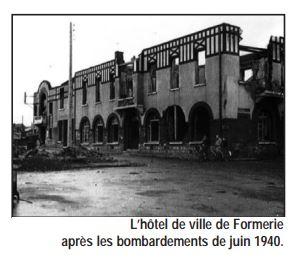
TRIE CHATEAU
GROUPE DARLING Le 1er octobre 1942, le major anglais Francis-Alfred Suttill, dit “ Prosper ”, du Spécial Opération Exécutive (SOE), fut parachuté en France pour mettre en place des réseaux de renseignement et de sabotage. Il entra en relation avec Georges Darling, d'origine anglaise, éleveur de chevaux à Trie-Château, lequel reçut l'aide de l'ancien député des Andelys Albert Forcinal pour créer un groupe dans la région de Gisors. Le groupe de Darling était constitué du gendarme Alexandre Laurent de la brigade de Gisors, de la fiancée de Darling Renée Guépin, du boulanger Jean Bussi et de son employé Adolphe Redelsperger de Trie-Château, des restaurateurs Jules et Olga Villegas d'Aux Bosquets, de Sylvain, Pauline et Michel Sénécaux et d'Irénée Lecercle de Néaufles-Saint-Martin, du fermier Alexandre Barbier de Sérifontaine, de Marcel Charbonnier, de Camille Bigot et de Moïse Aubry de Lalandelle, et du garde-forestier Pierre Perret de Chambors. Le groupe réceptionna plusieurs parachutages en provenance d'Angleterre en mai 1943. Le stock d'armes était caché dans une sape creusée dans le sol, dans le bois Le groupe Darling de l'Etoile, à Chambors, chez le garde forestier Pierre Perret. C'est là que, régulièrement, une équipe parisienne venait chercher des armes qu'elle transportait dans une Citroën Traction avant pour Paris.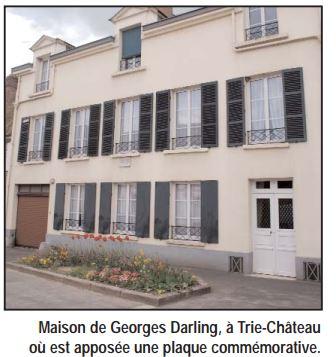 CHUTE DU RESEAU PROSTER De retour de Londres où il s'était entretenu avec ses supérieurs de soupçons d'infiltration du réseau, Prosper se chargea d'organiser la réception en Sologne de deux agents canadiens du SOE, Jack Pickersgill et John Kenneth Macalister. Entre le 15 et le 18 juin 1943, Prosper fit une tournée d'inspection des groupes et de leurs dépôts d'armes. Il dormit deux nuits à Trie-Château chez Darling après être allé à Falaise, Evreux et Sotteville-lès-Rouen, informant ses agents de l'imminence du débarquement. Mais le 21 juin, les deux agents canadiens réceptionnés par Pierre Culioli, furent arrêtés à un barrage routier en possession de matériel de transmission, de messages, de codes radio et d'un calepin contenant des adresses. Tout bascula alors Le 23 juin, Prosper vint à Trie-Château pour superviser un nouveau parachutage d'armes. Il recommanda alors à Darling, de disperser son stock d'armes dans plusieurs caches. Dans la nuit qui suivit, le SD arrêta à Paris Gilbert Norman, Andrée Borrel et les époux Laurent, saisissant des documents compromettants. Le lendemain matin, 24 juin 1943, Prosper fut arrêté au bas de son hôtel à Paris et interrogé par la Gestapo. Le 26 juin matin, Darling se rendit en moto à Chambors pour informer le garde-forestier Perret de l'ordre de dispersion du dépôt d'armes. De retour à Trie Château dans l'après-midi, il se serait trouvé face à un barrage routier d'Allemands cernant la ville. Le résistant aurait alors tenté de s'échapper en traversant un champ de betteraves pour rejoindre le bois de Plumeloux et fut blessé sous la mitraille. Caché dans une sablière, il fut remonté et transporté à l'hôpital de Gisors où il décéda le lendemain. Au cours de cette journée, plusieurs membres du réseau furent arrêtés à leur domicile dont Adolphe Redelsperger, garçon boulanger (il décéda en déportation à Buchenwald), Joseph Fournier, ouvrier boulanger (il décéda en déportation à Bergen-Belsen le 1er avril 1945). Le 29 juin, les résistants de Neaufles -Saint Martin furent à leur tour arrêtés LA FORMATION DU MAQUIS DES KROMIRS A la mi-août 1944, Kléber Dauchel, chef du détachement FTP-Patrie, chercha à installer un maquis dans l'ouest du département. Par l'intermédiaire de M. Lenique, marchand de bois et charbon de Bornel, il entra en relation avec un employé de l'Office départemental des bois et charbons de Beauvais. Ce dernier lui indiqua les numéros cadastraux d'un lot de bois, près de Trie-Château, qui devait être réquisitionné pour faire du bois de boulange et du charbon de bois. Après avoir rencontré le maire de Villers-sur-Trie, il se rendit sur les lieux avec le garde-champêtre de la commune où un petit local pouvait loger trois ou quatre personnes et servir d'abri pour les outils mais, situé au bord de la route, était trop visible pour ses activités clandestines. Si le marchand de bois et charbon de Bornel fournit tout l'outillage de bûcheron à Dauchel, Henri Lemaire, instituteur de Trie, lui présenta Pierre Bourgeois, cultivateur à la ferme des Kroumirs à Trie Château. Ce dernier accepta d'héberger les hommes du détachement Patrie dans sa ferme située à environ trois cents mètres de la route, accessible par un petit chemin à travers le bois qui entourait la ferme au trois-quarts en limite de Trie-Château, de Villers-sur-Trie et d'Eragny-sur-Epte. Le 12 août, six hommes du détachement Patrie, Marcel et Robert Tilloloy, Roland Laurence, Louis Albert Leclère, Georges Rayer et Fernand Duirat, rescapés de Ronquerolles jusque-là cachés au château de Lamberval à Neuilly-en-Thelle, parcoururent les trente kilomètres qui séparaient Fresnoy-en-Thelle de Trie-Château. Les maquisards passèrent à l'action assez rapidement et sectionnèrent les fils téléphoniques de quinze poteaux assurant les liaisons de la Kommandantur. Le jour, ils travaillaient auprès des fermiers, coupaient du bois et organisèrent même une chasse au sanglier. Logés au château de la Folie, siège de la Kommandantur, les Allemands durent entendre le coup de feu LE 14 AOUT 1944 , tôt le matin, le fermier fut averti par Fernand Duirat que des camions allemands avançaient sur la route. Aussitôt, une grande quantité de soldats descendirent et s'échelonnèrent le long de la route, face à la ferme des Kroumirs. Pierre Bourgeois prévint les résistants de la situation, qui cachèrent en toute hâte leurs armes dans la paille de la grange et quittèrent la ferme en prenant le chemin qui traversait le bois, pour s'échapper par la route menant à Trie Château. Mais le bois et la ferme étaient déjà entièrement entourés par les Allemands, à raison d'un soldat tous les dix mètres. Quand les six résistants sortirent du bois, ils se trouvèrent face aux Allemands. Les six FTP, sans armes, furent faits prisonniers et tenus en respect les bras en l'air. Au bout de quelque temps, ils entendirent une fusillade et des cris qui venaient de la direction de la ferme. Les Allemands avaient trouvé les armes dans la grange et fusillé le fermier devant sa femme et sa fille d'une dizaine d'années, ainsi que les deux commis de la ferme, Jean Bouvy et André Vigneron. Les FTP essayèrent alors de s'échapper mais les Allemands ouvrirent le feu. Quatre d'entre eux furent tués : Albert Leclère, Marcel Tilloloy, Robert Tilloloy et Georges Rayez. Robert Laurence, fait L'attaque du 14 août prisonnier, fut déporté par la suite. Fernand Duirat réussit à s'échapper après avoir abattu avec son arme deux soldats allemands. Il profita que les Allemands étaient occupés à manger des pommes pour sortir du bois. La nuit venue les Allemands repartirent. L’un d’entre -eux tenta de l'arrêter, mais il put fuir, bien que blessé, caché par un troupeau de vaches. Le lendemain, le maire, M. Froment, fut arrêté puis libéré en soirée. Le 29 juin 1980, une stèle fut érigée près de la ferme des Kroumirs sur laquelle sont gravés les noms des victimes de l'attaque allemande
CHUTE DU RESEAU PROSTER De retour de Londres où il s'était entretenu avec ses supérieurs de soupçons d'infiltration du réseau, Prosper se chargea d'organiser la réception en Sologne de deux agents canadiens du SOE, Jack Pickersgill et John Kenneth Macalister. Entre le 15 et le 18 juin 1943, Prosper fit une tournée d'inspection des groupes et de leurs dépôts d'armes. Il dormit deux nuits à Trie-Château chez Darling après être allé à Falaise, Evreux et Sotteville-lès-Rouen, informant ses agents de l'imminence du débarquement. Mais le 21 juin, les deux agents canadiens réceptionnés par Pierre Culioli, furent arrêtés à un barrage routier en possession de matériel de transmission, de messages, de codes radio et d'un calepin contenant des adresses. Tout bascula alors Le 23 juin, Prosper vint à Trie-Château pour superviser un nouveau parachutage d'armes. Il recommanda alors à Darling, de disperser son stock d'armes dans plusieurs caches. Dans la nuit qui suivit, le SD arrêta à Paris Gilbert Norman, Andrée Borrel et les époux Laurent, saisissant des documents compromettants. Le lendemain matin, 24 juin 1943, Prosper fut arrêté au bas de son hôtel à Paris et interrogé par la Gestapo. Le 26 juin matin, Darling se rendit en moto à Chambors pour informer le garde-forestier Perret de l'ordre de dispersion du dépôt d'armes. De retour à Trie Château dans l'après-midi, il se serait trouvé face à un barrage routier d'Allemands cernant la ville. Le résistant aurait alors tenté de s'échapper en traversant un champ de betteraves pour rejoindre le bois de Plumeloux et fut blessé sous la mitraille. Caché dans une sablière, il fut remonté et transporté à l'hôpital de Gisors où il décéda le lendemain. Au cours de cette journée, plusieurs membres du réseau furent arrêtés à leur domicile dont Adolphe Redelsperger, garçon boulanger (il décéda en déportation à Buchenwald), Joseph Fournier, ouvrier boulanger (il décéda en déportation à Bergen-Belsen le 1er avril 1945). Le 29 juin, les résistants de Neaufles -Saint Martin furent à leur tour arrêtés LA FORMATION DU MAQUIS DES KROMIRS A la mi-août 1944, Kléber Dauchel, chef du détachement FTP-Patrie, chercha à installer un maquis dans l'ouest du département. Par l'intermédiaire de M. Lenique, marchand de bois et charbon de Bornel, il entra en relation avec un employé de l'Office départemental des bois et charbons de Beauvais. Ce dernier lui indiqua les numéros cadastraux d'un lot de bois, près de Trie-Château, qui devait être réquisitionné pour faire du bois de boulange et du charbon de bois. Après avoir rencontré le maire de Villers-sur-Trie, il se rendit sur les lieux avec le garde-champêtre de la commune où un petit local pouvait loger trois ou quatre personnes et servir d'abri pour les outils mais, situé au bord de la route, était trop visible pour ses activités clandestines. Si le marchand de bois et charbon de Bornel fournit tout l'outillage de bûcheron à Dauchel, Henri Lemaire, instituteur de Trie, lui présenta Pierre Bourgeois, cultivateur à la ferme des Kroumirs à Trie Château. Ce dernier accepta d'héberger les hommes du détachement Patrie dans sa ferme située à environ trois cents mètres de la route, accessible par un petit chemin à travers le bois qui entourait la ferme au trois-quarts en limite de Trie-Château, de Villers-sur-Trie et d'Eragny-sur-Epte. Le 12 août, six hommes du détachement Patrie, Marcel et Robert Tilloloy, Roland Laurence, Louis Albert Leclère, Georges Rayer et Fernand Duirat, rescapés de Ronquerolles jusque-là cachés au château de Lamberval à Neuilly-en-Thelle, parcoururent les trente kilomètres qui séparaient Fresnoy-en-Thelle de Trie-Château. Les maquisards passèrent à l'action assez rapidement et sectionnèrent les fils téléphoniques de quinze poteaux assurant les liaisons de la Kommandantur. Le jour, ils travaillaient auprès des fermiers, coupaient du bois et organisèrent même une chasse au sanglier. Logés au château de la Folie, siège de la Kommandantur, les Allemands durent entendre le coup de feu LE 14 AOUT 1944 , tôt le matin, le fermier fut averti par Fernand Duirat que des camions allemands avançaient sur la route. Aussitôt, une grande quantité de soldats descendirent et s'échelonnèrent le long de la route, face à la ferme des Kroumirs. Pierre Bourgeois prévint les résistants de la situation, qui cachèrent en toute hâte leurs armes dans la paille de la grange et quittèrent la ferme en prenant le chemin qui traversait le bois, pour s'échapper par la route menant à Trie Château. Mais le bois et la ferme étaient déjà entièrement entourés par les Allemands, à raison d'un soldat tous les dix mètres. Quand les six résistants sortirent du bois, ils se trouvèrent face aux Allemands. Les six FTP, sans armes, furent faits prisonniers et tenus en respect les bras en l'air. Au bout de quelque temps, ils entendirent une fusillade et des cris qui venaient de la direction de la ferme. Les Allemands avaient trouvé les armes dans la grange et fusillé le fermier devant sa femme et sa fille d'une dizaine d'années, ainsi que les deux commis de la ferme, Jean Bouvy et André Vigneron. Les FTP essayèrent alors de s'échapper mais les Allemands ouvrirent le feu. Quatre d'entre eux furent tués : Albert Leclère, Marcel Tilloloy, Robert Tilloloy et Georges Rayez. Robert Laurence, fait L'attaque du 14 août prisonnier, fut déporté par la suite. Fernand Duirat réussit à s'échapper après avoir abattu avec son arme deux soldats allemands. Il profita que les Allemands étaient occupés à manger des pommes pour sortir du bois. La nuit venue les Allemands repartirent. L’un d’entre -eux tenta de l'arrêter, mais il put fuir, bien que blessé, caché par un troupeau de vaches. Le lendemain, le maire, M. Froment, fut arrêté puis libéré en soirée. Le 29 juin 1980, une stèle fut érigée près de la ferme des Kroumirs sur laquelle sont gravés les noms des victimes de l'attaque allemande
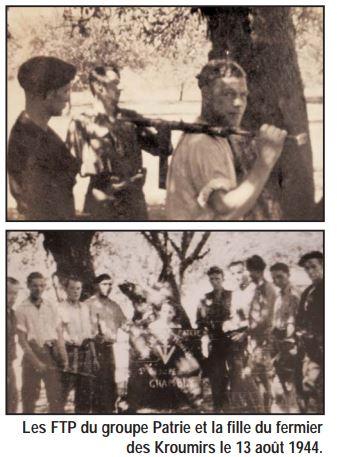

ANDEVILLE ET GURY
ANDEVILLE Située au nord-est de Méru, à l’écart des grands axes de communication, Andeville fut épargnée par les bombardements allemands de 1940 et alliés de 1944. La démission du maire Théodore Durant, le 27 juin 1941, et la désignation de Georges Petit comme successeur n’y provoquèrent pas de remous .Le calme apparent des habitants de la commune masquait une activité clandestine qui s’accentua durant l’année 1944 avec l’aide aux réfractaires au STO et aux aviateurs alliés, ainsi que par la multiplication des actions de guérilla menées notamment par les résistants FTP, dont Maurice Camin : impliqué dans l’affaire de Mogneville en septembre 1943,condamné par contumace en janvier 1944 à cinq ans de travaux forcés par la section spéciale de la cour d’appel d’Amiens, il fut arrêté puis exécuté par les Allemands en août 1944. A Andeville, la Résistance s’organisa autour de Marcel Beaucheron et de Maurice Oranger, lequel cacha deux soldats sud-africains à son domicile.
CITATION A L ORDRE DU REGIMENT
“ Dès le début de l'occupation, la commune d'Andeville s'organise dans la résistance à l’ennemi et un groupe de 80 membres, qui manifeste bientôt son activité, y est constitué. Des déportés au STO furent cachés et secourus, et au moins 16 parachutistes alliés trouvèrent asile et soins dans la localité. Par son active résistance , la commune d'Andeville s'était particulièrement attiré la haine de l'ennemi et, le 27 août 1944, 16 hommes dont 12 de ses enfants, furent, sans raison, sauvagement exécutés par les Allemands sur la place publique. Les Allemands brûlèrent, en outre, par représailles, deux immeubles où ils avaient découvert cachés deux parachutistes alliés.” L LE MASSACRE DU 27 AOUT Andeville connut le massacre de seize de ses habitants, perpétré le 27 août 1944 par une troupe allemande. A l’origine de cette tuerie, un soldat allemand se prétendant déserteur, livré à la Résistance locale le 23 août par le coiffeur à qui il s’était confié. Conduit par Marcel Beaucheron et d’autres résistants chez Maurice Oranger, ce dernier lui donna des vêtements civils et l’hébergea sous bonne garde. Emmené le2 6 août chez Alexandre Cheudail, à Laboissière, le soldat allemand s’échappa. Le lendemain, vers 11 heures, une soixantaine de soldats allemands débarquèrent de camions, de voitures, de motos et de side-cars, et prirent position sur la place puis vers le quartier d’Angleterre. Ils abattirent Marcel Deflandre qui s’enfuyait encourant. Conduit par deux jeunes adolescents du village, un groupe se rendit chez le maire, Georges Petit, et l’emmenèrent en voiture chez Maurice Oranger où il fut abattu. Un autre groupe avait pris possession des lieux et avait déjà fusillé le résistant et les deux soldats sud-africains cachés à son domicile. Sa maison et celle de M. Germain furent incendiées à la grenade tandis que deux passants, Octave Beaucheron et Alexandre Viville étaient abattus dans la rue. La troupe allemande perquisitionna les maisons du quartier, tua Maurice Chéron parti se réfugier chez lui et regroupa trente-cinq personnes qui furent alignées devant le mur de l’église. Huit d’entre elles furent exécutées, une par une, d’une balle dans la tête sous les tilleuls de la place, par le “déserteur” allemand. Le commandant de l’opération intima l’ordre à l’abbé Guerville de faire disparaître les corps avant 19 heures
6 août chez Alexandre Cheudail, à Laboissière, le soldat allemand s’échappa. Le lendemain, vers 11 heures, une soixantaine de soldats allemands débarquèrent de camions, de voitures, de motos et de side-cars, et prirent position sur la place puis vers le quartier d’Angleterre. Ils abattirent Marcel Deflandre qui s’enfuyait encourant. Conduit par deux jeunes adolescents du village, un groupe se rendit chez le maire, Georges Petit, et l’emmenèrent en voiture chez Maurice Oranger où il fut abattu. Un autre groupe avait pris possession des lieux et avait déjà fusillé le résistant et les deux soldats sud-africains cachés à son domicile. Sa maison et celle de M. Germain furent incendiées à la grenade tandis que deux passants, Octave Beaucheron et Alexandre Viville étaient abattus dans la rue. La troupe allemande perquisitionna les maisons du quartier, tua Maurice Chéron parti se réfugier chez lui et regroupa trente-cinq personnes qui furent alignées devant le mur de l’église. Huit d’entre elles furent exécutées, une par une, d’une balle dans la tête sous les tilleuls de la place, par le “déserteur” allemand. Le commandant de l’opération intima l’ordre à l’abbé Guerville de faire disparaître les corps avant 19 heures
UNE MEMOIRE VIVE
La libération venue, les corps placés dans une fosse commune furent exhumés et placés dans des sépultures individuelles.
Une cérémonie en l'honneur des victimes des Allemands eut lieu le dimanche 3 septembre 1944. Les corps des deux soldats sud-africains furent inhumés dans le carré militaire du Commonwealth du cimetière communal (ci-contre). Après guerre, la Commune fit en sorte de conserver la mémoire des victimes sur les lieux mèmes du massacre Ainsi, ainsi outre l'inscription des noms des victimes sur le monument aux morts, une plaque commémorative fut apposée sur le mur de l'église. Financée par souscription publique auprès des habitants des communes environnantes, elle rappelle le massacre “ par des Allemands ivres de fureur et de cruauté ” et porte un message antigermanique en rapport avec la violence de l'événement : “ que nos fils n'oublient jamais que la race allemande sera toujours capable de commettre de pareilles atrocités ”. Si la “ rue des 17 Martyrs ” perpétue la mémoire des seize massacrés et du résistant FTP Maurice Camin fusillé le 28 août 1944, une plaque apposée sur le mur de l'église d'Andeville, place de la République, et inaugurée le 22 avril 1945 retrace succinctement le déroulement de la journée du 27 août. Le nom du maire Georges Petit fut donné à la rue menant à la mairie et à l'école communale
GURY
SOUS LES BOMBES Les événements militaires commencèrent à Gury le 20 mai 1940. Ce jour-là, un bombardier monomoteur biplace français de type Vought 156F, en mission sur Origny-Sainte-Benoîte (Aisne), se posa en catastrophe dans un champ près de Gury après avoir été touché par un Messerschmitt 109. Tandis qu'ils quittaient l'épave de leur avion, les aviateurs français furent pris à partie par les avions allemands. Le pilote, Gaston Leveillé, blessé, fut conduit à l'hôpital de Compiègne pour y être soigné. Son radio, Roger Lafon, tué au sol, fut enterré dans le cimetière de Gury. Le 5 juin, tandis que la ligne Weygand était prise d'assaut, le village de Gury subit un bombardement aérien intensif par l'aviation allemande prenant pour cible les axes routiers. Les bombes frappèrent les constructions et tuèrent les six membres de la famille Frein. D'après les services de la Reconstruction, une ferme, deux maisons, deux hangars et deux écuries furent entièrement détruits. Parmi les bâtiments partiellement détruits figuraient l'église, la mairie-école, la salle des fêtes, trente habitations et de nombreux bâtiments agricoles. Aucun des 34 foyers de la commune ne fut épargné. Le village connut des combats au sol le 9 juin 1940. Des hommes de la 3e compagnie du 4e Régiment d'Infanterie Coloniale y établirent un dispositif de défense du village pour ralentir la progression allemande et protéger le repli de la division. Quatre soldats français furent tués au cours de ce combat qui se prolongea à Mareuil-la-Motte. Des soldats du 10e RI s'y battirent aussi. Dans l'aprèsmidi, Gury était occupé par les troupes allemandes CITATION 
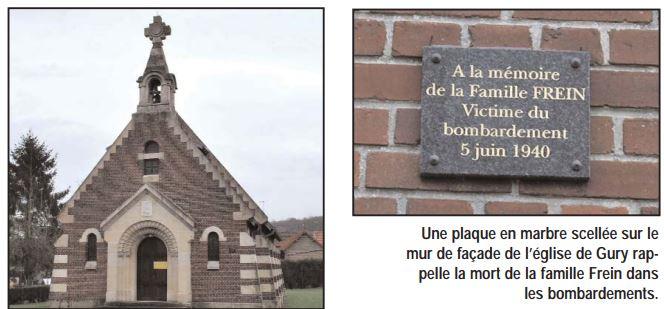 Citation à l'ordre de la Division “ Localité complètement anéantie lors de la guerre 1914-1918, dont la population fit preuve du plus grand sang-froid et des plus grandes vertus patriotiques, lors de l'avance allemande de 1940, facilitant ainsi l'action militaire. N'a consenti à se replier qu'après avoir essuyé un violent bombardement aérien atteignant la presque totalité des immeubles et occasionnant des pertes dans la population civile”.
Citation à l'ordre de la Division “ Localité complètement anéantie lors de la guerre 1914-1918, dont la population fit preuve du plus grand sang-froid et des plus grandes vertus patriotiques, lors de l'avance allemande de 1940, facilitant ainsi l'action militaire. N'a consenti à se replier qu'après avoir essuyé un violent bombardement aérien atteignant la presque totalité des immeubles et occasionnant des pertes dans la population civile”.
NOYON ET PRECY SUR OISE
DES CHARS POUR CIBLE Le 21 mai, à l'annonce de l'évacuation officielle, la municipalité quitta la ville avec l'ensemble de la population. Un contrordre fut donné le 23 mai et le 2 juin, tandis qu'un millier d'habitants était revenu, la municipalité fut révoquée, pour avoir manqué à ses devoirs. Dans la nuit du 3 au 4 juin, le centre-ville connut un premier bombardement aérien puis un second le 5 juin, à l'aube. Le 6 juin matin, une seconde évacuation fut annoncée. Le lendemain, les 62e , 94e et 263e divisions allemandes partaient à l'assaut de Noyon pour prendre en étau les 3e et 23e DI françaises en retraite. En position à Tarlefesse, la 2e Compagnie du 1er Bataillon de Chars de Combat fut décimée par les canons anti-chars allemands lors de son repli (treize tués, cinq grièvement blessés ).Le 21 mai, à l'annonce de l'évacuation officielle, la municipalité quitta la ville avec l'ensemble de la population. Un contrordre fut donné le 23 mai et le 2 juin, tandis qu'un millier d'habitants était revenu, la municipalité fut révoquée, pour avoir manqué à ses devoirs. Dans la nuit du 3 au 4 juin, le centre-ville connut un premier bombardement aérien puis un second le 5 juin, à l'aube. Le 6 juin matin, une seconde évacuation fut annoncée. Le lendemain, les 62e , 94e et 263e divisions allemandes partaient à l'assaut de Noyon pour prendre en étau les 3e et 23e DI françaises en retraite. En position à Tarlefesse, la 2e Compagnie du 1er Bataillon de Chars de Combat fut décimée par les canons anti-chars allemands lors de son repli (treize tués, cinq grièvement blessés ). UNE RESISTANCE ACTIVE Ville fortement marquée par l’occupation ennemie de 1914-1917 et les destructions de 1918, Noyon gardait un sentiment antiallemand qui favorisa l’émergence de la Résistance. Le maire Augustin Baudoux, admirateur du Maréchal Pétain qui l’avait nommé, travailla à la reconstruction de la ville. Sous l’impulsion de trois anciens combattants, Marcel Fourrier, André Dumontois et Louis Brunet, l’Armée Secrète devenue OCM s’y développa malgré la présence d’une Kommandantur et d’un centre de formation SS. A la récupération d’armes et au renseignement s’ajoutèrent au fil du temps l’entraînement des recrues, la cache d’aviateurs, la récupération de parachutages, le transport d’armes et leVille fortement marquée par l’occupation ennemie de 1914-1917 et les destructions de 1918, Noyon gardait un sentiment antiallemand qui favorisa l’émergence de la Résistance. Le maire Augustin Baudoux, admirateur du Maréchal Pétain qui l’avait nommé, travailla à la reconstruction de la ville. Sous l’impulsion de trois anciens combattants, Marcel Fourrier, André Dumontois et Louis Brunet, l’Armée Secrète devenue OCM s’y développa malgré la présence d’une Kommandantur et d’un centre de formation SS. A la récupération d’armes et au renseignement s’ajoutèrent au fil du temps l’entraînement des recrues, la cache d’aviateurs, la récupération de parachutages, le transport d’armes et lesabotage. A l’origine du maquis des Usages, créé le 7 juin 1944 et attaqué le 23 juin, les résistants de Noyon subirent des arrestations. Après la rafle des communistes (1941) et des juifs (1944), les résistants furent méthodiquement appréhendés et déportés, pour beaucoup à Buchenwald . VERS UNE LIBERATION Le 25 juillet 1944, la percée d'Avranches permit aux Américains d'enfoncer le front allemand en Normandie. Noyon connut alors plusieurs bombardements ayant pour cible la voie ferrée. Le 2 août 1944, à 16h45, une douzaine de chasseurs-bombardiers attaquèrent la gare, tuant un homme et touchèrent deux trains de citernes d'essence (voir ci-contre). Cinq immeubles furent totalement détruits dans l'incendie et douze autres furent plus ou moins endommagés. Le 8 août, vers 13h30, une dizaine d'avions alliés lancèrent vingt-quatre bombes dans le secteur de la gare, détruisant deux maisons et endommageant une vingtaine d'autres et des usines proches. Le 12 août, à 17h15, vingt bombardiers légers bombardèrent la gare et, le lendemain, vers 4h15, les wagons à l'arrêt furent mitraillés. Le 1er septembre en fin d'après-midi, une colonne de chars de la 5e Division Blindée américaine fut prise à partie sur les pentes du Mont-Renaud (photo ci-dessus). S'en suivirent de violents échanges d'artillerie qui durèrent toute la nuit. La libération de Noyon, le 2 septembre matin, signa la fin de la libération du département de l'Oise. UNE CEREMONIE PATRIOTIQUE La remise de la Croix de Guerre se déroula l’après-midi du dimanche 29 mai 1949, devant l’hôtel de ville, en présenc e des congressiste de l’UMRAC, du maire de Noyon Achille Granthomme, du sénateur Bouquerel, du préfet de l’Oise et du général Warabiot. Ce dernier dévoila une plaque place Cordouen en l’honneur du 1er Bataillon de Chars de Combat, “embryon de la glorieuse 2e DB”. L’orateur précisa que le commandant rescapé des combats de juin 1940 baptisa “Noyon” son char de commandement qui l’emmena d’Afrique du Nord à Strasbourg puis à Berchtesgaden. En fin de cérémonie, furent inaugurées les rues du Général Leclerc et du Général De Gaulle. CITATION 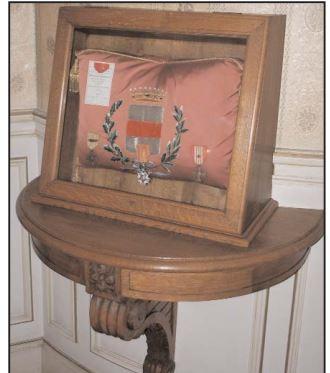
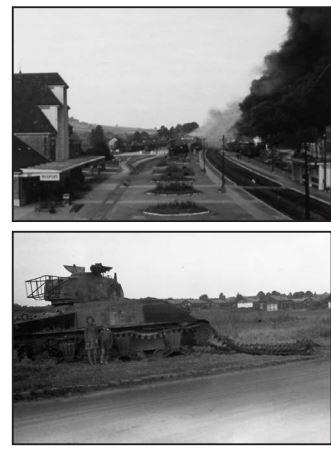
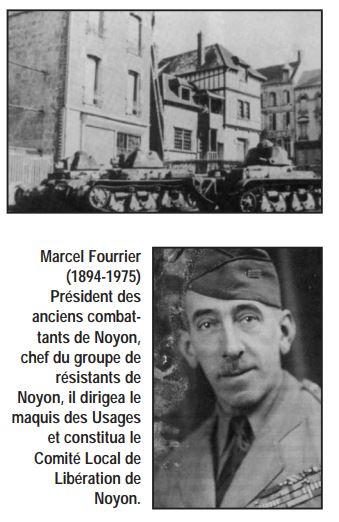 Citation à l'ordre de la Division “ Ville au passé glorieux à nouveau cruellement meurtrie par de nombreux bombardements aériens. A cependant lutté de toute sa volonté contre l'occupant, malgré les menaces et les déportations et a donné ainsi, une fois de plus, un magnifique exemple de courage et de patriotisme. 78 habitants déportés, 7 sont morts en déportation. Déjà citée au titre de la guerre 1914-1918.”
Citation à l'ordre de la Division “ Ville au passé glorieux à nouveau cruellement meurtrie par de nombreux bombardements aériens. A cependant lutté de toute sa volonté contre l'occupant, malgré les menaces et les déportations et a donné ainsi, une fois de plus, un magnifique exemple de courage et de patriotisme. 78 habitants déportés, 7 sont morts en déportation. Déjà citée au titre de la guerre 1914-1918.”
PRECY SUR O ISE
LES SIBLES MILITAIRES ; ”Précy-sur-Oise subit un premier bombardement le 21 mai 1940, affectant la mairie, six maisons et tuant un habitant. La population prit alors les routes de l'exode. Le 12 juin 1940, les troupes françaises détruisirent le pont de Précy. Les Allemands occupèrent la ville le lendemain, installèrent une Kommandantur au Château Vénêque et réquisitionnèrent les maisons les plus importantes du centreville pour y loger les officiers. La propriété Bertrand fut investie par un régiment du train puis par un régiment de pontonniers qui rétablit le pont sur l'Oise en 1942. A compter de juin 1944, la voie ferrée et la gare de Précy-sur-Oise furent prises pour cible par l'aviation et la Résistance. Le 3 juin, la gare subit un premier bobardement puis, le 7, le mitraillage d'un train. Le 10 juin, les FTP y firent dérailler le train 3271. A partir de juillet, les bombardements alliés élargirent leurs angles d'action, comme ce fut le cas les 12 et 23 juillet UN JOUR SOMBRE 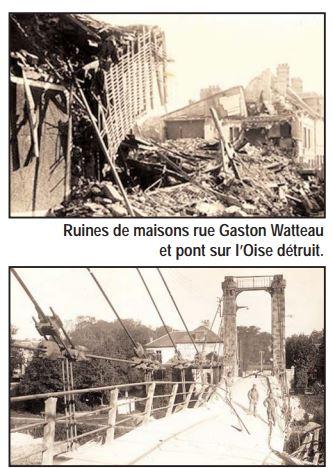 Le bombardement des installations V1 de Saint-Leu-d'Esserent purent avoir des répercussions sur la ville. Ainsi, dans la nuit du 7 au 8 juillet 1944, un Lancaster fut touché par la chasse allemande et s'écrasa en forêt de Précy. Deux aviateurs furent tués, les cinq autres, parachutés, purent être récupérés par la Résistance. Le 5 août 1944, l'aviation alliée bombarda par erreur la ville : 1200 bombes destinées aux usines de V1 installées dans les carrières de Saint-Leu-d'Esserent s'y abattirent et tuèrent douze personnes. Dix-sept immeubles furent détruits et quatre-vingt endommagés. Le même jour, la ligne Creil - Pontoise était sabotée par la Résistance entre Boran et Précy-surOise
Le bombardement des installations V1 de Saint-Leu-d'Esserent purent avoir des répercussions sur la ville. Ainsi, dans la nuit du 7 au 8 juillet 1944, un Lancaster fut touché par la chasse allemande et s'écrasa en forêt de Précy. Deux aviateurs furent tués, les cinq autres, parachutés, purent être récupérés par la Résistance. Le 5 août 1944, l'aviation alliée bombarda par erreur la ville : 1200 bombes destinées aux usines de V1 installées dans les carrières de Saint-Leu-d'Esserent s'y abattirent et tuèrent douze personnes. Dix-sept immeubles furent détruits et quatre-vingt endommagés. Le même jour, la ligne Creil - Pontoise était sabotée par la Résistance entre Boran et Précy-surOise 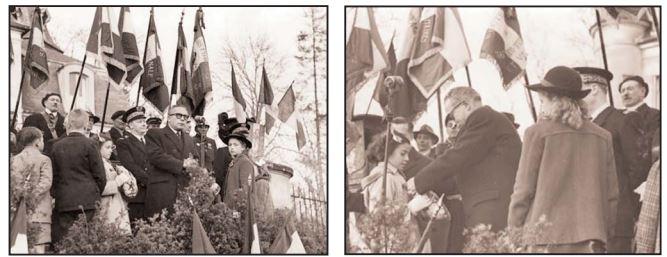 LI BERATION ET DISTINCTION Le 27 août suivant, face à l'avancée américaine, les Allemands firent à leur tour sauter le pont. Précy fut libérée quatre jours plus tard, le 31 août 1944, par le 120e RI de la 30e Division US. Au cours de la guerre, huit jeunes soldats de Précy-sur-Oise furent tués au champ d'honneur. La Croix de Guerre fut remise place de Verdun le 4 décembre 1949 par Jean Biondi, secrétaire d'Etat à la Fonction Publique, en présence du maire M. Coeurderoy, du préfet M. Cuttoli, du souspréfet de Senlis M. Brottes et du conseiller général M. Fournier. Peu après, la rue Charles Andrieu fut inaugurée en hommage à ce docteur de Neuilly-enThelle, responsable Front National, mort en déportation
LI BERATION ET DISTINCTION Le 27 août suivant, face à l'avancée américaine, les Allemands firent à leur tour sauter le pont. Précy fut libérée quatre jours plus tard, le 31 août 1944, par le 120e RI de la 30e Division US. Au cours de la guerre, huit jeunes soldats de Précy-sur-Oise furent tués au champ d'honneur. La Croix de Guerre fut remise place de Verdun le 4 décembre 1949 par Jean Biondi, secrétaire d'Etat à la Fonction Publique, en présence du maire M. Coeurderoy, du préfet M. Cuttoli, du souspréfet de Senlis M. Brottes et du conseiller général M. Fournier. Peu après, la rue Charles Andrieu fut inaugurée en hommage à ce docteur de Neuilly-enThelle, responsable Front National, mort en déportation
CRAPEAUMESNIL ET NANTEUIL LE HAUDOUIN
LES COMBAT5S DU 109 RI Petit village de l'Oise limitrophe de la Somme, Crapeaumesnil subit d'importantes destructions durant la Campagne de France, peu après la rupture de la 109ligne Weygand. Appelé en renfort au sein de la 47e DI le 5 juin 1940, le 109e RI prit position entre Beuvraignes et le Bois de Crapeaumesnil en soutien de la 29e DI Alp qui défendait notamment Roye, Roiglise et Verpillères. Le même jour, les Allemands lançaient leur offensive sur la Somme (Opération Fall Rot), ébranlant les positions françaises. Venus en renfort de nuit sur Roye, les blindés français furent mis en pièce par l'aviation allemande maîtresse du ciel. Roye puis Roiglise tombèrent aux mains allemandes en fin de journée du 6. Le 7 juin, vers 7 heures, les premiers blindés allemands apparurent route de Roye. Commença alors l'engagement du 109e RI qui parvint à tenir ses positions malgré de nombreuses pertes. Le 8 juin, en soirée, le 109e RI se replia dans la région de Rouvillers. Pour le colonel Marchand, il quitta “volontairement et en ordre le terrain qu'il a défendu avec l'énergie que l'on attendait de lui”. Durant ces deux jours de combat, le régiment perdit une centaine de tués (dont cinq officiers). PRES DE L AERODROME DE ROYE AMY La population de Crapeaumesnil fut évacuée en février 1941 par l'autorité d'occupation en raison de sa proximité du champ d'aviation de Roye-Amy, dont une des pistes occupait en partie le territoire. A la fin de la guerre, sur les trente habitations de la commune, on en comptait deux totalement détruites et vingt-huit partiellement. Outre la palme commémorative des combats de juin 1940 scellée sur le monument aux morts de la commune, une stèle dédiée à la mémoire des combattants du 109e RI fut élevée en sortie de village. CITATION Citation à l'ordre du Régiment “ Localité évacuée totalement sur les ordres de l'autorité occupante dont toutes les maisons ont été soit détruites, soit sinistrées et dont la population a fait preuve de courage dans l'épreuve et dans la lutte contre l'ennemi. Déjà citée au titre de la Guerre 1914- 1918.” 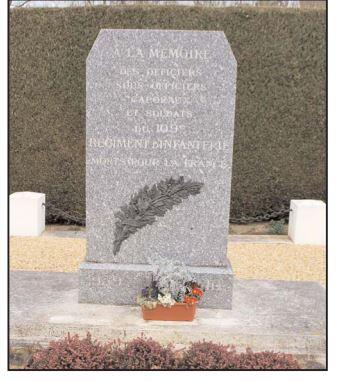 LES BOMBARDEMENTS ALLIES BO Jusque-là épars, les bombardements alliés s'intensifièrent en 1944 en préparation ou en accompagnement du Débarquement. Le secteur Creil-Nogent-Montataire se trouva ainsi sous le coup de l'opération Desert Rail. Les bombardements affectèrent la gare de triage, les dépôts, le terrain d'aviation. Pour le seul mois de mars 1944, la ville fut touchée sept fois : le 17 mars, la gare de triage fut bombardée par la 8e Air Force qui provoqua l'explosion d'un train de munitions ; le 20 mars, le Creillois fut bombardé par 138 avions provoquant la destruction du dépôt ferroviaire du Petit-Thérain; le 23, un bombardement par 300 appareils endommagea l'écluse en dérivation, les établissements Cima-Wallut et la Vieille Montagne; le 26, un nouveau bombardement toucha Creil et Montataire. Le lendemain, la gare fut rendue inutilisable par de nouvelles bombes; le 28, les deux gares de triage, les nœuds ferroviaires et les dépôts de machines furent touchés par un raid.Enfin, le 30 mars, la 8e Air Force prit à partie le Petit-Thérain. Durant les mois qui suivirent, les bombardements se poursuivirent intensément sur les cibles stratégiques. Le terrain d'aviation fut bombardé notamment le 15 mai, le 27 mai, le 14 juin et le 12 juillet 1944. Cible privilégiée, les installations ferroviaires subirent les bombes alliées le 10 mai (gare), le 20 mai (le Pont Royal et le théâtre des cheminots) et le 4 juin (gare). Malgré les alertes, les bombardements provoquèrent des drames parmi les civils. Ainsi, le 27 avril 1944, le remorqueur fluvial Triton 22 fut coulé lors d'un bombardement matinal, provoquant la mort de onze mariniers. Le 8 mai, le bombardement de la gare de Creil toucha le train d'Amiens, tuant 77 voyageurs et en blessant 61 autres. Plusieurs quartiers de la ville furent aussi bombardés : le 27 juin, les rues Raspail et Etienne Dolet ; le 23 juillet, les rues Gambetta, Somasco et le quai d'Amont ; le 31 juillet, de nouveau le quai d'Amont et l'immeuble du Secours national ; le 5 août, la rue Victor Hugo. Creil connut 52 bombardements durant la guerre, les Alliés utilisant parfois des bombes à retardement. Le ciel de Creil fut aussi l'espace de combats tel le 25 août 1944 au cours duquel huit avions furent abattus. Le 29 août, les Allemands détruisirent le pont sur l'Oise, assurant ainsi leur retraite. Libéré par les Américains le 31 août 1944, Creil vit sa base aérienne utilisée par les forces alliées comme base de dégagement jusqu'au 16 janvier 1946. Stèle en hommage aux combattants du 190e RI tombés à Crapeaumesnil.
LES BOMBARDEMENTS ALLIES BO Jusque-là épars, les bombardements alliés s'intensifièrent en 1944 en préparation ou en accompagnement du Débarquement. Le secteur Creil-Nogent-Montataire se trouva ainsi sous le coup de l'opération Desert Rail. Les bombardements affectèrent la gare de triage, les dépôts, le terrain d'aviation. Pour le seul mois de mars 1944, la ville fut touchée sept fois : le 17 mars, la gare de triage fut bombardée par la 8e Air Force qui provoqua l'explosion d'un train de munitions ; le 20 mars, le Creillois fut bombardé par 138 avions provoquant la destruction du dépôt ferroviaire du Petit-Thérain; le 23, un bombardement par 300 appareils endommagea l'écluse en dérivation, les établissements Cima-Wallut et la Vieille Montagne; le 26, un nouveau bombardement toucha Creil et Montataire. Le lendemain, la gare fut rendue inutilisable par de nouvelles bombes; le 28, les deux gares de triage, les nœuds ferroviaires et les dépôts de machines furent touchés par un raid.Enfin, le 30 mars, la 8e Air Force prit à partie le Petit-Thérain. Durant les mois qui suivirent, les bombardements se poursuivirent intensément sur les cibles stratégiques. Le terrain d'aviation fut bombardé notamment le 15 mai, le 27 mai, le 14 juin et le 12 juillet 1944. Cible privilégiée, les installations ferroviaires subirent les bombes alliées le 10 mai (gare), le 20 mai (le Pont Royal et le théâtre des cheminots) et le 4 juin (gare). Malgré les alertes, les bombardements provoquèrent des drames parmi les civils. Ainsi, le 27 avril 1944, le remorqueur fluvial Triton 22 fut coulé lors d'un bombardement matinal, provoquant la mort de onze mariniers. Le 8 mai, le bombardement de la gare de Creil toucha le train d'Amiens, tuant 77 voyageurs et en blessant 61 autres. Plusieurs quartiers de la ville furent aussi bombardés : le 27 juin, les rues Raspail et Etienne Dolet ; le 23 juillet, les rues Gambetta, Somasco et le quai d'Amont ; le 31 juillet, de nouveau le quai d'Amont et l'immeuble du Secours national ; le 5 août, la rue Victor Hugo. Creil connut 52 bombardements durant la guerre, les Alliés utilisant parfois des bombes à retardement. Le ciel de Creil fut aussi l'espace de combats tel le 25 août 1944 au cours duquel huit avions furent abattus. Le 29 août, les Allemands détruisirent le pont sur l'Oise, assurant ainsi leur retraite. Libéré par les Américains le 31 août 1944, Creil vit sa base aérienne utilisée par les forces alliées comme base de dégagement jusqu'au 16 janvier 1946. Stèle en hommage aux combattants du 190e RI tombés à Crapeaumesnil.
NANTEUIL LE HAUDOUIN
SSSS SOUS LES BOMBES Fin mai 1940, tandis que l'effort allemand se portait sur la poche de Dunkerque, la défense française s'organisait sur la ligne Weygand. Nanteuil-le-Haudouin se trouva en arrière du secteur de la 8e DI tenant la rive gauche de l'Aisne entre Trosly-Breuil et Soissons. Le 5 juin, l'offensive allemande était lancée notamment au nord-ouest de Soissons. Deux jours plus tard, la 8e DI était renforcée par la 87e DIA en repli derrière l'Aisne. Le 9 juin, l'ordre d'évacuation de la commune fut délivré par la préfecture. Ce jour-là, le 47e Régiment d'Artillerie, débarqué aux gares de SaintMard et Plessis-Belleville, devait apporter son soutien aux unités de la Division de Fer (11e DI) et du 57e RIC. Aux soldats montant en ligne ou harassés par les combats se mêlaient les civils, les uns attendant à la gare le départ du dernier train pour Paris, les autres évacuant la ville sur les routes de l'exode. Selon le Journal des Marches et Opérations du 47e RA, le régiment fut repéré par un avion de reconnaissance allemand tandis qu'il traversait Nanteuil en colonneFin mai 1940, tandis que l'effort allemand se portait sur la poche de Dunkerque, la défense française s'organisait sur la ligne Weygand. Nanteuil-le-Haudouin se trouva en arrière du secteur de la 8e DI tenant la rive gauche de l'Aisne entre Trosly-Breuil et Soissons. Le 5 juin, l'offensive allemande était lancée notamment au nord-ouest de Soissons. Deux jours plus tard, la 8e DI était renforcée par la 87e DIA en repli derrière l'Aisne. Le 9 juin, l'ordre d'évacuation de la commune fut délivré par la préfecture. Ce jour-là, le 47e Régiment d'Artillerie, débarqué aux gares de SaintMard et Plessis-Belleville, devait apporter son soutien aux unités de la Division de Fer (11e DI) et du 57e RIC. Aux soldats montant en ligne ou harassés par les combats se mêlaient les civils, les uns attendant à la gare le départ du dernier train pour Paris, les autres évacuant la ville sur les routes de l'exode. Selon le Journal des Marches et Opérations du 47e RA, le régiment fut repéré par un avion de reconnaissance allemand tandis qu'il traversait Nanteuil en colonne Plus tard dans la journée, onze bombardiers ennemis attaquèrent en piqué le convoi par quatre fois, larguant des bombes et mitraillant. La rue principale et ses abords furent les cibles principales. La gendarmerie, l'école, le clocher de l'église et de nombreuses maisons furent détruis. Il fallut une journée entière au convoi pour quitter la ville et prendre position sur le plateau entre Péroy-les-Gombries et BoissyFresnoy. Si, le 10 juin, en fin d'après-midi, un nouveau bombardement allemand toucha Nanteuil-le-Haudouin, les trois groupes de batteries du 47e RA purent tirer plus de 4 300 coups de canons les 11 et 12 juin avant de se replier sous la pression de la Wehrmacht. Nanteuil-leHaudouin passait aux mains allemandes. CITATION Citation à l'ordre de la Brigade “ Evacuée par ordre à deux reprises différentes en mai et juin 1940, a particulièrement souffert des bombardements aériens et plus spécialement de celui du 9 juin 1940 de nombreux immeubles ont été détruits, notamment le groupe scolaire et la gendarmerie, de plus ce bombardement a fait plusieurs victimes dont dix sept tués et quatre blessés. A encore subi les bombardements alliés de 1943-1944 au cours desquels la gare et la voie ferrée étaient plus particulièrement visées. L'ensemble de la population s'est toujours montré digne et patriote durant l'occupation aidant les parachutistes alliés et hébergeant des évadés. Plusieurs habitants ont été arrêtés, déportés et sont morts dans des camps de concentration.” RELEVER LES RUINES Les premiers évacués regagnèrent la commune le 23 juin et constatèrent les destructions : sur les 250 immeubles de la ville, 130 étaient en ruines. Les bombardements successifs avaient, en outre, tué dix-sept personnes. En plus de l'occupation allemande, les habitants souffrirent du dénuement. A la suite de la démission du maire Ernest Bacquet, une délégation spéciale fut installée en septembre suivant, présidée par Gustave Gayet puis, en mars 1941, par Gaston Huet. Durant l'occupation, la Résistance locale réalisa des sabotages sur la ligne ferroviaire et participa à des parachutages et des opérations pick-up. Les Allemands menèrent plusieurs actions de représailles.Ainsi, Jules Dubrulle, employé SNCF et militant communiste, fut destitué de son mandat de conseiller 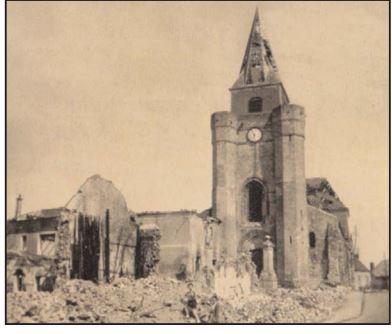 municipal en février 1940. Arrêté le 16 juillet 1941, déporté le 6 juillet 1942 dans le convoi des “45 000”, il décéda à Auschwitz le 4 septembre suivant. Gilbert Chevance, résistant, mourut en déportation à Sonneburt le 27 janvier 1944 VERS LA LIBERATION Avec le Débarquement en Normandie, la gare et la voie ferrée subirent plusieurs mitraillages alliés (4 juin, 17 juin, 8 juillet) et des sabotages par la Résistance (15 juin, 16 juillet). Dans la nuit du 4 au 5 juillet 1944, un B-24H Liberator explosa au-dessus de Nanteuil-le-Haudouin. L'avion s'écrasa au sud de PlessisBelleville causant la perte des huit hommes d'équipage. L'intensification des actions et l'approche de la Libération rendirent fébriles les occupants. Le 25 août 1944, l'ouvrier agricole Marcel Richy tomba sans raison sous les balles allemandes. Ce même jour, la ville fut le siège d'un groupe de Panzers qui quitta les lieux le 28. Nanteuil-le-Haudouin fut libéré sans combat le 30 août 1944 par le 7e Corps US venant de Seine-et-Marne, suivi peu après par le 5e Corps US. Aussitôt, le Comité Local de Libération, avec à sa tête le résistant Lionel Paren (Front-National), destitua la délégation spéciale et nomma Ainsi, Jules Dubrulle, employé SNCF et militant communiste, fut destitué de son mandat de conseiller municipal en février 1940. Arrêté le 16 juillet 1941, déporté le 6 juillet 1942 dans le convoi des “45 000”, il décéda à Auschwitz le 4 septembre suivant. Gilbert Chevance, résistant, mourut en déportation à Sonneburt le 27 janvier 1944. le lendemain une commission municipale présidée par l'ancien maire Bacquet. Ce dernier fut remplacé pour raisons de santé par l'huissier Noël Roux. Nanteuil-leHaudouin se vit attribuer la Croix de Guerre avec étoile de bronze le 11 novembre 1948
municipal en février 1940. Arrêté le 16 juillet 1941, déporté le 6 juillet 1942 dans le convoi des “45 000”, il décéda à Auschwitz le 4 septembre suivant. Gilbert Chevance, résistant, mourut en déportation à Sonneburt le 27 janvier 1944 VERS LA LIBERATION Avec le Débarquement en Normandie, la gare et la voie ferrée subirent plusieurs mitraillages alliés (4 juin, 17 juin, 8 juillet) et des sabotages par la Résistance (15 juin, 16 juillet). Dans la nuit du 4 au 5 juillet 1944, un B-24H Liberator explosa au-dessus de Nanteuil-le-Haudouin. L'avion s'écrasa au sud de PlessisBelleville causant la perte des huit hommes d'équipage. L'intensification des actions et l'approche de la Libération rendirent fébriles les occupants. Le 25 août 1944, l'ouvrier agricole Marcel Richy tomba sans raison sous les balles allemandes. Ce même jour, la ville fut le siège d'un groupe de Panzers qui quitta les lieux le 28. Nanteuil-le-Haudouin fut libéré sans combat le 30 août 1944 par le 7e Corps US venant de Seine-et-Marne, suivi peu après par le 5e Corps US. Aussitôt, le Comité Local de Libération, avec à sa tête le résistant Lionel Paren (Front-National), destitua la délégation spéciale et nomma Ainsi, Jules Dubrulle, employé SNCF et militant communiste, fut destitué de son mandat de conseiller municipal en février 1940. Arrêté le 16 juillet 1941, déporté le 6 juillet 1942 dans le convoi des “45 000”, il décéda à Auschwitz le 4 septembre suivant. Gilbert Chevance, résistant, mourut en déportation à Sonneburt le 27 janvier 1944. le lendemain une commission municipale présidée par l'ancien maire Bacquet. Ce dernier fut remplacé pour raisons de santé par l'huissier Noël Roux. Nanteuil-leHaudouin se vit attribuer la Croix de Guerre avec étoile de bronze le 11 novembre 1948
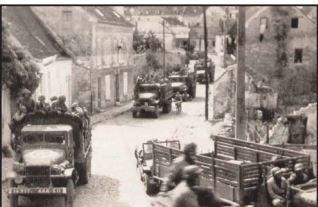
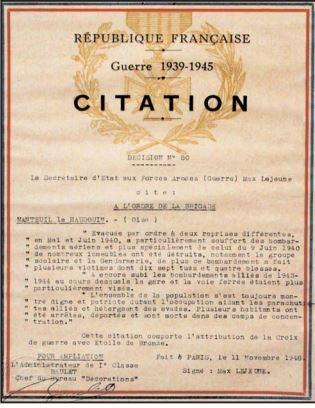
CREIL
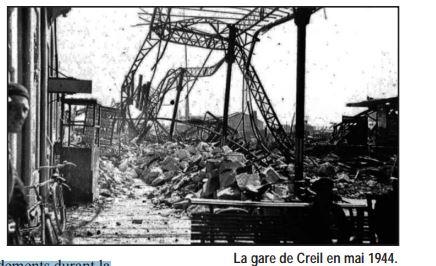
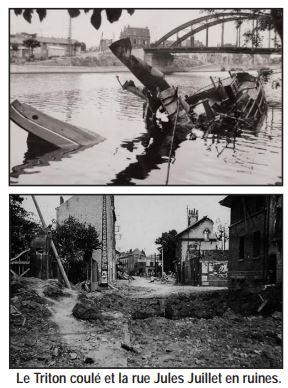 CREIL DOMINE
CREIL DOMINE 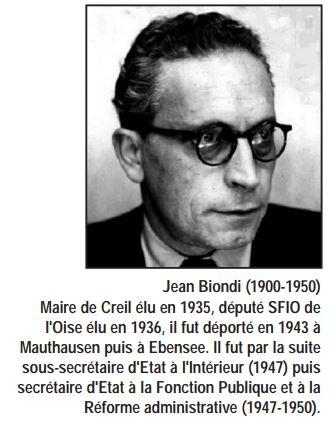
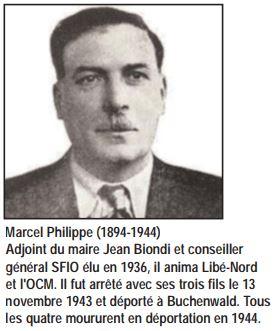 Cité ferroviaire et industrielle, Creil subit les premiers bombardements allemands le 18 mai 1940. Le raid du 9 juin fut particulièrement meurtrier avec l'incendie du magasin “Au Bon Diable” où plusieurs centaines de civils et de militaires s'étaient réfugiés. Au début de l'occupation allemande, les cibles s'inversèrent : quelques incursions aériennes anglaises touchèrent la ville, notamment les 22 juillet et 14 août 1940. En effet, dès fin juin 1940, l'organisation Todt avait construit une base aérienne sur 350 hectares du plateau de Creil pourvue de deux pistes bétonnées de 1720m et 1640m pour une largeur de 49m. Utilisée lors de la Bataille d'Angleterre par des bombardiers Heinkel 111, Dornier DO 17 et ME 110, la base fut occupée à partir de 1942 par des groupes de chasse équipés de FW190 et de ME109. La vie municipale fut marquée par l'attitude du maire Jean Biondi, député de l'Oise qui refusa de voter les pleins pououvors au marechal Petain à Vichy Déchu de son mandat de maire en avril 1941, il entra en Résistance dans le réseau Brutus et dans Libé-Nord. L'ingénieur Robert Arnould fut nommé maire par Vichy le 19 avril suivant .Jean Biondi (1900-1950) Maire de Creil élu en 1935, député SFIO de l'Oise élu en 1936, il fut déporté en 1943 à Mauthausen puis à Ebensee. Il fut par la suite sous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur (1947) puis secrétaire d'Etat à la Fonction Publique et à la Réforme administrative (1947-1950) UNEN RESISTANCE MULTIFORME
Cité ferroviaire et industrielle, Creil subit les premiers bombardements allemands le 18 mai 1940. Le raid du 9 juin fut particulièrement meurtrier avec l'incendie du magasin “Au Bon Diable” où plusieurs centaines de civils et de militaires s'étaient réfugiés. Au début de l'occupation allemande, les cibles s'inversèrent : quelques incursions aériennes anglaises touchèrent la ville, notamment les 22 juillet et 14 août 1940. En effet, dès fin juin 1940, l'organisation Todt avait construit une base aérienne sur 350 hectares du plateau de Creil pourvue de deux pistes bétonnées de 1720m et 1640m pour une largeur de 49m. Utilisée lors de la Bataille d'Angleterre par des bombardiers Heinkel 111, Dornier DO 17 et ME 110, la base fut occupée à partir de 1942 par des groupes de chasse équipés de FW190 et de ME109. La vie municipale fut marquée par l'attitude du maire Jean Biondi, député de l'Oise qui refusa de voter les pleins pououvors au marechal Petain à Vichy Déchu de son mandat de maire en avril 1941, il entra en Résistance dans le réseau Brutus et dans Libé-Nord. L'ingénieur Robert Arnould fut nommé maire par Vichy le 19 avril suivant .Jean Biondi (1900-1950) Maire de Creil élu en 1935, député SFIO de l'Oise élu en 1936, il fut déporté en 1943 à Mauthausen puis à Ebensee. Il fut par la suite sous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur (1947) puis secrétaire d'Etat à la Fonction Publique et à la Réforme administrative (1947-1950) UNEN RESISTANCE MULTIFORME
Dès 1940, des réseaux et des mouvements de Résistants s'organisèrent dans le Creillois. Ainsi, l'Armée Secrète (AS) prit naissance dans l'Oise avec deux professeurs de l'Ecole Normale Professionnelle de Creil, Roland Delnef et Marcel Sailly. L'OCM qui succéda à l'AS, eut à sa tête en 1944 pour le secteur sud-est André Bataillard, alias commandant Martin. L'organe de liaison de l'OCM, Entre-Nous, fut d’abord tiré sur les presses de la Coopérative d'Imprimerie Ouvrière administrée par Marcel Philippe. En parallèle, l'instituteur Edmond Leveillé contacta son collègue Pierre Auzy pour assumer la parution clandestine du Patriote de l'Oise.La Résistance FTP de Creil, quant à elle, fut placée sous le commandement de Maurice Mignon (colonel Théo), chef du détachement Valmy. Outre la distribution de tracts et de journaux, la Résistance sabota des lignes de train, câbles téléphoniques, usines… De même, le réseau Zéro-France s'implanta à Creil, notamment par l'institutrice Simone Hainault. Face à cette montée de la Résistance dans le département, la police de sûreté et des services de sécurité (SicherheitsPolizei, Sipo-SD) créa une annexe à Beauvais qui s'installa à Creil en juillet 1942 au 28 rue Henri Pauquet, sous la direction de l'Unterführer Otto Bialowons. La Gestapo s'installa aux 21 - 23 rue Henri Pauquet. LES BOMBARDEMENTS ALLIES Jusque-là épars, les bombardements alliés s'intensifièrent en 1944 en préparation ou en accompagnement du Débarquement. Le secteur Creil-Nogent-Montataire se trouva ainsi sous le coup de l'opération Desert Rail. Les bombardements affectèrent la gare de triage, les dépôts, le terrain d'aviation. Pour le seul mois de mars 1944, la ville fut touchée sept fois : le 17 mars, la gare de triage fut bombardée par la 8e Air Force qui provoqua l'explosion d'un train de munitions ; le 20 mars, le Creillois fut bombardé par 138 avions provoquant la destruction du dépôt ferroviaire du Petit-Thérain; le 23, un bombardement par 300 appareils endommagea l'écluse en dérivation, les établissements Cima-Wallut et la Vieille Montagne; le 26, un nouveau bombardement toucha Creil et Montataire. Le lendemain, la gare fut rendue inutilisable par de nouvelles bombes; le 28, les deux gares de triage, les nœuds ferroviaires et les dépôts de machines furent touchés par un raid. Enfin, le 30 mars, la 8e Air Force prit à partie le Petit-Thérain. Durant les mois qui suivirent, les bombardements se poursuivirent intensément sur les cibles stratégiques. Le terrain d'aviation fut bombardé notamment le 15 mai, le 27 mai, le 14 juin et le 12 juillet 1944. Cible privilégiée, les installations ferroviaires subirent les bombes alliées le 10 mai (gare), le 20 mai (le Pont Royal et le théâtre des cheminots) et le 4 juin (gare). Malgré les alertes, les bombardements provoquèrent des drames parmi les civils. Ainsi, le 27 avril 1944, le remorqueur fluvial Triton 22 fut coulé lors d'un bombardement matinal, provoquant la mort de onze mariniers. Le 8 mai, le bombardement de la gare de Creil toucha le train d'Amiens, tuant 77 voyageurs et en blessant 61 autres. Plusieurs quartiers de la ville furent aussi bombardés : le 27 juin, les rues Raspail et Etienne Dolet ; le 23 juillet, les rues Gambetta, Somasco et le quai d'Amont ; le 31 juillet, de nouveau le quai d'Amont et l'immeuble du Secours national ; le 5 août, la rue Victor Hugo.Creil connut 52 bombardements durant la guerre, les Alliés utilisant parfois des bombes à retardement. Le ciel de Creil fut aussi l'espace de combats tel le 25 août 1944 au cours duquel huit avions furent abattus. Le 29 août, les Allemands détruisirent le pont sur l'Oise, assurant ainsi leur retraite. Libéré par les Américains le 31 août 1944, Creil vit sa base aérienne utilisée par les forces alliées comme base de dégagement jusqu'au 16 janvier 1946
a completer
Date de dernière mise à jour : 07/04/2024
Ajouter un commentaire

